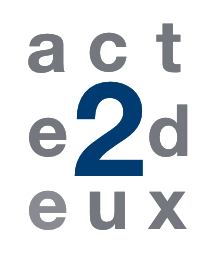La vie comme un drame sur la scène du monde
Extraits de Le Problème de l’autoréalisation dans l’art, Éditions De Boeck Université/Bibliothèque de Pathoanalyse. Texte français Michel Dupuis.
« Se réaliser soi-même dans la conduite de sa vie, c’est, selon, moi, la chose la plushaute qu’un homme puisse atteindre. Cette tâche, nous l’avons tous, les uns comme les autres, mais la plupart des gens la bâclent. » Henrik Ibsen avait cinquante-quatre ans quand il écrivit ces mots à l’ami qui devait être la personne « la plus grande » et la« direction de sa vie », à Björnstjerne Björnson. Ces mots contiennent la confession philosophique de sa vie, le leitmotiv de sa biographie, le résultat de son expérience vécue et, surtout, le problème fondamental autour duquel tourne l’oeuvre de sa vie d’écrivain.
À ce point où s’unissent la biographie, l’expérience et le travail de la vie, dans la perspective d’une hauteur à atteindre, en l’unité d’une forme vitale, d’un style vital, et où ils ne sont rien d’autre que les différents aspects de cette forme unique, c’est là que la vie elle-même est montée comme un drame sur la scène du monde. En effet, l’unité de la forme vitale suppose que toutes les possibilités de la vie n’ont de valeur qu’en fonction d’un tout, que ce tout est pourtant un « problème », une ob-jection [Vor-Wurf]à chercher dans et à travers la vie. Selon Ibsen lui-même, le jugement[1] que l’homme posera sur lui-même dépend de la réussite de ce pro-jet. Tout ceci constitue en fait les marques distinctives de la « tension » dramatique[2].
Les pièces d’Ibsen, ses drames, ne sont en réalité que des reconstructions et des reproductions artistiques du drame de la vie humaine en général, de laquelle sa propre vie n’était non plus qu’une forme spécifique. Le propre de cette forme est précisément que le drame de la vie fut vécu excellemment ici dans la forme du drame poétique, de l’oeuvre d’art dramatique. Nous mettons l’accent sur le mot art. C’est vrai qu’à la basede toute production dramatique réside – pour le dire avec Leopold Ziegler[3] – « la poussée poético-ludique vers la transformation de soi », vers la « métamorphose ».
Cette poussée ludique est pourtant encore très éloignée de l’art. La question de l’autoréalisation dans l’art et par l’art se pose pour la première fois quand l’homme, et c’était le cas chez Ibsen, maîtrise et configure cette poussée dans l’abandon sans condition à l’obligation et à la contrainte de l’art, à ce qui est exclusivement objectif enlui. C’est d’abord de cette manière qu’il parviendra à se préserver de la dissolution dansl’oubli de soi et de la mutilation suicidaire, et qu’il arrivera comme artiste au sommet de ce que l’homme peut atteindre, et par conséquent à la réalisation effective de soi.
L’autoréalisation dans la manière de vivre la vie pratique : le détour en vue du Retour
Ce qu’Ibsen entend par autoréalisation dans la manière de vivre, et ce qu’il désigne aussi ça et là brièvement comme le sérieux dans cette manière de vivre, apparaît à nouveau dans une lettre à son ami, écrite par Ibsen quand il avait trente-neuf ans : « Je sais que j’ai été sérieux dans ma façon de vivre, sous une croûte de non-sens et de saleté. » Comme preuve de ce sérieux, il ajoute du même coup : « Sais-tu que je me suis toute ma vie éloigné de mes parents, de toute ma famille, parce que je ne voulais pas demeurer en l’état de demi-intelligence ? » Cette demi-intelligence concernait surtout le domaine de la religion. D’abord, Ibsen avait quinze ans quand il s’est « enfui», pour assurer lui-même, à partir de ce moment et pendant plusieurs années, sa subsistance comme apprenti et comme premier commis-pharmacien. En décidant de quitter safamille, Ibsen fait le premier pas «sérieux », dont nous ayons connaissance, vers l’autoréalisation. Mais l’anticipation de l’achèvement des possibilités d’être est contenue dans chaque décision actuelle de la vie : de cette manière […], Ibsen a déjà accompli, en cette décision, une pré-décision pour sa vie tout entière. La demi intelligence, l’être-à-demi en général, c’est le contraire de la forme ; c’est l’absence de forme, le compromis. Vu que la compréhension ou le comprendre signifient toujours et partout le dévoilement ou l’accessibilité, la transparence ou la clarté (de l’étant), la demi-compréhension signifie donc toujours quelque chose comme un voilement ou une inaccessibilité, une non-transparence ou une non-clarté – en un mot, la non-vérité. Dans l’état « non-vrai » de la demi-intelligence, ne se trouvaient qu’à demi accessibles ou transparents non seulement les parents vis-à-vis du fils et le fils vis-à-vis des parents, mais du même coup, le fils aussi lui-même.
L’autoréalisation au sens où l’entend Ibsen, c’est-à-dire considérée comme la « tâche la plus haute » pour chacun d’entre nous, n’est quant à elle possible qu’à la lumière et sous la conduite de la possibilité d’être la plus haute de l’existence elle-même, laquelle – en tant que « mesure » ou «jugement – peut octroyer forme, mesure et direction à toutes les autres. Se réaliser soi-même, nous le voyons déjà ici, signifie donc tout autre chose que « vivre sa vie ». Car en vivant notre vie, nous ne nous réalisons précisément pas nous-mêmes, mais seulement quelque chose de ou dans notre existence, c’est-à-dire les possibilités d’être purement hédonistes, avec la mise hors circuit justement de la possibilité d’être proprement « humaine».
Le jeune Ibsen a quitté ses parents et sa famille pour ne pas demeurer avec eux dans l’état de non-vrai d’une demi-intelligence : cela indique à quel point il possédait précocement son soi – autrement dit, la grandeur, déjà à ce moment, de son pouvoird’être et de la « puissance de sa personnalité », qui donnaient direction à son existence. Pour un si jeune homme, cette direction ne pouvait guère se nommer que : là-bas, hors de la pesante étroitesse de la situation domestique, au loin, ou encore, dans une interprétation temporelle, la délivrance du présent et du passé, et la libération pour un futur propre. Car l’autre chemin qui permettait de sortir de la situation de compromis d’une demi-intelligence, le chemin du changement des autres, de leur instruction, de leur éducation et de leur conversion, ce chemin était naturellement encore barré à un homme si jeune. Dans la mesure où la voie vers le lointain, l’éloignement, maintenant comme pour la suite, n’était pour Ibsen que le détour en vue du retour dans la proximité des autres, précisément en vue de leur instruction, de leur éducation ou de leur conversion, la résolution du jeune Ibsen de se séparer de sa famille (comme plus tard de se séparer de sa patrie, de sa communauté et de son État) signifie en réalité l’anticipation de l’achèvement possible des possibilités d’être constituant son existence. Le sérieux de la manière de vivre, l’autoréalisation, ne s’arrêtent donc pas chez Ibsen, lalibération de la demi-intelligence avec sa famille. Avec son pays natal non plus, il ne pouvait pas rester « dans l’état d’une demi-intelligence». Ici encore, il ne se voulait que « transparent » à lui-même, «clair » ; ici encore, il ne se trouvait lui-même « en vérité » que par l’inversion résolue de l’à–demi et de l’étroitesse des « rapports » nationaux en la totalité et la largeur de « rapports culturels libres et libérateurs ». En 1884 encore –Ibsen est né en 1828 –, il écrit à son ami de jeunesse : « Quand il y a dix ans, j’abordais le fjord, après dix-neuf ans d’absence, je sentis que ma poitrine se nouait, littéralement, dans l’oppression et le malaise. » « Je n’étais plus moi-même sous tous ces yeux norvégiens, froids et sans compréhension » (je souligne). Et en 1888, à Georg Brandès : « J’ai commencé par me sentir Norvégien, puis j’ai grandi en Scandinavie et je suis maintenant comme un Germanique-en-général ». Nous pouvons ajouter: « arrivé à bonport », comme un Humain-en-général. « On ne vit pas pour rien pendant vingt-sept ans au-dehors, dans les grands rapports culturels libres et libérants », écrit-il, presque septuagénaire, dans un coup d’oeil rétrospectif adressé au même correspondant. « Ici à l’intérieur ou, pour le dire plus exactement, ici en haut, dans les fjords, je possède, il est vrai, le pays de ma naissance. Mais – mais – mais : où trouvé-je le pays qui soit ma patrie ? Ce qui m’attire le plus, c’est l’océan…»
Dans le lointain libérant des « grands rapports culturels », Ibsen s’est libéré lui-même et s’est étendu au large, il s’est réalisé dans une forme toujours « plus claire et plus forte ». Mais au-delà de cette forme encore, son esprit sans repos pousse vers le large, dans un large éloigné de toute culture, dans l’étendue « infinie » de la nature « qui est la patrie », celle de l’océan.
Ce qui vaut pour le rapport à sa propre famille et à son pays natal, vaut aussi pour le rapport à la société. Avec elle non plus, il ne pouvait pas vivre dans une demi intelligence; d’avec elle aussi, il acheva la séparation, la rupture, au profit de la totalité, de la forme claire de son soi. Ce n’est pas par haine envers la société, ce n’est pas comme un révolutionnaire né ou comme un ennemi de la société qu’Ibsen est devenu « critique de la société » – un rôle que l’on a trop mis à l’avant-plan en considération de ses drames ; il l’est devenu au contraire sur la base du sérieux de la manière de vivre, qui ne lui permettait pas de pactiser avec une société comparée au bateau sur lequel le bruit court qu’il transportait « un cadavre dans sa cargaison »[4]. Dans cette image poétique s’exprime le soupçon qu’à la manière d’un Jakob Burckhardt, d’un Nietzsche, d’une Gervinus, il avait conçu après 1870-1871, envers une société derrière la prospérité et l’activité de laquelle il percevait l’odeur de la pourriture, de la vie descendante[5]. Chez Ibsen, la critique sociale n’est pas une volonté de bouleversement, mais uneaffaire de voyance et une mise en demeure. Il avertit parce qu’il voit, parce que partout et en toutes choses, l’étant lui devient accessible « en vérité », transparent, de telle façon que toute dissimulation de la vérité, toute demi-mesure peut lui devenir choquante et objet de soupçons. Ce qu’il hait, ce n’est pas la société en général, mais la non-vérité de sa demi-mesure qui ne permettait pas à ses contemporains d’advenir à eux-mêmes en son sein, de se réaliser eux-mêmes.
De plus, ce qu’Ibsen avait sous les yeux, ce n’est pas seulement que son temps pouvait être « décrit comme une conclusion », mais aussi qu’une chose nouvelle voulait « naître » de son temps. « Je crois », dit-il en 1887 lors d’une fête organisée en sonhonneur à Stockholm, « que nous sommes à la veille d’un temps où le concept politique et le concept social cesseront d’exister dans leurs formes actuelles, et où l’un et l’autre croîtront en une unité qui porte en soi avant tout les conditions du bonheur de l’humanité ». Ici encore, Ibsen est un voyant. Parallèlement, il s’est toujours senti comme un « franc-tireur isolé », qui veut « se tenir à l’extérieur des avant-postes, et opérer de sa propre main ». Il savait que « la majorité, la masse, la foule, ne pourraient jamais le rattraper », qu’il ne pourrait jamais avoir la majorité pour lui. Comme « combattant spirituel en première ligne », il se trouvait dans une « avancée incessante » : « À l’endroit où je me tenais quand j’écrivais mes divers livres », écrit-il à cinquante-cinq ans, « il y a maintenant une foule bien compacte. Mais moi je n’y suis plus – je suis ailleurs, plus loin devant, du moins je l’espère.[6] » Mais « l’être à l’avant » de celui qui se tient isolé à l’avant-poste et le « en avant » de celui qui marche dans une progression perpétuelle ne sont, nous l’avons vu, que des anticipations de la possibilité d’être la plus haute ; ainsi donc, la catégorie propre de l’autoréalisation chez Ibsen, comme chez tout homme au sens plein du terme, ne peut être celle de l’éloignement au large, mais uniquement celle de l’ascension dans la hauteur. C’est seulement dans la progression en hauteur que l’homme peut atteindre le point le plus haut ; de même, il le manque seulement dans le fait de tomber, dans la chute. Le point le plus haut n’est cependant atteint que lorsque l’avant et le vers l’avant au-delà de la foule, du monde d’autrui, anticipent le retour vers le monde d’autrui et le monde des proches[7]. Ce qui vaut pour le rapport d’Ibsen à la société, vaut finalement encore pour son rapport à l’Etat. « L’État est la malédiction de l’individu ». « L’État a sa racine dans le temps ; il aura son sommet dans le temps. Des choses plus grandes que lui disparaîtront… » « Je n’ai aucun talent de citoyen. » « Pour moi, la liberté est la première et la plus haute condition de la vie. » « La Norvège est (en effet) un pays libre, (mais) peuplé de gens non libres. » « Le travail de libération ne devra-t-il donc être permis que dans le domaine de la politique ? N’y a-t-il donc pas, avant toute chose, des esprits qui ont besoin de libération ? » « Je ne serai jamais d’avis de considérer la liberté comme synonyme de liberté politique. Ce que vous nommez liberté, je l’appelle libertés ; et ce que j’appelle lutte pour la liberté, ce n’est tout de même rien d’autre que l’appropriation continuelle, vivante, de l’idée de liberté. Car celui qui possède la liberté autrement que comme une chose à désirer, il la possède morte et inanimée ; je vous l’assure en effet, leconcept de liberté a la particularité de s’éloigner constamment durant l’appropriation, et si donc quelqu’un s’arrête durant le combat et dit : maintenant je la tiens ! – eh bien, en faisant cela, il révèle qu’il l’a perdue. Mais justement, avoir cette espèce morte, une position fixe et ferme sur la liberté, c’est une caractéristique des rapports d’État ; et c’est bien ce que j’ai pensé, quand j’ai dit qu’il n’y a rien de bon » (lettre à GeorgBrandès). Et au même : « Et alors la merveilleuse envie de liberté – c’en est fini. Oui, moi au moins, je dois le dire – la seule chose que je préfère à la liberté, c’est le combat pour elle ; sa possession m’indiffère. »
Par ces déclarations sur la liberté, Ibsen rappelle Lessing et Kierkegaard. Mais elles nous révèlent aussi quelque chose de sa conception de l’histoire. Tout comme pour Hebbel mais en nette opposition avec Grillparzer, pour Ibsen, l’histoire n’est pas un passé clôturé reposant derrière nous ; c’est une présence qui exige une active coopération, un changement continu de formes, dont le poète dramatique est appelé à vivre et à mettre en forme, en résonance avec elles, la destruction et l’édification « dramatiques ». À propos de l’histoire aussi, Ibsen est comme Nietzsche, pour le dire avec les mots de Shelley, le « miroir d’une ombre gigantesque que le futur a jetée sur le présent ». Que des « choses plus grandes » que l’État disparaissent… Il vise tout d’abord la religion. Et dans la foulée, il ajoute : « Ni les concepts moraux, ni les formes artistiques n’ont une éternité devant eux. »
Les déclarations sur la liberté jettent à nouveau une lumière significative sur la conception ibsénienne de l’autoréalisation, conçue comme un élargissement incessant et interminable de moi-même dans l’incessant changement de toutes les formes qui constituent le monde, à partir desquelles seulement je me comprends bien moi-même, et avec le changement desquelles seulement la forme de mon moi se transforme à son tour. Par suite, l’autoréalisation signifie que l’homme écarte tout ce qui s’interpose entre lui et son monde, tout ce qui lui « truque » [« verstellt »] le monde ; en d’autres mots, l’homme se libère de tout « lest » étranger à soi, il perce tout « à-demi », il tranche tout lien non libre et il « bat monnaie du métal » qu’il porte en lui. C’est ainsi qu’Ibsen écrit un jour à Georg Brandès: « Ce qu’avant toute chose je voudrais vous souhaiter, c’est un authentique égoïsme pur-sang, qui puisse devenir pour vous le motif, durant unepériode, de n’attacher valeur et signification qu’à vous-même et à votre cause, et de considérer tout le reste comme non existant. Ne prenez pas ceci comme le signe d’une certaine brutalité de ma nature ! La meilleure façon dont vous puissiez être utile à voscontemporains n’est tout de même que de battre monnaie du métal que vous portez envous. Je n’ai jamais réellement eu un grand sens de la solidarité ; je n’ai véritablement retenu qu’un dogme traditionnel – et si l’on avait le courage de laisser cela complètement hors de considération, on se libérerait peut-être du lest qui pèse très lourdement sur la personnalité. D’une façon générale il est temps –, vu que l’histoire du monde m’apparaît comme un naufrage extraordinairement grand -, il s’agit de se sauver soi-même ! »
Avec l’exigence de se sauver soi-même, Ibsen se trouve parmi une série d’hommes quiva de Socrate à Kierkegaard, Nietzsche, Jaspers et Heidegger, et qui, dans le « naufrage extraordinairement grand » de notre temps, a une mission plus grande que jamais. Cela étant, ce serait une profonde erreur de croire qu’Ibsen ait été un individualiste isolationniste. « La défense de la vie individuelle » n’a rien à voir avec l’isolationnisme individualiste. La déclaration sur la nécessité de la libération des esprits témoigne déjà du contraire, de même que la limitation significative de l’« égoïsme pur-sang » « à une période », c’est-à-dire à la période durant laquelle on se tient seul à l’avant-poste et où l’on poursuit l’avancée. Par cette limitation de l’égoïsme pur-sang à une période, à une phase de transition dans l’autoréalisation, Ibsen se distingue de Nietzsche et de Stirner. Il savait que c’est « la chaleur du coeur qui doit exister avant tout, si une vie spirituelle vraie et forte doit se développer », et il priait expressément qu’on fût persuadé que cettechaleur ne lui faisait pas défaut. Qui ne parviendrait pas à le croire n’a jamais scruté jusqu’au fond aucun de ses drames. Chez Ibsen, l’autoréalisation s’est produite dans une autre proximité que celle du « sens de la solidarité », c’est-à-dire le sens de l’entourage actuel, dans lequel notre existence est jetée sans que nous y soyons pour rien ; elle s’est réalisée dans la proximité du regard aimant et de la communication spirituelle ; l’autoréalisation ne serait autrement pas possible « à la longue ». Et le médium de cette communication, de ce retour aux autres dans une rencontre libre avec eux, ce fut son écriture. […] « Par nature, un poète appartient à la catégorie des presbytes. Jamais je n’ai contemplé la patrie et la vie vivante de la patrie de si près, si fortement et si clairement, que de loin justement, et dans l’absence»[8]. Ici encore, le lointain, la distance, la coupure ne sont que le détour vers la liaison et la communication authentiques.
Nous avons traité jusqu’ici de l’autoréalisation d’Ibsen dans la lutte contre la famille, la patrie, la société et l’État. Nous envisageons maintenant son autoréalisation dans la lutteavec lui-même. Nous devons bien sûr reconnaître clairement qu’il ne s’agit ici que d’une distinction artificielle : la lutte avec le monde d’autrui signifie réellement aussi la lutteavec soi-même[9]! Nous nous heurtons de nouveau ici au concept de sérieux. Ibsen parle une fois du combat « que tout homme sérieux doit soutenir avec soi-même, pour mettreen accord la conduite de sa vie et de sa connaissance ». Et il parle ici de façon assezsignificative des « personnes et des destins personnels » tirés de l’un de ses drames, dela pièce Rosmersholm – en dehors de l’incitation au travail que représente cette lutte,dont traite la pièce (comme d’ailleurs toutes ses pièces). Cette déclaration datant de ses cinquante-neuf ans, nous pouvons la confronter à une autre, extraite d’une compositionqui date de ses vingt ans, et qui résonne d’une façon très semblable – c’est la preuvequ’Ibsen était très tôt au clair sur la route de l’autoréalisation, et qu’il l’a suivie de façontrès conséquente : « pour autant que l’homme puisse lui-même exercer une influence réelle sur son destin, il pourrait le faire bien plus encore s’il possédait assez de connaissance de soi pour toujours adapter son agir aux forces dont il dispose, et pourtoujours connaître suffisamment ses tendances de manière à ce qu’elles ne l’emportentpas sur lui » (De l’importance de la connaissance de soi). Dans la préface à la seconde édition de Catilina, son oeuvre de jeunesse écrite quand il avait vingt et un ans, il interprète ce qu’il appelle le « conflit individuel » à surmonter dans l’autoréalisation,comme la « contradiction entre la force et l’aspiration, entre la volonté et la possibilité», et il y voit « la tragédie en même temps que la comédie de l’humanité et de l’individu ». La plupart des choses dont traitera son oeuvre ultérieure, Ibsen croit les reconnaître déjà dans cette oeuvre des débuts, «dans des indices vagues » – preuve de laconséquence avec laquelle il a poursuivi et travaillé le problème fondamental de sa vie et surtout, de son travail d’écrivain. Ailleurs, il parle encore de la « contradiction entre le mot et l’acte, entre la volonté et le devoir, plus généralement entre la vie et lathéorie ». L’homme qui demeure dans cette contradiction, demeure, pour utiliser le langage d’Ibsen, dans une « demi-intelligence » avec lui-même. Ainsi, ce qui vaut pour l’éloignement et la proximité par rapport à la patrie, est valable aussi pour l’éloignementet la proximité par rapport au soi propre : c’est seulement dans la distance « du presbyte » par rapport à nous-mêmes, par « constitution et par caractère », que nousarrivons à l’authentique proximité avec nous-mêmes, à la liberté et à l’indépendanceproprement du «Soi ». Mais ici encore, le retour-vers-(soi-même) n’est possible que sur le chemin escarpé sur la hauteur, dans la transcendance au-delà de soi dans lacommunication ou la rencontre d’amour avec l’étant en totalité ; c’est uniquement en celles-ci qu’à notre tour nous pouvons devenir accessibles et transparents à nous-mêmes« en vérité ». Accessibilité et transparence sont donc tout autre chose que le« refoulement » d’une part et la « sublimation » d’autre part. L’autoréalisation consiste bien plus en ce que toutes les possibilités d’être de notre existence gagnent direction, mesure et forme grâce au pouvoir d’être d’une chose « la plus haute », d’un Agathôn ;en d’autres termes, en ce qu’elles contractent une ???????? ou une liaison « plus hautes ».
Ibsen et l’autoréalisation dans la forme artistique
Comme nous l’avons vu, on parcourt le chemin de l’autoréalisation en s’éloignant des autres et de son « fond » propre, puis en revenant aux autres et à soi-même en passant par la hauteur. Autrement dit : l’éloignement, le chemin qui va de l’étroit vers le large, ne peut ramener ensuite à la juste proximité que s’il est en même temps un chemin vers le haut, une ascension. L’ascension est même le chemin de sortie si, comme ce fut le caschez Ibsen, elle contient l’anticipation du retour-à [« Zurück-zu »]. La hauteur dont il est question ici, Ibsen l’appelle le sérieux, d’autres l’appellent la prudence (c’est la phronésis des Grecs depuis Héraclite), d’autres encore l’appellent l’«esprit». Il s’agit cependant de montrer ce que signifie l’« esprit » d’un point de vue anthropologique.
Nous ne nous contentons pas de parler de possibilité ontologique spirituelle, d’être spirituel, d’être « dans l’esprit » ou, selon un terme philosophique technique, de transcendance spirituelle[10]. Bien plus, nous tenons à comprendre la manière de la transcendance spirituelle à partir de la direction de sens anthropologique originelle de la hauteur, plus exactement de l’ascension dans la hauteur. Cette hauteur maintenant, cette transcendance par conséquent, vers laquelle le processus de transcendance se produisit chez Ibsen, ce n’était ni la religion, ni la philosophie, ni la science. Nous le savons,c’était l’art. […]
Il est du plus haut intérêt de voir quelle impression Rome et l’Italie en général ont produite sur l’artiste nordique. Ibsen est entré dans Rome quand il avait trente-six ans, et il a quitté la ville pour la première fois à quarante. Nous somme en 1864, l’année même où Hans von Marées est arrivée à Rome, lui aussi. Je ne trouve pas d’indication du fait qu’ils se soient rencontrés à Rome. Si différents qu’ils aient été, voire opposés, en tant qu’artiste et en tant qu’hommes, ils eurent tout de même deux choses encommun : ils ont réalisé à partir d’eux-mêmes, en un long travail, ce qu’ils sont devenus, et ils ont reconnu la mission de l’artiste en tout premier lieu dans le fait de montrer à ceux qui les entourent, la plénitude totale et inépuisable du « subsistant »[Bestehende][11]. Certes, Marées s’est infatigablement efforcé de montrer le « subsistant » dans ses configurations complètes ; Ibsen quant à lui, nous a montré le « subsistant » surtout dans ses formes incomplètes, voire manquées, c’est-à-dire comme il est « dans sa vérité ». C’est pourquoi on peut dire d’Ibsen ce que Goethe a dit de Molière: « Molière a corrigé les hommes en les dessinant dans leur vérité[12]. »
La force de son être d’artiste est attestée par le fait que Rome n’a jamais été un danger pour Ibsen ; ce ne fut qu’une époque – décisive, il est vrai – de son autoréalisation dansl’art. Alors que le gothique l’avait tout d’abord « interpellé » et que la cathédrale deMilan fut pour lui « la chose la plus subjugante » qu’il pût imaginer dans ce domaine,c’est surtout à Rome que « la beauté de la sculpture antique » s’est révélée à lui : « Çavient en un éclair mais un unique éclair qui jette de la lumière sur de grandes surfaces ».À partir de la sculpture antique, la compréhension de l’essence de la tragédie grecques’est ouverte à lui, c’est-à-dire « de la vie et de l’essence des Grecs » en général, et parlà, de « ce qui est véritablement l’impérissable de la beauté ». « Ah si je pouvais mettremaintenant cette connaissance en pratique, au moins dans mon domaine ! ». Ce« maintenant » ne s’est pas fait longtemps attendre. Cette fois l’« éclair » ne vint pas dela sculpture antique mais de l’architecture, et de l’architecture renaissante précisément.Un beau jour, presque six mois après cette déclaration sur la cathédrale de Milan, alorsque son travail « ne voulait pas avancer », il entra dans la Basilique Saint-Pierre : « Làm’est apparue en une fois une forme puissante et claire pour ce que j’avais à dire ». Letravail, en fait, qui ne voulait pas avancer, c’était « Brand ». « Brand », le Titannordique et la Basilique Saint-Pierre de Rome ! Pour comprendre ou mieux, pourpressentir ce qui s’est passé ici, nous devons revenir une fois encore à la cathédrale de Milan. Ce qui dégoûta profondément Goethe, qui rentrait d’Italie, dans cette « énormité », parce qu’ici «l’absurdité sans imagination qui l’inspira, avait aussi la force de dessiner un plan pour ainsi dire sans fin »[13], c’était justement « la chose la plus subjugante » pour Ibsen qui, du Nord, arrivait en Italie ; et après cet aveu, Ibsen ajoute : « L’homme qui a pu imaginer le plan d’une telle oeuvre aurait pu aussi, durant ses tempslibres, avoir l’idée de fabriquer une lune et de la lancer en l’air, dans l’espace céleste ».Tandis que Goethe ne voyait dans la grandeur que le non sens d’une « petitesse multipliée » à l’infini, Ibsen y voyait une puissance capable de lancer un corps céleste dans l’infini. […]
En plus de la forme claire et puissante de l’architecture et de la sculpture, une touteautre chose apparut aussi à Rome, une chose non romaine. Il l’écrit dans la même lettreà Björnson, dans les « environs merveilleux » de Rome il ne lut « rien d’autre que laBible – qui est forte et solide ». À la forme claire et puissante se joint ainsi le contenupuissant et solide. C’est précisément à Rome, dit-il, qu’Ibsen « expulsé » de lui-mêmel’« esthétique », qui l’avait tellement possédé autrefois, « en tant que chose isolée quipose l’exigence de valoir pour elle-même ». « L’esthétique en ce sens me semblemaintenant constituer une malédiction pour la poésie, autant que la théologie pour lareligion » (toujours dans la même lettre à son ami). Qu’il se soumette naturellement auxlois de la beauté, mais qu’il ne s’occupe pas de ses règlements traditionnels. C’est ainsique selon son point de vue, « personne plus que Michel-Ange n’a péché contre lestraditions de la beauté » ; « mais tout ce qu’il a crée est tout de même beau : parce quec’est plein de caractère ». Par contre, l’art de Raphaël ne l’a jamais enthousiasmé, car« ses formes datent d’avant la chute originelle ». L’homme du Sud « veut le beauformel : pour nous, même le formellement non beau peut être beau, fort de la vérité quiréside en lui » (à Georg Brandes). C’est pourquoi aussi, « le caractère de l’homme detous les jours n’est aucunement trivial d’un point de vue artistique ; en tant quereproduction artistique, il est aussi intéressant que n’importe quel autre ». […]Pour le jeune Ibsen déjà, la forme n’est jamais une chose que l’on ajoute de l’extérieur,aux hommes et aux objets ; c’est une chose qui tient à des intuitions, « dont la vérité estfondée dans l’essence de la chose même, et dont, par conséquent, on ne peut pasdiscutailler ». Pour Ibsen, la forme signifie presque littéralement ce que Goethe appellele style, même si le style, selon Goethe, réside « dans les fondements les plus profondsde notre connaissance, dans l’essence des choses, pour autant qu’il nous soit accordé dela reconnaître dans des formes visibles et saisissables[14] ». Contrairement autranscendantalisme esthétique soutenu récemment, et avec succès, par Jeanne Hersch(« l’être et la forme »), nous trouvons ici à l’oeuvre, chez Ibsen comme chez Goethe,ce que nous pouvons appeler un « réalisme esthétique », comme la seule foi ontologiquequi soit absolument appropriée à l’artiste.
Avec tout ceci nous avons depuis longtemps touché au thème de la réalité et de la véritéen art. Pour Ibsen qui l’a écrit un jour en évoquant Les Revenants, ce qui compte leplus, avant toute autre chose, dans ses drames, c’est de « provoquer chez le lecteurl’impression qu’il expérimente durant la lecture un fragment de réalité ». Et il estparticulièrement reconnaissant à un critique de Solness le Constructeur, d’avoir nonseulement « correctement interprété et éclairé » les figures dépeintes, mais « avoirprécisément fait ressortir leur caractéristique de personnes qui appartiennent à laréalité ». Dans cette pièce justement, cette détermination lui a particulièrement tenu àcoeur. On l’a déjà dit, en pensant aussi à Rosmersholm, il souligne qu’avant tout, lapièce « est naturellement un oeuvre [Dichtung] de personnes et de destins personnels ».Certes, à vingt-trois ans déjà, Ibsen écrit dans l’une de ses critiques théâtrales que « cen’est pas la réalité qui appartient, tant bien que mal, au domaine de l’art, mais bienplutôt l’illusion ». Mais il ajoute que si la réalité immédiate n’est pas autorisée auroyaume de l’art, « l’oeuvre d’art qui ne porte pas en soi la réalité », est égalementinjustifiée. Nous aurons à y revenir dans l’analyse de Solness le Constructeur. Et dansune autre critique théâtrale de la même année, Ibsen demande aux écrivains de « séparerdistinctement les exigences de la réalité et celles de l’art », mais bien sûr seulement« aussi longtemps, qu’ils n’ont pas assez de goût pour dégrossir les côtés rudes de laréalité, avant de saisir la réalité en vue de la reproduction poétique dans le cadreartistique ». L’art national, par exemple, n’est pas « servi par la copie des petitesses dela vie quotidienne », mais uniquement par le fait que l’écrivain sait « communiquer àson oeuvre ce ton fondamental qui résonne pour nous, de la montagne, à la vallée, desversants montagneux jusqu’aux rivages, mais surtout de l’intérieur de nous-mêmes ».Les gens, pour qui réalité et vérité sont synonymes, devraient considérer comme fausseet malsaine toute pièce qui n’est pas « dans le rapport de la photographie à la réalité ». Ildoit être clair ici que l’expression « illusion » ne peut pas être liée à la réalité artistiqueen tant que telle, mais seulement au processus de « médiation » de son caractère deréalité sur le spectateur, l’auditeur, le lecteur ! Nous n’avons pas le droit d’absolutiser laréalité soi-disant « objective », de façon à l’opposer à l’art comme illusion ou « belleapparence trompeuse », mais si nous parlons encore d’illusion, nous devons comprendreque la « réalité objective » est elle-même une sorte d’illusion, ou bien, comme Thurevon Uexküll l’a avancé récemment de manière si perspicace, qu’elle est « un mondedélirant parmi d’autres », développé « par la méthode physicaliste » comme par la «loiscénique, sous laquelle elle apparaît[15] ». Je renvoie aux considérations sur la réalitéartistique contenues dans le livre déjà cité de Jeanne Hersch L’être et la forme (1946), eten particulier, une fois encore, aux concepts fondamentaux de la poétique d’Emile Staiger.
Un pas plus loin, et nous voici au concept ibsénien du « symbolique » dans l’art. PourIbsen, abstraction faite d’un « profond sentiment du caractère sacré et de l’importancede l’art », ce qui distingue tout grand artiste, c’est « une aspiration enthousiaste, nonvers la réalité grossière, mais vers la vérité, vers ce rendu supérieur, symbolique, de lavie, la seule qui vaille réellement la lutte dans le monde de l’art et qui est pourtantreconnue par tellement peu de personnes seulement » (souligné par moi). En effet :« Toute personnalité remarquable est symbolique dans sa vie, symbolique dans ses acteset dans son rapport aux résultats de l’histoire. » En fait, « les manifestations trèssignificatives de la vie » devront « être potentialisées dans l’art », mais seul l’auteurmédiocre élève cette symbolique de la personnalité à la conscience. Et cela vaut aussipour l’« idée symbolique qui est à la base d’une oeuvre dramatique ». D’où l’exigencequ’« elle passe secrètement à travers l’oeuvre, comme la veine d’argent à travers laroche ». Jamais dans ses conversations et dans ses lettres, Ibsen n’aime à lever le secret de l’idée symbolique qui se trouve à la base des ses drames : il est obsédé par unecrainte presque féminine que cette idée soit dévoilée. La dissimulation et le voilementde l’idée rendent évidemment plus difficile une compréhension univoque de son oeuvre,et d’un autre point de vue, cela explique au fond que la discussion à propos de chacunde ses drames ne se termine jamais, qu’elle reste toujours ouverte ; de même, que laproblématique humaine de ses oeuvres n’est pas affectée par le changement des formessociales et artistiques qui s’est produit depuis, et qu’elle peut nous émouvoir,aujourd’hui encore comme il y a cinquante ans. Mais l’autre raison fondamentale dececi, c’est justement ce qu’Ibsen conçoit derrière l’expression « symbolique ». Comme nous l’avons vu, « symbolique » veut dire avoir du caractère (Michel-Ange), avoir une signification, être potentialisé, être vivant (au contraire de l’échafaudage sec) – tout autant que représentatif (personnalité symbolique). « Symbolique » veut dire en premierlieu la plénitude « réelle » de la vie humaine, en même temps que son atmosphèreextérieure et intérieure, abritant et figurant en soi selon son essence propre ; en un mot,« symbolique » signifie aussi bien vrai. Le «rendu symbolique supérieur de la vie » est donc synonyme du rendu de la vie dans sa vérité essentielle, dans la vérité de la forme artistique claire et puissante.
Jetons maintenant un coup d’oeil en arrière ! Ce qui lie l’autoréalisation d’Ibsen dans la conduite de la vie pratique à l’autoréalisation dans la forme artistique, en d’autres mots, ce qui est commune à l’homme-Ibsen et l’artiste-Ibsen, c’est la dépendance[Angewiesenheit] absolue de son existence à la forme « claire et puissante ». On a vu cette dépendance autant du point de vue de ce qu’il avait à dire (poétiquement) que de ce qu’il avait à faire (pratiquement). C’est seulement en cela qu’on peut comprendre comme anticipation de l’accomplissement de ses possibilités d’existence, et la décision de s’éloigner de sa famille, et la résolution de mettre en accord la vie et la théorie, lemot et l’acte, la volonté et le devoir – la résolution de toujours adapter ses comportements à ses forces et de maîtriser ses tendances. L’existence d’Ibsen s’est en effet « accomplie » dans l’autoréalisation et sa mise en ordre [Einordnung] dans la structure de sa personnalité en totalité [Gesamtpersönlichkeit], de son soi tout entier. Nous devons encore clarifier ce que nous appelons dépendance de l’existence parrapport à la forme, car cette expression de « forme » est si abstraite et tellementplurivoque ! D’abord, nous devons ne pas considérer ici la forme en opposition aucontenu. La forme est ici absolument une teneur ou un contenu également[16], et même uncontenu relatif à l’existence, une puissance d’être de l’existence, et même uneexceptionnelle parmi celle-ci : l’extrême ou la plus haute. Elle est cette puissance, oucette possibilité d’être qui, nous l’avons vu, confère à toutes les autres puissances d’être de l’existence à la fois leur rang dans l’entièreté de l’existence et leur signification pourla direction d’ensemble de cette même existence. Quand Ibsen oppose au non-sens et àla saleté, le sérieux de la conduite de la vie comme la tâche authentique de chacun denous, et quand il prend parti pour ce sérieux, nous voyons bien quelle force d’existenceil considère comme la plus haute, comme celle qui guide. Dès le début, ce sérieux,signifie en fait une forme décisive dans son existence : nous l’avons vu à sa résolutionde faire éclater les chaînes de l’environnement familial, et encore celles que luiimposaient ses « inclinations ». On a déjà plusieurs fois expliqué dans quelle mesureune telle résolution signifie que l’existence « dépend » de la forme. Cette dépendancepar rapport à la forme signifie que l’existence est menée par une puissance d’être, qui nesupporte aucun état d’à-moitié, aucune non-clarté, aucune non-vérité, aucune faiblesse.C’est la puissance ontologique de la véracité. Ce qui lie très profondément la véritéartistique, la véracité de l’artiste, et la vérité pratique, la véracité de l’homme dans laconduite de sa vie pratique – plus exactement, ce qui est à la base des deux choses –c’est l’impatience, et même l’intolérance face à toute demi-intelligence, ou à touteintelligence « non véritable », comme face à l’« insupportable ». C’est vrai aussi face àtoute non-clarté, toute non-accessibilité ou toute dissimulation de l’étant, qu’il s’agissed’une situation mondaine, d’un rapport interhumain, d’un rapport à soi-même ou encorede l’être-au-monde en général en tant qu’artistiquement non-transparent, nonaccessible,caché. L’homme réel et l’artiste réel, c’est donc seulement celui qui nesaurait supporter cette non-clarté mondaine et cette non-clarté artistique. Quant à laproductivité, elle est le corrélat existentiel de l’incapacité de supporter. La productivitédans n’importe quel domaine, n’est possible que comme autoréalisation, commeanticipation résolue d’un éclaircissement ou d’une clarté possibles, comme percée del’existence à travers la dissimulation de l’étant de façon à « l’amener à la lumière » dansquelque forme de vérité que ce soit, et à lui donner une forme dans cette lumière. Un teléclaircissement ou une telle productivité ne signifient pas seulement pour l’existence unélargissement de son monde, une prise de possession « plus large » du monde, maisselon la structure de l’être-au-monde, en même temps un élargissement et une élévationdu soi. Cette impatience et cette intolérance « productives » face à tout à-demi, toutenon-vérité ou non-clarté dont nous avons parlé, c’est en effet l’expression existentiellede ce que l’existence ne peut supporter que son monde soit trop étroit et trop sombre,trop non-clair ; autrement dit, que l’homme ne peut supporter l’existence de cette formeou, mieux, de cette non-forme. Existence pesante et productivité sont donc des traitsessentiels de l’autoréalisation qui s’impliquent réciproquement. Ce comportementproductif signifie une élévation de la capacité d’être du soi, et précisément sous laconduite de la plus haute force d’être possible pour l’existence, c’est-à-dire celle quidécide dans le sérieux. Dé-cider [Ent-scheiden] veut dire distinguer entre des régionsnon éclairées et éclairées de l’étant dans son entier, faire le pas hors de l’insupportablequ’on sait pesant et non-clair, du présent et du passé pesants, vers un futur possiblementclair et supportable. Les caractères d’être « supportable ou insupportable » ne sontnaturellement pas des caractéristiques de certaines situations en tant que telles, maisbien de la situation existentielle actuelle d’un soi actuel. Le caractère insupportable nesignifie ici rien d’autre que l’enchaînement ou la non-liberté du soi ; le caractèresupportable, rien d’autre que la liberté, comme ouverture du monde dans une « libredécision ». En cela, la forme ne représente pas non plus une contrainte, mais la nécessitéde la liberté.
Tout ceci trouve son point critique suprême dans l’autoréalisation dans la formeartistique, donc dans la productivité artistique. C’est uniquement à cause de cela que l’on pouvait parler chez Ibsen d’une anticipation de l’accomplissement des possibilitésd’être à travers tout le non-artistique. Si la productivité artistique est la forme la pluspure de la productivité, ce n’est pas seulement parce que les puissances d’être et du nonsenset de la saleté y sont non seulement condamnées mais bannies [verbannt] (ce quiest le cas naturellement aussi dans les sciences et la philosophie), mais parce que laforme, et elle seule, est ici proprement le contenu de produit, ce qui « constitue » toutela sphère d’être et dont l’intentionnalité « remplit totalement », par là même, le moded’existence en cause, à savoir le mode esthétique. De la même façon, dans l’artjustement, des régions non-claires de l’étant dans son entier « sont amenées àlumière » ; de même, la création artistique est une marche productive aventureuse,incertaine, pour sortir de la non-clarté insupportable de l’existence et entrer dans uneexistence supportable, éclairée. La forme spécifique d’éclairement de l’existence parl’art, c’est la forme artistique ou esthétique, la vision artistique et l’oeuvre d’art. Touteproduction d’une oeuvre d’art, toute création artistique, correspondent à la résolution del’existence de se rendre accessible ou d’éclairer l’étant dans la vérité de la forme« symbolique » essentielle. L’oeuvre d’art elle-même signifie cet accomplissement del’éclaircissement de l’étant en entier dans une forme artistique « nécessairement »libérante. Mais ce n’est pas seulement l’étant non-éclairé en général qui estinsupportable à l’existence comme artistique – il y a aussi tous les éclaircissements ourésolutions non-artistique de l’étant, les éclaircissement scientifiques, philosophiques etreligieux et avant tout, l’éclaircissement de l’étant dans le mode de la praxis, de la vie« pratique ». Cependant, pour l’existence artistique, tout cela ne représente aucunementun éclaircissement de l’étant. On ne peut naturellement pas concevoir ceci d’un seulpoint de vue psychologique ; on doit le comprendre anthropologiquement etontologiquement. En effet, cela ne tient pas ici à ce que cette intolérabilité « vient ounon à la conscience » de l’artiste concret lui-même, à tel moment ; il s’agit de quelquechose de plus que la conscience de l’artiste : il s’agit de l’existence comme artistique, dela forme d’existence artistique. Ibsen l’a justement souligné, la forme d’existenceartistique doit se laisser engager dans les projets du monde d’espèce non-artistique, enparticulier dans la « vie » de tous les jours, par conséquent en tant que régions nonéclairéesde l’étant. Cependant, contrairement à ce qui arrive si souvent, nous nepouvons pas pour autant comprendre le mode d’être artistique en contraste, ou enopposition avec n’importe quelle autre forme d’existence lui étant insupportable. L’artne signifie aucunement, comme est tenté de le croire le profane en matière artistique, lafuite ou le rétablissement d’un autre mode d’existence d’insupportable, que ce soit entant que création ou comme plaisir artistique. La « situation », dont l’artiste cherche à se« libérer » en général avec toute oeuvre particulière, qui « pèse sur lui », qui lui est« insupportable », n’est plus, on l’a déjà dit, une situation mondaine déterminée ; elleest bien plutôt la façon d’être insupportable de l’être opprimé[17] par l’étant dans sonentier en tant que totalité encore sombre, non-éclairée, non-ouverte – et précisémentnon-ouverte au sens de la forme artistique. Cette « hypersensibilité » si souvent remarquée, cette labilité[18] du génie artistique n’est qu’une seule face de la forme d’êtreartistique en général, précisément celle sur laquelle l’étant pèse le plus, celle qu’ilopprime le plus, celle pour qui, comme dit Goethe, « l’affaire presse ». Celle dont on nepeut libérer l’oppression et la congestion que dans la vision et la productivité artistiques,dans le projet du monde comme monde de l’art. C’est ce projet qui, pour l’artiste, selonles termes d’Ibsen, « seul mérite la lutte » est dont il se fait « un devoir sévère etexclusif ».
De quelle sorte maintenant, est le projet de monde en tant que monde de l’art ? Nouspouvons nous engager d’autant plus vite dans l’examen de cette question que noussommes convaincu, avec Goethe, que la « beauté » ne peut jamais s’exprimer sur ellemême; en d’autres mots, qu’elle ne peut jamais devenir le fondement d’énoncés àvaleur objectivement universelle. Nous remarquons seulement que ce monde aussi a sapropre vérité, qu’il exige sa propre véracité, et que, si cette vérité, comme dit Ibsen, doitêtre « fondée dans l’essence des choses elles-mêmes », cette essence est vue depuis leprojet de monde artistique. Cette vérité n’a absolument pas besoin d’être enconcordance avec l’essence des choses vue à la lumière de la vie quotidienne ou de lascience, d’autant qu’elle est par ailleurs appelée à approfondir encore la vérité de cetteperspective quotidienne et scientifique.
Ici, quand nous parlons de l’autoréalisation d’Ibsen dans la forme artistique, toute notrequestion doit être d’accéder à une idée plus proche de l’essence véritable de cetteréalisation. De quelle espèce est ce soi qui se réalise dans la forme artistique, de quelleespèce est son processus de devenir, et comment se rapporte-t-il au soi dans le sensexistentiel ou, comme dirait Ibsen, au soi de la conduite de la vie pratique ? Voilà lesquestions vers lesquelles nous devons maintenant nous tourner.
L’oeuvre tout entière, la vie littéraire d’Ibsen, montrent avec quelle intensité, duranttoute sa vie, il a lutté avec ces questions, comment il a toujours gardé une pleineconscience de leur sens et de leurs conséquences pour sa propre existence et pour cellede l’artiste en général. Nous sommes ici devant les questions vitales, véritables, d’Ibsenen tant qu’il est un des grands artistes. De la façon de souffrir et de porter cesproblèmes, dépendent non seulement la vie et la mort de l’artiste mais aussi la réussiteou l’échec de la mission artistique elle-même. Ibsen a trouvé quant à lui les expressionsles plus prégnantes pour cette souffrance et pour cette charge, quand il a reconnu, alorsqu’il avait septante ans, en un regard rétrospectif sur sa vie – lui d’habitude si réservé etsi retenu : « Ma vie a été comme une longue, longue Semaine Sainte ». […]
Texte français Michel Dupuis. Extraits de Le Problème de l’autoréalisation dans l’art, Éditions De Boeck Université/Bibliothèque de Pathoanalyse
[1] Voyez les vers célèbres d’Ibsen : « Vivre veut dire combattre en soi les fantômes des forces obscures ;composer, tenir le jour du jugement au-dessus de son propre moi. »
[2] Voyez Emile Staiger, Grundbegriffe der Poetik, Zürich, 1946. « Style dramatique : tension » (pp. 155
et sv.)
[3] Zwei Goethereden und ein Gespräch, Leipziz, 1932, p.41.
[4] Voyez la lettre rimée à Georg Brandès.
[5] Voyez L. Binswanger, « Le cas Ellen West » in Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie, Volumes LIII, LIV, LV.
[6] Le docteur Stockmann, l’« ennemi du peuple », exprime souvent littéralement les mêmes faits ; il exprime particulièrement clairement la position d’Ibsen dans lemonde. – Comparez avec la déclaration de Goethe à Eckermann (14 avril 1824) : « Ces braves gens m’ont très peu touché, ils m’ont tiré dessus alors que j’étais déjà à des lieues d’eux. »
[7] C’est uniquement cela qui distingue tous les « records » des schizophrènes de ceux du génie !
[8] Dès 1867, il avait écrit à son grand ami : « Non, prends ton temps, carissimo ! Parce que la distance élargit l’horizon, et ensuite parce qu’on sort aussi du même coup de l’horizon des braves gens. Je suis sûr que les gens de Weimar formaient à son époque le plus mauvais public de Goethe. » Un passage des annotations au Neveu de Rameau peut nous indiquer comment Goethe lui-même considérait le « public », et comment Ibsen aussi devait éprouver cela assez douloureusement dans sa propre chair : « Le goût des natures qui ne produisent pas est quand même malheureusement négatif, dénégatif, exclusif, et finalement il prend la force et la vie aux natures qui produisent. »
[9] 31 Voyez Heidegger : « L’étant existant ne se voit que si, d’un même coup, il se saisit dans la transparence de son être auprès du monde et de son être avec autrui, en tant que ceux-ci forment des moments constitutifs de son existence » (Sein und Zeit, p. 146 ; trad. Boehm de Waelhens, Gallimard, 1964).
[10] Seul celui qui ignore la doctrine heideggerienne de la transcendance comme être-au-monde pourra
estimer que cette expression est un pléonasme.
[11] Voyez Wölfflin, Klein Schriften : Hans V. Marées, pp. 75 et sv.
[14] La Chaux-de-Fonds, 1946.
[15] Voyez « Wirklichkeit als Geheimnis und Auftrag », Berne, 1945, p. 76.
[16] Voyez Nietzsche là-dessus : « On est un artiste à condition de percevoir comme contenu, comme « la
chose elle-même », ce que les non artistes appellent la « forme ». Ainsi on appartient certainement à un
monde inversé : car à présent le contenu d’une chose devient quelque chose de simplement formel – notre
vie y compris. ». L’ajout de « notre vie y compris » et sa pénible réalisation valent tout particulièrement pour la « vie » d’Ibsen.
[17] Voyez Hoffmannsthal : » Seul l’opprimé saisit ce qu’est l’esprit », Buch der Freunde 2ème éd., p. 44 et
là-dessus, L. Binswanger, Studia philosophica, Jahrbuch der Schweizerischen Philosophischen
Gesellschaft, vol. VIII, 1948.
[18] Nous faisons complètement abstraction ici de la labilité ou de la fragilité du Beau en tant que tel.
Voyez O. Becker, Von der Hinfälligkeit des Schönen und der Abenteuerlichkeit des Künstlers,
Husserl-Festschrift, 1929.