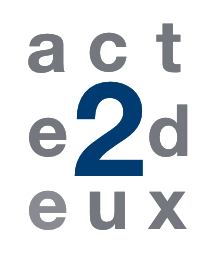Bobby Fischer vit à Pasadena
Lars NorénBobby Fischer vit à Pasadena, de Lars Norén
traduction Amélie Berg
Crée au Kiosque, à Mayenne, le 28 février 2002. Reprise au Théâtre de L’Opprimé à Paris, du 7 mars au 7 avril 2002. Première création de la pièce en France.
mise en scène Claude Baqué
avec Geneviève Esmenard, Isabelle Habiague, Alexis Nitzer, Nicolas Struve
assistante mise en scène Isabelle Antoine / scénographie/lumières Matthieu Ferry / décors Corinne Claret / costumes Nathalie Lecoultre / bande son François Olivier / images Jacques Besse / presse Rémi Fort
production Acte2Deux / coproduction Le Kiosque de Mayenne.
Ce spectacle a reçu l’Aide à la création dramatique de la DMDTS, l’aide au projet de la DRAC Île de France. Il a également reçu le soutien de l’ADAMI et de la Ville de Paris.
Note de mise en scène
Comme dans la pièce de Shakespeare, où Hamlet invite une troupe d’acteurs à représenter devant sa mère et son beau-père une pièce leur donnant à voir le meurtre qu’ils ont commis, le rideau s’ouvre à ce moment précis où les personnages reviennent du théâtre.
Ils sont encore sous le choc. Ils rentrent à la maison, pour boire un verre et parler un peu. Ils éprouvent secrètement le besoin de rester groupés. La mère a été troublée par cette pièce, qui lui a rappelé des souvenirs de sa carrière d’actrice. La fille se demande si finalement elle va rester, mais elle se laisse convaincre. Par son père. Et puis, elle n’a pas revu son frère depuis qu’il est sorti de l’hôpital…
Le quatuor familial est ainsi recomposé, l’espace d’une soirée. Qu’est-ce qu’on boit ? Jus de fruit ou whisky ? Malaise. Cette pièce leur a offert le miroir de ce qu’ils sont devenus. On met de la musique. On sort un album de photos. Les fantômes du passé surgissent alors, et leur cortège de paroles enfouies, qui tiendront le quatuor en éveil jusqu’au bout de cette longue nuit.
Lars Norén prétend que pendant les trente premières pages, il tient la main de ses personnages. Après, il les lâche. Pour écrire sous leur dictée. Pour se laisser conduire vers des zones où il n’aurait jamais pu se rendre seul. La grande force de son théâtre tient en effet dans ces relais de paroles, ces entrelacs de voix qui s’affolent, comme des courants à l’approche d’une zone de faille.
La nouveauté, dans Bobby Fischer, c’est cette extrême proximité de l’abîme. On apprend très vite que le lendemain, pour l’anniversaire de la mort de sa petite fille, Ellen a décidé de se suicider.
Le spectateur est alors convié à une sorte de jeu de l’oie, qui va consister à faire semblant de chercher avec les personnages “ce qui a bien pu se passer pour qu’on en arrive là”. Ils vont envisager une à une toutes les hypothèses que l’auteur – qui a semé les petits cailloux d’usage – leur donne en pâture. Des leurres. Des murs.



Bobby Fischer vit à Pasadena.
Un titre-écran. Une réplique de Tomas l’Autiste, à qui l’on demande ce qu’il compte faire, maintenant qu’il est sorti de l’hôpital. Il répond : « Bobby Fischer vit à Pasadena ». La pièce toute entière est placée sous le chef de cette sorte d’épitaphe comique, de cette phrase de pierre sur laquelle viendront buter toutes les interrogations possibles. Ci-gît un secret. Il y a eu, un jour, dans cette famille, quelque chose à comprendre. Mais quoi ?
Pour le metteur en scène se pose, comme dans Hamlet, comme dans Dom Juan, comme dans toutes les grandes pièces, l’éternelle même question : comment incarner le fantôme ?
Tout est fait, tout est dit, tout est là pour nous égarer. Jusqu’à ce sentiment diffus de confusion mentale, de perte de repères, qui va saisir le spectateur – comme le lecteur – à certains moments de la pièce où il se sentira comme en effraction, et qui sera l’un des effets les plus subtils de ce rideau de fumée lacrymogène que secrètent les familles pour éloigner l’intrus.
Mais cette pièce recèle un étrange pouvoir. Elle agit sur ceux qui l’approchent, comme un oiseau qui pond ses œufs dans le nid des autres. Elle vient habiter en eux, au point qu’ils s’en trouvent comme vidés, comme désaffectés. C’est au prix de ce trouble qu’une sorte de transfert opère, que le secret brisera sa coquille. Il errait comme une image sans support. Il va se révéler dans le corps des acteurs.
Voilà pour le fantôme. Nous ne lui ferons pas traverser le plateau, puisque nous accusons sans preuves, puisqu’il n’est qu’une hypothèse, un pari. Disons que, si les moulins et les arbres sont la preuve du vent, nous ferons en sorte que les têtes tournent et que les corps ploient, pour que s’exhale enfin l’âcre parfum de la chose.
Claude Baqué
Presse Bobby Fischer / Lars Norén
Extraits de presse / Bobby Fischer
« Il y a des pièces, ça ne s’explique pas, qui vous happent d’entrée ; Le miroir que tend le suédois Lars Norén au début de Bobby Fischer vit à Pasadena est du genre diabolique : à peine assis, hop, vous voilà de l’autre côté ; en enfer… Et quand son écriture rencontre un metteur en scène capable de plonger au texte plutôt que de faire des moulinets autour, le résultat est dévastateur. Claude Baqué, qui monte la pièce au Théâtre de l’Opprimé, a le cœur bien accroché, et ses comédiens (Geneviève Esménard, Isabelle Habiague, Alexis Nitzer, Nicolas Struve) encore plus… Dans la petite salle de l’Opprimé, les spectateurs, placés tout près des acteurs, se trouvent au cœur d’une action irrespirable. La lumière est basse, les comédiens jouent tellement justes qu’ils en deviennent irréels, on baigne dans un cauchemar très éloigné de la vulgarité d’un reality show. K.O à l’entracte, on y retourne, comme hypnotisé par les coups. Décidément maléfique, la pièce trouve le moyen, dans sa deuxième partie, d’être drôle. Vous avez dit théâtre à l’estomac ? Toute résistance est inutile. Norén est le plus fort.
René Solis – Libération – 24 mars 2002
« Lars Norén montre avec ce Bobby Fischer vit à Pasadena un sens subtil des dialogues et de la dramaturgie. Car cette pièce est une bombe. La mise en scène de Claude Baqué gère les situations avec beaucoup de finesse et un doigt d’humour salvateur dans la tension. Les comédiens sont tous remarquables, gardant toujours la retenue nécessaire, avec une mention spéciale à Nicolas Struve qui interprète avec une grande précision le personnage du fils schizophrène. »
Hugues Le Tanneur – Aden/Le Monde – 4 avril 2002
« Quand ils déboulent en tenue de soirée dans le salon de cet appartement bourgeois-intello, les quatre personnages de Bobby Fischer vit à Pasadena, pièce du Suédois Lars Norén, reviennent du théâtre. En parlent. Avec excitation. Surtout la mère. Dans sa logorrhée mondaine, on comprend vite qu’elle en fut de cette famille du théâtre. A la fin des quatre actes, les mêmes paraîtront dans une lumière d’un blanc clinique, l’image d’un univers quasi psychiatrique. Que s’est-il passé entre-temps ? Beaucoup de choses, beaucoup de dits et non-dits dans cette famille d’écorchés. Et l’on s’accroche très vite à leur histoire grâce à une mise en scène d’une rare efficacité. Grâce au jeu exemplaire des quatre comédiens. Les échecs qui affleurent de ce magma familial bousculent le spectateur. (…) Rien de sordide dans tout cela. L’humour, à défaut d’amour, n’est jamais loin. Juste un chassé-croisé entre faux-semblants et blessures indélébiles. Beau travail. »
Jean-Pierre Bourcier – La Tribune – 4 avril 2002
« De même que Jon Fosse, son voisin norvégien (mais dans un style différent !), Lars Noren est passé maître dans l’art de faire entendre ce qui ne se dit pas, ce qui ne s’avoue jamais à soi comme aux autres – blessures secrètes, douleurs cachées, désirs refoulés, rancœurs rentrées… enfermés depuis longtemps sous la double chape de la bonne conscience et du contentement de soi. Usant de la psychanalyse comme de la critique sociale, ce sont ces vérités qu’il fait remonter à la surface au fil d’une écriture qui gratte où ça fait mal, taille dans la chair. Metteur en scène, Claude Baqué a créé cette pièce en France au début du mois de mars. C’était à Mayenne. Il reprend ce spectacle pour quelques jours encore à Paris, dans un théâtre «alternatif» (et essentiel!) : le Théâtre de l’Opprimé. Il serait dommage qu’il ne soit pas représenté par la suite ailleurs. C’est qu’ici tout n’est qu’évidence, simplicité savante -du décor (un salon chic, sans chichis ) aux déplacements et au jeu des comédiens (ces «adultes qui font semblant, qui parlent et tournent en rond», comme l’affirme une réplique!). Un air de rien, ils font éclater le vernis des bonnes manières comme des bons (ou mauvais) sentiments pour conduire jusqu’au plus profond désarroi d’être. »
Didier Méreuze – La Croix – 5 avril 2002
« Bobby Fischer vit à Pasadena, en fait un titre écran, qui ne dévoile pas l’histoire ; et l’histoire on va la découvrir petit à petit, puisqu’au début on voit une famille rentrer chez elle, après avoir vu une pièce de théâtre un peu trouble. On voit un père chef d’entreprise, une mère, une fille, un fils. Des gens normaux, bourgeois, comme il faut. Et puis petit à petit on entre dans les liens intimes, les secrets. Et on découvre un père absent, caché dans les soucis de son travail, une mère étonnante d’hypocrisie, qui met en scène ses sentiments, qui a dû renoncer à sa carrière d’actrice pour être mère et femme d’un homme avec qui elle ne couche pas depuis dix-sept ans. On découvre une fille alcoolique, un fils psychotique qui à trente ans vient juste de sortir de l’hôpital. On découvre les fils qui les relient les uns avec les autres, et aussi le vide qui passe entre eux. On découvre comment on fait semblant de vivre, dans une belle maison, avec aussi une maison à la campagne, un voyage à l’étranger programmé pour Noël. On voit, on croit voir une famille, et on voit la carcasse de cette famille. Tout passe à travers les mots de Lars Norén, la tension est constante, le décor est minimaliste, les gestes, les déplacements sur scène aussi. Les comédiens arrivent à faire exister la tension du début jusqu’à la fin. Ils sont étonnants : tout dégringole en finesse, et tout semble tellement vrai. »
Monica Fontini – France Culture – 16 mars 2002
« … Il y a des pièces, ça ne s’explique pas, qui vous happent d’entrée ; Le miroir que tend le suédois Lars Norén au début de Bobby Fischer vit à Pasadena est du genre diabolique : à peine assis, hop, vous voilà de l’autre côté ; en enfer. Et quand son écriture rencontre un metteur en scène capable de plonger au texte plutôt que de faire des moulinets autour, le résultat est dévastateur.… » Lire l’article
René Solis, Libération – 24 mars 2002
Autour de Bobby Fischer / Lars Norén
LA FÊTE NOCTURNE - Interview de l'auteur par Magnus Florin
LA FÊTE NOCTURNE
Magnus Florin : Qu’est-ce qui t’a poussé à écrire pour le théâtre ?
Lars Norén : J’ai commencé à éprouver une violente envie de voir des corps et des mots très proches les uns des autres en un lieu déterminé : je voulais voir des rencontres, ce qui était impossible en poésie. La poésie est une voix. Je n’avais pas la force de prêter mon accent, mes inflexions au message des autres. C’est pour cela que j’ai commencé à écrire pour le théâtre.
M.F. : A quoi voulais-tu arriver ? Enfermer des gens dans un espace et voir comment cela se terminait ?
L.N. : Oui, et ne pas les laisser sortir autrement que par eux-mêmes, les uns par les autres. D’abord, ce fut La Force de Tuer. C’était un vieux rêve qui devint une pièce de théâtre. Un rêve rêvé du début à la fin. Ce ne fut que plus tard que je vis comment la pièce se terminait.
M.F. : Est-ce une position privilégiée, que de pouvoir réaliser cela en tant qu’auteur dramatique ?
L.N. : Oui, mais ce privilège s’achève dès les premières pages d’une pièce de théâtre : les personnages prennent le relais. Pour cette raison, je dois souvent réécrire une pièce tout à fait différente pour arriver à écrire ce que je veux écrire. Les personnages se mettent à faire des choses sur lesquelles je n’ai pas beaucoup d’influence.
M.F. : Désires-tu avoir cette influence ?
L.N. : Oui, c’est le moment le plus important : la conception et la prise en main des personnages jusqu’à la page 20 ou 32, jusqu’à ce qu’ils prennent le relai. À partir de là, il n’y a plus tant à faire. J’ai, par exemple, des notes que j’ai prises depuis plus d’un an sur certains personnages, leur caractère, leur aspect, leur âge, le nom de leur dentiste, le lieu où ils vivent… mais une fois que je suis arrivé à la page 32, je ne profite plus du tout de ce travail, parce que ces personnages vivent par eux-mêmes.
M.F. : Que fais-tu alors ?
L.N. : Alors, je n’écris plus ce qu’ils disent, ce qu’ils font.
M.F. : Qu’implique d’écrire pour l’espace scénique ?
L.N. : Cela implique que je vive de telle sorte que je puisse écrire pour lui. C’est un choix. Il y a des choses que je ne puis faire si je suis auteur dramatique. La poésie, ce sont pour moi de très longs ponts de temps, de simultanéité aussi, la langue se porte elle-même et est portée par elle-même pendant un temps très long. Être auteur dramatique, c’est être dans le présent. Quand j’écris pour le théâtre, j’ai un public donné qui devra être touché par ce qui me touche, c’est ce qui me sert de critère : je vois, en bas, dans l’obscurité de la salle, un public constitué seulement d’enfants. La poésie a une autre portée, plus lointaine. De nombreuses voix y sont faites une, la mienne. Le poète écrit le chant de l’ombre, comme le merle qui entend soudain l’écho de son propre chant et y répond. Au moment où l’on écrit pour le théâtre, en revanche, il y a la présence d’un autre. Et si je ne suis pas touché, cet autre ne l’est pas. C’est moi dans le moment présent, dans l’espace idéal.
M.F. : Est-ce un réveil ?
L.N. : Cela concerne le drame classique qui met en scène des êtres humains, les formes originelles – le père, le fils, la mère. Je pense que le fait d’imaginer comme le ferait un enfant contribue beaucoup à mon envie d’écrire pour le théâtre. Le pouvoir imaginatif de l’enfant nous ramène presque à l’Orestie, le père est roi. Je pourrais me sentir coupable après avoir écrit certains poèmes sur le parricide, coupable d’avoir écrit cela et, d’une certaine manière, de l’avoir effectivement accompli, comme dans La Force de Tuer. À ce moment, je me suis rencontré moi-même dans les mots, et j’ai eu beaucoup de pouvoir.
M.F. : Un drame tel » La Force de Tuer » peut-il être une sorte d’instrument ?
L.N. : Oui. Mais aussi une façon d’entrer de manière conséquente dans le plaisir et de ne pas lui dire non. J’accepte des préjugés, j’accepte qu’on ne dise pas non à des sentiments non acceptés, pour qu’ensuite on puisse leur dire non.
M.F. : Tu parlais de la fête nocturne ? La fête est-elle un lieu où l’on peut tout tenter ?
L.N. : Un lieu où tout est tenté. La fête des disparus, de l’absence ; les absents y sont présents, on les y retrouve ; on les sort du cercueil ou de l’urne ; on est mis en situation de rencontre. (…) La fin d’une pièce de théâtre est aussi une fête : à ce moment, tout est différent, tout est transformé, on peut recommencer. Je peux en hypothèse transformer ma vie chaque fois que je m’assieds pour écrire. Picasso pouvait obtenir une voiture en la dessinant. Je peux écrire des sentiments, ou des choses contre lesquelles je lutte, et c’est une manière de transformer ma vie. La fête, c’est, tout à fait physiquement, de trouver un lieu en soi où l’on puisse parler aux disparus et où ils nous entendent. Cela implique qu’il existe un grand amour entre ces disparus et moi, sinon ce ne serait absolument rien d’agréable. Je ne suis pas lié à eux à cause du thème qu’ils constituent, mais ils viennent à moi parce que ce thème est toujours d’actualité. Lorsque je me suis installé ici, en haut, la première chose que je vis sur le mur, alors que je dormais, ce fut mon père. Et je ne demanderais pas mieux que d’arrêter d’écrire à leur sujet, mais je ne peux pas, ou plutôt ils ne me le permettent pas. Je n’ai pas, à mon mur, de miroir où je pourrais voir qui je suis ; mais lorsque, en écrivant, j’élargis la compréhension que j’ai de moi-même, j’élargis en même temps celle du groupe, de la famille, des absents, des hommes de l’absence.
M.F. : Tes pièces commencent souvent par une indication scénique qui décrit l’espace en détail.
L.N. : Mon rêve, c’est que le même espace soit tout à fait différent à la fin d’une pièce sans que rien n’y ait changé, sans que cet espace se soit par là brisé. (…) Si les personnages peuvent s’en aller, c’est perdu. Ils ne peuvent quitter l’espace. Le seul chemin par lequel ils peuvent s’en aller, c’est par eux-mêmes ou par leur regard sur eux-mêmes et les uns sur les autres. Il n’y a pas de » deus ex machina », il n’existe qu’en eux. En outre, l’espace scénique est pour moi le langage interdit, c’est le corps qu’on a dérobé à quelqu’un, à eux, à nous.
M.F. : Que doit-il s’être passé auprès du public entre le début et la fin de la pièce ?
L.N. : Ce que je cherche, ce n’est pas à faire pleurer les gens, à susciter en eux un malaise, de l’angoisse ; je veux qu’ils soient changés, qu’ils soient un autre, qu’ils ne soient personne lorsqu’ils se lèvent. (…) Le meilleur théâtre est un miroir vide. C’est comme si on laisse aux spectateurs la possibilité de se voir dans un miroir qui n’existe pas. C’est comme une vague qui se retire… c’est quelque chose de si précieux, d’aussi précieux que la vie. (…) Ce que je montre dans mes pièces, ce sont des instants qui sont comme des fouets, ou comme des épées fichées dans le mur, ils n’arrêtent pas de vibrer, vibrent de leur propre force.
Entretien réalisé par Magnus Florin (décembre 1982 – janvier 1983)
Traduction de Elisabeth Brouillard (octobre 1991)