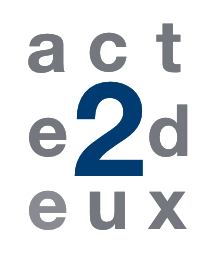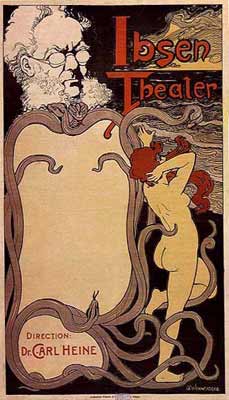 Extrait de L’Écriture chez Henrik Ibsen, de Françoise Decant, Éditions Érès, 2007, p131-140
Extrait de L’Écriture chez Henrik Ibsen, de Françoise Decant, Éditions Érès, 2007, p131-140
Ferenczi s’était beaucoup intéressé à la Dame de la mer, et il était allé jusqu’à faire un rapprochement entre l’intrigue de la pièce et la dynamique d’une analyse mettant le mari, le docteur Wangel, en place de psychanalyste. « On pourrait comparer La Dame de la mer au traitement psychanalytique d’une représentation obsessionnelle », écrit-il à Freud le 17 juillet 1908[1].
Il parle d’un cas de monomanie pour désigner l’obsession qui ravage Ellida, l’héroïne, à savoir un attachement démesuré à la mer. Ellida, « la fille du gardien du phare » surnommée la « Dame de la mer », tant elle aime se baigner, est donc mariée au Dr Wangel, veuf et père de deux jeunes filles, qui l’entoure d’une bienveillante sollicitude. Malgré cela, Ellida n’est pas heureuse. Quelque chose l’attire ailleurs… Mais elle ne sait pas quoi, ni pourquoi…
L’histoire
Le Dr Wangel, inquiet de l’état de santé de sa femme, confie ses craintes à son ami : « Elle est un peu nerveuse depuis quelques années, je n’arrive pas à comprendre ce qu’elle a. On dirait que sa seule vie, c’est de se plonger dans la mer, voyez-vous. » Puis Wangel invite sa femme à lui parler, profitant d’un moment où ils sont seuls : « Nous ne pouvons pas continuer ainsi », lui dit-il, estimant qu’il doit savoir pourquoi elle ne veut pas vivre avec lui « comme sa femme ». Ellida accepte alors de mettre des mots sur ce qui l’oppresse. « Nuit et jour, hiver comme été, elle me submerge, cette vertigineuse nostalgie de la mer ». Wangel, qui a du mal à saisir ce que dit sa femme, lui propose de déménager et de s’installer au bord de la mer, n’importe où, prêt à sacrifier sa clientèle de médecin. Mais Ellida refuse. Elle préfère lui dire « les choses comme elles sont », ou plutôt, précise-t-elle, « comme elles me semblent être ».
Elle va commencer par lui rappeler qu’elle avait aimé un autre homme autrefois, un marin, avec lequel elle avait été fiancée, et qu’elle pense toujours à cet homme, qui avait exercé un singulier pouvoir sur elle. Wangel, que Ferenczi[2] n’a pas hésité à installer en place de psychanalyste, lui propose alors : « Mais il ne faut plus y penser. Jamais » et il ajoute : « Nous essaierons une autre cure pour toi ».
Si la cure de paroles avec l’aveu concernant cet amour de jeunesse a échoué, Ellida rejette la cure maritime et l’air vivifiant de la mer, car ce qu’elle veut, c’est continuer à dire, à parler de ce qui l’envahit. Courageusement, son mari accepte à nouveau de l’écouter. Ce n’est plus d’un amour de jeunesse dont elle entend parler alors, mais de l’effroyable, et avec cet effroyable va être introduit celui qui se nomme désormais dans le texte d’Ibsen « l’Étranger ».
« L’Étranger »
Cet étranger inspire à Ellida une peur si effroyable comme seule la mer peut en inspirer, précise-t-elle. Lorsque Ellida cherche à décrire cet homme, ce marin avec l’épingle de cravate et la perle qui ressemble à un œil de poisson mort qui la regarde, Wangel réalise que sa femme est bien malade. « Tu es plus malade que je ne le pensais », lui dit-il. Ellida le supplie alors de l’aider, car, dit-elle, « Je me sens cernée de toutes parts ».
Le soir même, l’Étranger fait son apparition : s’adressant à, elle, il lui dit, comme s’il l’avait quittée la veille: « Bonsoir Ellida !… Me voilà ! … je viens te chercher. » Mais Ellida est terrorisée: « Les yeux, les yeux… Ne me regardez pas ainsi ! »
Elle demande alors à son mari de la sauver, de la débarrasser de ce qu’elle nomme « cette chose horrible, effroyable » : «sauve-moi de mo-imême », le supplie-t-elle. Wangel, avec une incroyable perspicacité, lui dit : « Ellida, je le pressens, il y a autre chose. » Ellida parle de l’attirance : «Cet homme est comme la mer». Pragmatique, Wangel, une fois l’Etranger parti, pense que cette irruption de la réalité va peut-être faire du bien à sa femme et balayer ce qu’il appelle « ses imaginations morbides », bref la guérir. Mais il se trompe. Ellida est toujours autant torturée par l’angoisse. L’Étranger n’a-t-il pas dit qu’il reviendrait la chercher demain ? Wangel, comme mari, mais aussi comme médecin, affirme dans un premier temps que son devoir est de la protéger, envers et contre tout, même si sa femme s’y oppose. Dans un deuxième temps, il va la laisser choisir.
Ferenczi : le noyau volcanique
Ferenczi résume la fin de la pièce en ces termes : « Le mari comprend que quatre murs peuvent retenir le corps d’un être certes, mais non ses sentiments. Il rend donc à sa femme le droit de disposer d’elle-même, et la laisse libre[3] de choisir entre lui et l’aventurier. Et dès qu’elle est libre de choisir, c’est à nouveau son mari qu’elle choisit. Cette décision librement prise met fin à tout jamais à la pensée torturante de n’aimer son mari que par intérêt[4]. » Par la suite, Ferenczi, qui rapproche la pièce du déroulement d’une analyse, évoque dans un premier temps l’importance de la levée du refoulement : «Le souci ou la pensée inconsciente qui a valu tant de tourments inutiles au malade ne pouvait le troubler que tant qu’il restait dans l’inconscient, à l’abri de la lumière démystifiante de la conscience. »
Mais on sent bien qu’il a perçu que les choses n’étaient pas si simples… Il parle de certains conflits non résolus, puis il évoque tour à tour des maux réels, l’indestructibilité de certains symptômes névrotiques, et il termine son article par la question du deuil qui peut « aussi » prendre deux formes : « Le deuil physiologique et le deuil pathologique ». Mais Ferenczi ne dit pas explicitement à quoi se rapporte cet « aussi». Serait-ce aux deux formes de refoulement qu’il pensait sans vraiment les nommer ?
En effet, on voit bien que la levée du refoulement ne résout pas tout. Ellida est toujours aussi angoissée malgré la révélation faite à son mari de cet amour de jeunesse qui l’obsède. Le noyau central de l’angoisse, lié au refoulement originaire et la jouissance qui s’y rattache est resté intact. Ce noyau central, Ferenczi le compare à un « noyau volcanique », et les termes qu’il utilise alors se rapportent bien à la force de la pulsion ainsi qu’à l’excès de jouissance pulsionnelle qui va être rejeté par le sujet lors du refoulement originaire. Après avoir évoqué le caractère « indestructible » des symptômes nèvrotiques, Ferenczi écrit : « Le complexe dissimulé dans l’inconscient, tel un noyau volcanique, se remplit sans cesse d’énergie, et lorsque 1a tension atteint un certain niveau, de nouvelles éruptions se produisent[5]. » Nous sommes bien dans le pulsionnel…
Mais revenons à La dame de la mer, pièce dont le titre avait été annoncé quelque trente ans plus tôt sous forme d’une hallucination, dans le poème lyrique d’Ibsen, Peer Gynt[6], lorsque Peer, le héros, croit voir figurée « une dame de la mer» sur le fronton de la cabane où se trouve Solvejg, l’objet incestueux, au moment où l’angoisse l’envahit.
Le nouage du sexuel au réel de la mort.
Dans ce très beau texte d’une saisissante sensualité, Ibsen va nouer le sexuel au réel de la mort, et ce nœud, c’est un marin qui va s’en faire le représentant.
La mer, l’une des figures de la mère empruntée au symbolisme, est cet étrange objet de fascination mortifère.
Ellida ne comprend pas plus que son mari, le Dr Wangel, pourquoi elle est attirée par la mer, mais, grâce à lui, qui l’invite à dire, elle, va tenter de mettre des mots sur ce qui ne cesse de l’envahir : « Nuit et jour, hiver comme été, elle me submerge, cette vertigineuse nostalgie de la iner ». Lorsqu’elle écarte l’idée d’aller vivre au bord de la mer, car, dit-elle, « Je le sens, même là-bas, je ne pourrai m’en débarrasser », son mari lui demande, étonné : «De quoi parles-tu ? » Ellida lui fait cette réponse « De l’effroyable, de ce pouvoir incompréhensible sur mon esprit. »
Wangel ne comprend pas. Que veut-t-elle dire ? Les paroles de sa femme résonnent de façon tellement énigmatique ! Mais comment pourrait-il en être autrement au moment même où Ellida tisse quelque chose entre l’effroyable, son attirance pour la mer, et la peur de cet homme qu’elle a aimé… Ellida dit alors: « Une peur si effroyable comme seule la mer peut en inspirer… » Et lorsque Wangel dit comprendre pourquoi sa femme se refusait à lui et ne voulait pas vivre avec lui « comme sa femme », n’est-ce pas parce qu’il a repéré le caractère sexuel de cette attirance pour la mer ?
Mais Ellida est terrorisée : la jouissance pulsionnelle qui fait retour se présente sous la forme d’un œil… qui la regarde. Ellida se sent cernée de partout et fait appel à son mari pour qu’il l’aide. Mais pourquoi ne s’est-elle pas confiée plus tôt ? Ellida : « Si je m’étais confiée à toi, alors il aurait fallu que je te confie aussi le – ». Ellida marque une pause traduite dans le texte par ce tiret : l’indicible.
L’indicible : « Le désir de l’impossible »
L’irruption en chair et en os de l’Étranger ne va pas empêcher Wangel de continuer à pousser sa femme à dire… Un dialogue s’engage. Mais d’abord, que sait-elle de lui, de cet Etranger ? Rien.
Ellida : C’est vrai, c’est cela l’effroyable.
Wangel : Oui, c’est effroyable.
Ellida : Et c’est pourquoi je dois m’y précipiter.
Wangel : Parce que c’est effroyable
Ellida : Oui, pour cela.
Wangel (s’approchant) : Écoute-moi Ellida, – qu’entends-tu par effroyable?
Ellida (réfléchissant) : L’effroyable – c’est ce qui fait peur et qui attire.
Ébranlé, Wangel se ressaisit et fait valoir son devoir de la protéger.
Ellida : « Me protéger ? Contre quoi ? Je ne suis menacée par aucune violence, par aucune puissance extérieure. L’effroyable, c’est plus profond, Wangel ! L’effroyable – c’est l’attirance qui est au fond de mon âme. Que peux-tu faire contre elle ? »
Et lorsque l’Étranger revient pour la deuxième fois chercher Ellida, et que son mari tente de la retenir, elle lui dit : « Tu peux me retenir, mais mon âme, mes pensées, – mes envies et mes désirs – eux, tu ne pourras pas les enfermer. Ils continueront à s’envoler vers l’inconnu. »
Et là où les critiques ont vu un discours en faveur de l’émancipation féminine, Ibsen, dans une formule concise, épingle le réel du côté de l’impossible.
Wangel : « Ce désir du sans fin, du sans bornes, ce désir de l’impossible, il précipitera ton âme dans les ténèbres de la nuit. »
L’histoire se déroule en Norvège, dans « le pays où le monde passe pour aller contempler le soleil de minuit ». Nous sommes en 1888. Si Freud a déjà rencontré Charcot et Breuer, il a à peine commencé d’écrire. La psychanalyse en est à ses balbutiements. D’ailleurs, c’est du théâtre, rien que du théâtre… Où pourtant chaque mot compte… Freud, qui s’est intéressé à Rosmersholm, semble être passé à côté de texte dont il avait pourtant entendu parler par ses disciples, Ferenczi et Jung.
Jung : le nœud n’est pas dénoué mais tranché…
Car Jung aimait aussi beaucoup ce texte d’Ibsen. Dans une longue lettre datée du 10 octobre 1907[7], il entend entretenir Freud d’un « esthétiquement beau » copiant exactement La dame de la mer d’Ibsen lui écrit-il. « La construction du drame, la façon dont le nœud est agencé sont identiques à Ibsen, mais la péripétie et le dénouement ne mènent pas à la libération de la libido, mais au crépuscule de l’autoérotiseme, où le vieux dragon s’empare à nouveau de toute la libido qui lui appartient ». Et il ajoute « le nœud n’est pas dénoué, mai tranché ». Puis il évoque le cas de sa patiente pour revenir finalement à un autre nœud, qui est le nœud du transfert…
Le transfert qu’elle fait sur lui, s’il a pour conséquence de modifier l’humeur de cette jeune femme déprimée, amène également « l’irruption d’une violente excitation sexuelle »… Tout de suite après, Jung dit vouloir passer à « autre chose » et fait appel à Freud : « J’aimerais vous demander votre conseil expérimenté dans « une autre affaire. » Et il expose l’affaire : «Une dame guérie d’une névrose obsessionnelle fait de moi l’objet de ses fantasmes sexuels excessifs. Elle reconnaît mon rôle dans ses fantasmes comme maladif et aimerait par conséquent se détacher de moi et refouler ses fantasmes. » Jung est perplexe : « Que faut-il faire ? Faut-il poursuivre le traitement, qui procure à la patiente, elle l’avoue elle-même, un plaisir voluptueux, ou faut-il la repousser ? » Et il termine par cette question : « Ce cas vous est certainement familier jusqu’au dégoût; que faites-vous dans de tels cas ? »
Le retour de la libido grâce aux fantasmes sur la personne de l’analyste via le transfert ne nous paraît pas aussi éloigné que cela de ce qu’Ibsen amène dans son texte par le biais du travail d’écriture.
Le tissage du fantasme
En incitant sa femme à, dire, sous prétexte de vouloir la libérer de ses symptômes, et en particulier de cette angoisse qui ne la quitte pas, Wangel ne l’invite-t-il pas à tisser le fantasme qui va lui permettre de tenir quelque peu à distance ce réel oppressant qui la cerne de toutes parts ? Mais d’abord, cet effroyable, cet incompréhensible, qui revient du dehors, lourd d’angoisse, mais qui la fascine, ne s’est-t-il pas constitué à partir d’un rejet ? Or, si c’est la signification phallique qui est rejetée en raison de son lien à l’angoisse de la castration maternelle, n’est-il pas logique que ce qui revient hanter le sujet sous la forme d’un désir qui insiste, soit accompagné d’angoisse ?
Ce marin, l’Étranger, comme le nomme si bien Ibsen, n’incarne-t-il pas parfaitement l’une de ces « doublures errantes qui réclament leur dû », pour reprendre l’expression de Gérard Pommier[8] ?
Lorsqu’il vient chercher Ellida, faisant fi du temps qui s’est écoulé et du mari, montrant que rien ne peut l’arrêter dans sa détermination, il lui dit tout simplement : « Me voilà, suis-moi!» Son apparition brutale, aussi violente que les flots tumultueux qui étaient censés l’avoir englouti, signe le retour du déchaînement de la jouissance pulsionnelle.
En le voyant, Ellida est prise d’effroi : « Les yeux, les yeux… ne me regardez pas ainsi ! »
Mais l’apparition du marin n’est pas seulement liée au retour du pulsionnel. En lisant attentivement le texte, on s’aperçoit qu’il est aussi question des yeux de ce marin avec la naissance d’un enfant qu’Ellida a attendu mais qui est par la suite décédé. Elle avoue à son mari que cet enfant avait les yeux du marin, aménageant ainsi à ce marin une place de père.
C’est un bien savant nouage que nous propose Ibsen. Il s’y connaissait en nœuds… marins ou pas ! Le marin est à, la fois le Réel c’est-à-dire «l’Etranger, l’Hôte qui est en nous », pour reprendre la citation de Cocteau, et un père fabriqué de toutes pièces par Ellida, tissé dans les mailles du fantasme. Que ce père se présente sous les traits d’un père aussi attirant sexuellement que violent n’a rien d’étonnant, puisque sa présence est en rapport avec l’angoisse de la castration maternelle.
Ubiquité de ce personnage envoûtant, qui, parce qu’il est le rappel de l’amour maternel et de son énigmatique désir, traîne au- dessus de lui, non seulement « les puissances de la mer » mais aussi la présence « des ailes noires et silencieuses » de la mort. Et ce, jusqu’au moment où Ellida peut lui dire, parce que le père primitif a cédé 1a place au père mort : « Pour moi, vous êtes mort. Un mort sorti de la mer qui retourne. »
Mais pour ce faire, une série d’actes a été nécessaire, au moins trois actes.
Les actes du sujet
Le premier – afin qu’Ellida puisse subjectiver ce réel effroyable- lui a demandé l’effort de sortir de cette place d’objet qu’elle pointe lorsqu’elle reproche à son mari de l’avoir achetée comme une marchandise. Si elle accepte l’idée qu’elle a bien voulu se vendre, elle veut maintenant qu’il lui rende sa liberté. Beaucoup de choses ont été écrites concernant cette histoire de liberté, liberté féminine, liberté dans le couple, la Liberté avec un grand L, mais il nous semble que seule la nécessité du passage d’une place objectivante (par le désir de l’Autre) à une place subjectivée en rapport avec le tissage du fantasme peut permettre de comprendre pourquoi tout à coup après tant d’années de mariage, Ellida fait ce grief à son mari.
Le deuxième acte, c’est le mari qui va le poser, à la fin de la pièce. Alors que dans un premier temps, il n’avait pas voulu rendre la liberté à sa femme, tentant ainsi de s’opposer à ses pulsions destructrices, et voulant la protéger malgré elle, dans un deuxième temps, il change de position et accepte de rendre la liberté à sa femme, qui, surprise, lui demande : « C’est vrai, tu peux, – tu peux faire ça[9] ! »En acceptant de la perdre, le Dr Wangel fait barrage au désir incestueux d’Ellida et la sauve du gouffre dans lequel elle était prête à se précipiter. Il fait coupure.
Le troisième acte, qui relève de la symbolisation, concerne le fait qu’Ellida, se saisissant de la liberté que son mari lui octroie, va pouvoir en « toute responsabilité » opérer un changement au niveau des différentes instances paternelles, faisant passer ce père primitif inventé, au rang de père mort, de père symbolique, et ce, par le biais d’un meurtre : « En toute liberté et en toute responsabilité », dit-elle à son mari, en ajoutant : « Il y a là comme une transformation. »
S’adressant à l’Étranger, elle lui dit alors d’une voix assurée : « Je ne vous suivrai pas. Pour moi, vous êtes un mort sorti de la mer et qui y retourne. Je n’éprouve plus d’effroi devant vous. Ni d’attirance. » Et considérant que son mari avait été un bon médecin, elle lui adresse ces paroles : « Tu as osé employer le bon remède : le seul qui pouvait me guérir. »
À l’inverse, dans Hedda Gabler, Tesman, le mari, entièrement occupé à la tâche qui le tient, va, sans en mesurer les effets ravageurs, livrer sa femme à la jouissance du juge Brack, la livrant du même coup à, la mort : « Vous viendrez rendre visite à ma femme ! », demande Tesman au juge, sachant combien lui, sera désormais occupé par son travail.
Le juge Brack : « Tous les soirs, si vous voulez, Mme Tesman ! Nous nous amuserons bien tous les deux ! » Et avant de mettre fin à ses jours, Hedda répond au juge : « Oui, c’est bien ce que vous espérez, Monsieur le juge ? seul coq du poulailler[10]…»Le père de la horde n’est pas loin…
[1] S. Freud-S. Ferenczi, Correspondance, t. 1, p. 18.
[2] S. Ferenczi, « Suggestion et psychanalyse », Œuvres complètes, t. 1, p. 236-237.
[3] Nous verrons plus loin ce qu’évoque pour nous cette histoire de liberté…
[4] S. Ferenczi, op. cit.
[5] S. Ferenczi, op. cit.
[6] H. Ibsen, Peer Gynt, op.cit., Acte V, scène V, p. 173.
[7] S. Freud-C. Gjung, Correspondance, t. 1, p. 145.
[8] G. Pommier, Qu’est-ce que le « Réel » ?, Toulouse, érès, 2004, p. 15.
[9] Voici ce qu’écrit jean- Richard Freymann dans son livre Les Parures de l’oralité (Arcanesérès, 1994) : « Peut-il me perdre ? est la formulation élaborée qui assoit les fantasmes d’exclusion dans une reconnaissance implicite de cette place du désir au-delà de la demande. » (Chapitre « Zurücksetzung et Urteil ou du fantasme à la séparation », p. 25.)
[10] H. Ibsen, Hedda Gabler, op. cit., p. 265.