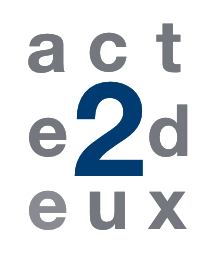Extrait de Drame des sexes, de Sylviane Agacinski
Extrait de Drame des sexes, de Sylviane Agacinski
La Librairie du XXI siècle, Seuil, 2008, p55-59
La Dame de la mer (1888)[1] est une pièce à part. C’est la seule œuvre dans laquelle Ibsen ose traiter directement de la folie du désir, même si c’est pour mieux en programmer la guérison. Je ne peux m’empêcher d’y voir le pendant de Brand, comme si, à la démesure de la spiritualité et au conflit du ciel et de la terre, répondaient ici la démesure du désir sauvage et un conflit de la mer et de la terre. Cette fois, pourtant, la raison l’emportera sur le désir impossible. Mais l’appel de la mer, aussi intraitable que l’était celui du ciel pour Brand, vient ici de la nature et non de l’Au-Delà, et il donne à cette pièce une dimension poétique païenne et non chrétienne.
Ellida, la « Dame de la mer», est la proie d’une «vertigineuse nostalgie[2]» de la mer, nostalgie associée à la passion qui la lia jadis à un marin étranger. Ce lien l’enlève à l’amour solide mais prosaïque de son mari, le docteur Wangel, et la plonge dans l’angoisse lorsque le marin revient la chercher.
Ellida éprouve d’autant plus la fascination de l’océan, du grand large, qu’elle se sent à l’étroit dans une vie passive. Alors qu’elle subit avec angoisse l’attraction de la mer et celle du marin, son mari croit d’abord pouvoir la protéger lui-même de l’étranger. Dans un premier temps, il ne songe même pas qu’Ellida puisse décider elle-même de sa vie. Elle est sa femme, elle lui appartient, et c’est à lui de chasser l’étranger qui prétend aimer Ellida et être aimé d’elle : « Ma femme n’a aucun choix à faire, déclare-t-il au marin. C’est à moi de choisir et de la protéger. » Ellida connaît sa condition d’épouse: «Tu peux me retenir – tu en as le pouvoir et les moyens […] mais mon âme, – mes pensées, – mes envies et mes désirs, – ceux-là, tu ne pourras pas les enfermer»[3]. Wangel lui laissera finalement choisir sa voie elle-même. C’est au moment précis où elle peut exercer sa liberté que se produit en elle une métamorphose. Le marin n’est plus un rêve, il n’est plus l’image pure d’un ailleurs, le fantasme de l’illimité et de l’ouvert, mais une possibilité réelle : elle peut partir avec lui si elle le veut. Ce n’est qu’au cinquième acte qu’elle cesse d’être captive de son rêve: «J’ai pu choisir, c’est pourquoi j’ai pu y renoncer. »
Faut-il croire cependant, avec Wangel, que la nostalgie de la mer n’était rien d’autre qu’un «désir naissant de liberté»? Qui pourrait jurer qu’Ellida est définitivement « guérie » de cette fascination, et que cette attraction elle-même était essentiellement morbide ? La liberté de choix est une chose belle et essentielle, mais le mystère de l’océan, sa profondeur, la puissance de son flux et de son reflux, et l’attrait qu’il exerce sur la sensibilité d’Ellida, ne peuvent valoir uniquement comme le symbole d’autre chose. De fait, Wangel connaît la passion de sa femme pour la mer : lorsqu’elle le rejoint, il l’accueille par un « Tiens, voilà, la sirène ! » (acte I).
Comment ne pas reconnaître que la Dame de la mer est fascinée par la chose même: la mer, l’océan lui-même? Le désir que le marin lui a jadis inspiré prenait d’ailleurs sa source dans leur passion commune de la mer, des marées, des oiseaux, des dauphins et des phoques. La mer, où les deux amants du large avaient jeté leurs anneaux réunis pour célébrer leur union, est d’abord une réalité élémentaire. Elle est ce monde mouvant, vivant, immense, d’où toute vie est originaire. Il y a, dans la nostalgie de la mer, la trace d’une profonde mélancolie des hommes arrachés jadis à l’élément liquide pour vivre sur la terre ferme. On peut aussi penser au liquide maternel d’où sort tout être humain, mais la nostalgie de la vie intra-utérine n’exclut pas celle d’un élément beaucoup plus vaste et plus ancien. On sait que la mer avait sur Ibsen lui-même un fort pouvoir d’attraction. L’angoisse d’Ellida peut alors se comprendre comme l’effet d’un déchirement entre un désir de liberté conduisant à être soi, désir d’autodétermination, donc d’autolimitation, d’autonomie, et un désir du large, de l’infini d’un monde marin où s’abolissent les limites terrestres, les fjords étroits et les contraintes sociales. Cette nostalgie a sa puissance et sa vérité propre, en même temps qu’une valeur allégorique.
La nostalgie entre en scène, au tout début de la pièce, à travers une légende : un peintre cherche un modèle pour la sirène « à moitié morte» qu’il veut représenter dans un paysage. Pourquoi « à moitié morte ? » lui demande-t-on : parce qu’elle s’est égarée dans le fjord et n’a pu retrouver le chemin de la mer, alors « elle agonise dans l’eau saumâtre»[4]. Le désespoir mortel de cette sirène ressemble à un sentiment d’exil, mais de nature païenne. Il y a une forme chrétienne du sentiment de l’exil, une nostalgie de l’infini face à tout ce qui est borné et fini. Mais la mélancolie chrétienne, tournée vers le ciel, comme celle de Brand, ou celle, métaphysique, de l’âme exilée dans un corps dans les textes de Platon, rejette l’animalité de l’homme, alors que, avec son corps à demi bestial et marin, la sirène est un être vivant et sensuel. Elle appartient au monde de la nature et de cet océan, en lequel Michelet voyait « la grande femelle du globe[5]».
La nostalgie de la mer s’associe à l’attraction sexuelle d’EIlida pour le marin, comme si son goût pour l’océan (elle adore s’y baigner) et son désir de l’étranger révélaient un même désir de se perdre. Ou plutôt, la perte a déjà eu lieu – Ellida se sent appartenir à la mer comme à l’étranger, l’une et l’autre exerçant sur elle la même attraction : « Cet homme est comme la mer. » Il s’agit donc de l’amour, du désir tel qu’il a de tout temps été vécu et décrit : captation, exil, aliénation. Ellida est emportée ailleurs par son désir, au large, elle ne s’appartient plus, elle est à un autre, et pourtant elle demande à son mari de la sauver de cet amour sauvage qui menace son individualité.
La puissance du désir sexuel est toujours féminine chez Ibsen. Lorsque Rebecca West, dans Rosmersholm, avoue à Rosmer qu’elle avait éprouvé pour lui un violent désir, c’est l’image de la mer qui s’impose à elle : « Cela s’est abattu sur moi comme une tempête sur la mer. Une de ces tempêtes que nous connaissons en hiver, là-haut, dans le nord. Ça se jette sur vous et vous emporte, tu comprends, – vous emporte jusqu’au bout du monde. Rien ne sert d’y résister[6]. »
Ellida est prise elle aussi dans la tempête d’un désir auquel elle ne peut s’opposer (alors que sa volonté la porte vers la terre ferme et vers son mari), un désir dont la nature sexuelle se laisse facilement percevoir puisqu’elle avoue à Wangel être « face à l’effroyable», c’est-à-dire à «ce qui fait peur et qui attire, qui attire surtout»[7].
Cette inquiétante fascination erotique est présentée comme une maladie, et le docteur Wangel se montrera « un bon médecin ».
Ce qui est redoutable, dans la force de l’attraction sexuelle, dans l’hypnose où elle plonge, c’est la menace qu’elle fait peser sur le sujet, sur la maîtrise et la disposition de soi. Dans sa forme passionnelle, le désir est l’expérience d’un transport hors de soi. Il se situe à l’opposé absolu de la liberté de choix, de la liberté de décision. Le drame de la Dame de la mer est là, dans le conflit entre le désir de liberté de qui aspire à être soi-même, et la liberté du désir, qui, à l’opposé, est le mouvement vertigineux de qui ne s’appartient plus. Cette liberté du désir qui tourne le sujet ailleurs, vers l’autre, vers le mystère et l’étranger, prend la forme d’une nécessité qui emporte tout. Elle a la force impersonnelle d’un instinct ou d’un destin. Le désir sexuel est source d’angoisse dans la mesure où son flot compromet la stabilité du sujet volontaire et construit.
Brand allait jusqu’au bout de sa logique, jusqu’à sa chute. Ellida cède aux lois d’une vie plus sage – comme si Ibsen faisait reculer son personnage devant la puissance de l’attrait erotique où il risque de s’abîmer.
[1] In Les Douze Dernières Pièces, op. cit., vol. III.
[2] La Dame de la mer, op. cit., acte II.
[3] Ibid., acte V.
[4] Ibid., début de l’acte I.
[5] In La Mer {1875).
[6] Rosmersholm, op. cit., acte IV.
[7] La Dame de la mer, op. cit., acte IV.