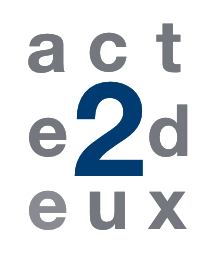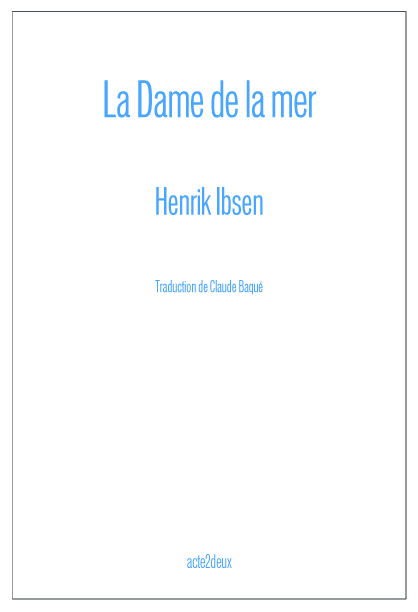François Flahault. « La Sirène aux frontières de l’infini »
 La sirène aux frontières de l’infini
La sirène aux frontières de l’infini
François Flahault
Directeur de recherche au Centre de recherches sur les arts et le langage, CNRS-EHESS
Notre âme, dis-je, est comme contrainte de s’écrier :
« Je ne suis donc pas faite pour le monde puisque
le monde n’est pas assez grand pour moi ! »
Saint François de Salles, Traité de l’amour de Dieu, Livre 1, chap. XV
« Le chant des sirènes ». Ces deux mots évoquent encore aujourd’hui le tableau dont un passage de l’Odyssée imprima les traits essentiels dans la culture occidentale. Circé met en garde Ulysse :Tu passeras d’abord près des Sirènes, dont la voix
Charme tous les humains qui se présentent devant elles.
Mais bien fou qui s’approche et prête l’oreille à leurs chants !
Il ne reverra plus jamais sa femme et ses enfants
Faire un grand cercle autour de lui et fêter son retour ;
Les Sirènes le charment de leurs voix mélodieuses,
Assises dans un pré ; et l’on voit traîner autour d’elles
Les os des corps décomposés, dont les peaux se dessèchent[1].
Les sirènes ont depuis longtemps échangé pour une queue de poisson le corps d’oiseau que leur prêtaient les anciens Grecs, mais elles n’ont rien perdu de leur séduction fatale. Les sirènes, écrit Andersen dans son fameux conte, « avaient des voix enchanteresses comme nulle créature humaine, et si, par hasard, quelque orage leur faisait croire qu’un navire allait sombrer, elles nageaient devant lui et entonnaient des chants magnifiques sur la beauté du fond de la mer, et encourageaient les marins à ne pas avoir peur d’y descendre ». Mais « lorsque le bateau sombrait, les hommes se noyaient, et leurs cadavres seuls arrivaient au château du roi de la mer ». Quelques pages plus loin, Andersen évoque le macabre spectacle : « Dans les bras des polypes, on apercevait des squelettes blancs, c’était tout ce qui restait d’hommes qui avaient péri en mer et qui avaient sombré clans les profondeurs.[2] » Cependant, l’héroïne du conte La Petite Sirène ne ressemble pas à ses sœurs : lorsqu’elle verra un jeune homme s’abîmer dans les flots elle lui portera secours. Il y a séduction fatale, comme dans toutes les histoires de sirènes, mais cette fois l’attraction s’inverse : c’est la sirène qui est séduite par le jeune homme. Cette sirène, nous le verrons, connaît une véritable conversion : elle appartenait à un folklore païen, Andersen en fera une icône du christianisme romantique. D’innombrables récits tournent autour de l’union entre un être humain et un personnage surnaturel. Il n’est pas difficile de comprendre le pouvoir que ce thème exerce sur nous : dans la réalité, nous ne parvenons qu’à des formes d’accomplissement finies, relatives, mais l’espace du récit nous fournit une compensation en nous permettant de franchir la frontière qui sépare le fini de l’infini. Cependant, contes, légendes ou croyances ne se contentent pas de mettre en scène un dépassement de l’existence ordinaire, ils prennent position. Tantôt en effet ce franchissement est présenté comme une transgression, certes séduisante, mais funeste ; tantôt au contraire il ouvre la voie à une véritable réalisation de soi. Il sera surtout question ici du conte La Petite Sirène et d’un autre récit publié vingt-cinq ans plus tôt (en 1811), Ondine, de Frédéric de la Motte-Fouqué. Ces histoires de sirène ou d’ondine présentent un caractère dramatique. La part de nous-mêmes qu’elles font résonner, on pourrait l’appeler « la contradiction du rêve d’amour ». En quoi celui-ci est-il contradictoire ? D’un côté, désirer aimer, c’est désirer occuper une place par rapport à un autre être – place d’homme par rapport à une femme ou de femme par rapport à un homme, par conséquent une place limitée. Mais le rêve d’amour est également un rêve de complétude, d’infini, d’absolu. La contradiction réside en ceci qu’il est impossible de se réaliser à la fois dans l’infini et le fini, impossible de se réaliser de manière illimitée tout en occupant une place définie et relative à la place occupée par l’autre. C’est souvent au moment de l’adolescence qu’est vécue le plus intensément la tension entre, d’un côté, le désir d’être comblé par l’amour et, de l’autre, la nécessité de renoncer à ce mirage de plénitude pour devenir soit un homme soit une femme. Mélange d’exaltation, de détresse et de confusion dans les relations avec les autres. Cependant, ondines et sirènes ne mettent pas seulement en scène cette croisée des chemins du désir : je l’ai dit, elles prennent parti. Nous verrons en effet que les histoires de nymphes, d’ondines ou de sirènes ne privilégient pas le même versant du rêve d’amour (et par conséquent donnent à l’infini une valeur tantôt négative tantôt positive) selon qu’il s’agit d’un récit païen, d’un récit partiellement christianisé ou d’un récit qui célèbre l’idéal chrétien. Revenons un instant à l’Odyssée. Parmi les différents épisodes qui font courir à Ulysse le risque d’un non-retour à Ithaque, celui-des sirènes n’est pas le seul qui l’expose à la séduction. Longtemps avant de rencontrer celles-ci, Ulysse a été recueilli par Calypso. La nymphe l’oblige à rester auprès d’elle car elle désire « s’unir au mortel que son cœur a choisi pour époux ». Cependant, sur l’ordre de Zeus, elle le laisse repartir. Non sans le mettre en garde :Mais si ton cœur pouvait savoir de combien de chagrins
Le sort doit te combler avant ton retour au pays,
Tu resterais à mes côtés pour garder ce logis
Et devenir un dieu, malgré ton désir de revoir
Une épouse à laquelle se raccrochent tous tes vœux.
Je me flatte pourtant de n’être pas moins séduisante
De stature et de port, car nulle femme ne saurait
Rivaliser, quant au physique, avec une Immortelle.[3]
Que serait-il arrivé si Ulysse, cédant à la séduction, était resté chez la nymphe ? C’est là une hypothèse qu’explore un type de contes répandu de l’Europe jusqu’au Japon, Le Pays où l’on ne meurt pas. On y voit un jeune homme atteindre le pays d’immortalité. Celui-ci se présente souvent comme une île lointaine où le héros coule des jours heureux aux côtés d’une femme surnaturelle. Cependant, le désir lui vient de revoir ses parents. Sa compagne y consent. Mais au pays des humains, des siècles ont passé : les siens ont depuis longtemps disparu, et lui-même meurt. En somme, il vaut mieux résister à la double séduction de la femme surnaturelle et de l’immortalité, comme il faut résister au chant mortifère des sirènes. L’Odyssée, le conte du Pays où l’on ne meurt pas procèdent d’une conception païenne de l’être humain : la place de celui-ci est du côté du fini, et ce n’est donc pas impunément qu’il franchit la frontière de l’infini. Abordons maintenant un récit en partie christianisé : Ondine, de Frédéric de La Motte-Fouqué (écrivain allemand descendant d’émigrés français). Ici, à l’inverse de ce que nous venons de voir, les humains ont droit à l’immortalité et c’est l’ondine qui aspire à jouir du même privilège. Voici un résumé de cette longue nouvelle : Sur une langue de terre qui s’avance dans un lac se trouve une chaumière, isolée par une forêt que personne n’ose traverser sans nécessité. Un vieux pêcheur et sa femme y vivent. Leur fille adoptive, Ondine, n’a pas encore dix-huit ans. Le couple eut jadis une petite fille, mais celle-ci disparut dans le lac. Le soir même, le pêcheur et sa femme trouvèrent, ruisselante à leur porte, une enfant ravissante. C’était Ondine. Un chevalier nommé Huldbrand arrive à la chaumière où on lui donne l’hospitalité. Sur la demande de Bertalda, sa dame, il vient de traverser la forêt aux sortilèges. Ondine se montre espiègle, fantasque et instable – à la fois irritante et attachante. Hudbrand et Ondine s’aiment. Un prêtre dont la barque a fait naufrage et qui, lui aussi, a trouvé asile dans la chaumière, les marie. Le lendemain des noces, Ondine, toute changée, apparaît d’une grande douceur. Elle avoue son secret à son mari : elle est une ondine, créature sans âme, mais qui peut en obtenir une à condition qu’elle gagne l’amour d’un homme. Huldbrand ramène chez lui sa jeune épouse. Durant la traversée de la forêt, l’oncle d’Ondine, Kuhieborn, se manifeste d’une manière troublante. Ondine lui demande de la laisser en paix. Le couple retrouve Bertalda, dont les sentiments pour le chevalier ne se sont pas éteints durant son absence. En dépit de cette situation, Ondine et Bertalda se sentent attirées l’une par l’autre. L’oncle d’Ondine l’informe que Bertalda, adoptée par un duc, est en réalité la fille du couple de pêcheurs par qui elle-même, Ondine, fut adoptée. Ondine transmet à Bertalda cette révélation, pensant naïvement que celle-ci lui en saura gré. Mais Bertalda se sent humiliée et ne peut se résoudre à considérer ces pauvres gens comme ses parents. Ondine, Bertalda et Huldbrand se rendent au château de ce dernier. Nouvelles manifestations déplaisantes de Kuhieborn, repoussé par Ondine. Le temps passe. L’amour du chevalier se déplace vers Bertalda, pour le plus grand chagrin de la douce Ondine. Afin de parer aux possibles représailles de son inquiétant protecteur et oncle, celle-ci fat poser une lourde pierre sur la margelle d’un puits qui se trouve dans la cour du château. Bertalda proteste : l’eau de ce puits, bonne pour son teint, est nécessaire à sa toilette. Mais Ondine confie à son époux la raison de ses ordres et celui-ci l’approuve. Mortifiée, Bertalda s’enfuit. Huldbrand part à sa recherche dans la vallée noire et finit par la retrouver. Kuhieborn se manifeste alors sous les apparences d’un charretier secourable. Mais, alors que les eaux d’un torrent gonflent, le charretier et son attelage se métamorphosent en écume. Huldbrand et Bertalda vont être engloutis lorsque Ondine apparaît et calme le flot. Le trio part à Vienne en bateau. De nouvelles manifestations de l’ondin irritent Huldbrand. Alors que Bertalda s’amuse à laisser traîner dans le fleuve un collier d’or donné par le chevalier, Kulheborn s’en saisit. Ondine met la main à l’eau et se fait apporter à la place un magnifique collier de corail, mais Huldbrand, pris de colère, le rejette dans le fleuve. Alors Ondine, en pleurs, disparaît à son tour après avoir prononcé ces paroles : « Hélas ! Sois-moi fidèle!» Huldbrand projette de se remarier avec Bertalda. Il ignore qu’Ondine devra alors, conformément aux lois des ondins, tuer l’infidèle. Le mariage est célébré. Le soir même, Bertalda, se regardant dans un miroir, aperçoit sur son cou des taches de rousseur ; elle ordonne d’ôter la pierre qui scelle le puits afin d’en utiliser l’eau pour se laver. Mais le puits rouvert, Ondine en surgit devant les serviteurs glacés d’effroi. De son côté, Huldbrand, lui aussi devant son miroir, ne tarde pas à voir s’y refléter Ondine, qui pénètre dans sa chambre. Il meurt dans un baiser d’elle. « Mes larmes l’ont tué », dit Ondine en s’éloignant. La Motte-Fouqué a puisé dans le même fonds légendaire qui avait déjà inspiré à Goethe un poème dans lequel on voit disparaître un pêcheur, attiré par le chant d’une sirène. Ces récits ne distinguent guère entre ondines, nymphes, sirènes, sylphides et fées. Dans De l’Allemagne, à propos du Pêcheur de Goethe, Mme de Staël parle d’une nymphe et non d’une sirène. Plus loin, elle évoque « un opéra que l’on donne sur tous les théâtres, d’un bout de l’Allemagne à l’autre, et qu’on appelle La Nymphe du Danube, ou La Nymphe de la Sprée » : un chevalier s’est fait aimer d’une fée, puis, séparé d’elle par les circonstances, épouse une femme toute prosaïque ; la nymphe réveille par ses prodiges le souvenir de leur amour.[4]. Des ballades populaires Scandinaves mettent également en scène la liaison d’une ondine (ou d’un ondin) avec un homme (ou une femme). Le personnage surnaturel est interprété tantôt comme étant du côté d’un érotisme païen et de l’animalité, tantôt comme aspirant à une rédemption. Parmi ces ballades, l’une des plus populaires est celle d’Agnès et le triton, qui inspirera Œlenschläger et Kierkegaard[5]. Mais La Motte-Fouqué s’est plus précisément inspire d’une légende de la Renaissance qui conte les amours du chevalier Peter von Slauffenberg et d’une ondine.[6] Paracelse en donne le récit dans son Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris et caeterts spiritibus où il prête déjà aux esprits élémentaires le regret de n’avoir pas d’âme. La Motte-Fouqué avait lu cet ouvrage, vraisemblablement en vue d’écrire une étude sur Jacob Bœhme. La légende, en outre, avait déjà été mise en vers en 1805 par Achim von Arnim, un poète que La Motte-Fouqué connaissait personnellement. Pour compléter ce petit aperçu historique, il faut préciser que sylphides et ondines étaient déjà répandues dans la littérature pré-romantique. Ceci, pour l’essentiel, sous l’influence du Comte de Gabalisou Entretien sur les sciences secrètes, de l’abbé Monlfaucon de Villars, publié à Paris en 1670 et souvent réédité ensuite. Pour l’abbé de Villars, les esprits élémentaires n’ont qu’un désir, c’est d’avoir part à l’éternité. Toutefois, à l’inverse de ce que préconise l’idéal chrétien, c’est par une liaison charnelle qu’ils atteignent leur but. Les esprits élémentaires sont ensuite largement réutilisés, tant en France qu’en Allemagne. C’est ainsi que Vulpius, par exemple, présente dans Die Puppe une sylphide en quête d’immortalité, empruntant le plus clair de son intrigue à Galli de Bibiena (La Poupée, La Haye, 1747). Le ton de ces récits est alors léger, voire grivois : c’est seulement à la fin du XVIlè siècle qu’ondines ou sylphides deviennent vertueuses et fidèles[7]. Ondine devint très célèbre en Allemagne. On en tira plusieurs opéras, non sans modifier la fin de l’intrigue dans le sens d’un happy end. La Motte-Fouqué écrivit lui-même un livret pour l’opéra de Seyfriedel pour celui d’Hoffmann (le célèbre auteur des contes était également compositeur). Dans l’opéra de Lortzing (1845) qui connut un grand succès, Huldbrand finit par devenir lui-même un ondin et va vivre sous les eaux avec Ondine. Dans Ondine, le renversement évoqué plus haut (l’ondine désormais mortelle et aspirant à une immortalité qui est maintenant l’apanage des humains) n’entraîne en fait qu’une christianisation très partielle de l’intrigue. Nous sommes des humains par notre corps et notre intelligence, confie Ondine à son époux au lendemain de leurs noces – mais un abîme nous sépare de vous. […] L’heure qui pour vous sonne l’éveil à une vie plus pure et plus parfaite nous fait disparaître, comme s’en vont la poussière et le vent, comme s’évanouissent vagues et étincelles. Car nous n’avons point d’âme. […] Nous ne pouvons atteindre à ce but que si nous gagnons l’amour de l’un d’entre vous. Et maintenant j’ai une âme, et c’est ton amour, ô bien aimé, qui me l’a value.[8] Cependant, contrairement à ce que suggère cette déclaration, le privilège de l’immortalité ne joue en fait aucun râle dans la suite du récit. Certes, le caractère d’Ondine se stabilise et s’adoucit mais, à part cela, l’âme dont elle est maintenant dotée ne joue plus aucun rôle dans la suite du récit. Ce qui compte, c’est qu’en tant qu’ondine, elle reste du côté de l’illimité. Ce qui importe également, c’est qu’elle est cependant suffisamment humanisée pour que lecteurs et lectrices se reconnaissent en elle et partagent les sentiments qu’éprouve cette belle âme. Le lecteur de l’Odyssée participe au récit à travers le personnage d’Ulysse et non par l’intermédiaire de la nymphe Calypso, encore moins des sirènes. Ici au contraire, le lecteur voit Huldbrand de l’extérieur mais sympathise avec l’ondine. C’est la douleur d’Ondine qui, en étendant les limites de l’âme du lecteur, l’invite à jouir de lui-même dans un épanchement océanique. Plus précisément, Ondine renvoie au lecteur l’image d’un être dont le rêve d’amour, dont le désir de complétude, tout en trouvant dans un lien défini avec un homme la possibilité de se réaliser, ne parvient cependant pas à se défaire de sa propre illimitation. Cette illimitation, qui illustre le lien qui continue de la rattacher à son oncle ondin, fait retour dans sa relation avec Huldbrand où elle se manifeste par des intrusions perturbatrices et d’inquiétants débordements. Ces inondations ressemblent à celles que provoque une autre ondine dans un conte répandu de l’Italie et la Grèce jusqu’à la Scandinavie et que l’on trouve dans le recueil des frères Grimm sous le titre L’Ondine dans son étang (mais dans ce conte, le jeune héros est enlevé à son épouse par une ondine malfaisante, et c’est l’épouse, par son amour et sa persévérance, qui viendra à bout de la ravisseuse et ramènera à elle le jeune homme). « Ne vous montrez plus à moi », dira Ondine à son oncle, maintenant j’ai peur de vous-voulez-vous que mon mari me regarde avec effroi, en me voyant une si singulière compagnie et étrange parenté ? » Mais les prières d’Ondine restent vaines. De fait, les liens qui la rattachent à l’inquiétante profondeur des eaux éloignent d’elle le chevalier et, finalement, provoquent sa propre disparition lorsque, sur le bateau qui les conduit à Vienne, éclate la colère du chevalier : « Ainsi donc », lance-t-il à Ondine, «tu es toujours en relation avec eux ? Reste donc avec eux, toi et tous tes présents sorcière et magicienne que tu es ; et nous autres hommes, laisse-nous en paix ! » La lourde pierre qui scelle la fontaine se présente comme une frontière infranchissable empêchant tout débordement de l’illimité. C’est pourtant cette frontière qu’Ondine franchira, tel un spectre – totalement confondue, cette fois, avec l’élément liquide – pour donner à Huldbrand le baiser fusionnel de la mort. Sur l’ordre de Bertalda, des serviteurs descellent la pierre. « C’était comme si une force venant de l’intérieur du puits eût aidé à soulever la pierre » ; la fontaine se fait jaillissement d’eau et Ondine apparaît.Dans sa chambre, Huldbrand, songeur, se tient devant un miroir :
Par le miroir, il vit la porte s’ouvrir lentement, lentement, et il vit entrer la blanche apparition, qui referma aussitôt cette porte derrière elle.
« Ils ont rouvert le puits, – dit-elle faiblement, – et voici maintenant que je suis ici, et qu’il te faut mourir ! »
Huldbrand sentit son cœur s’arrêter, et comprit qu’en effet il ne pouvait en être autrement, et qu’il fallait mourir. Cependant il se couvrit les yeux de sa main et il dit:
« Ne me rends pas fou d’épouvante à l’heure de ma mort. Si tu caches un visage effrayant derrière ton voile, reste voilée, et donne-moi la mort sans que je te voie.
– Ne veux-tu donc pas me revoir une fois encore ? répliqua le fantôme. Je suis toujours belle comme au bienheureux jour de nos épousailles au bord du lac !
– Oh ! si c’est toi qui est là, murmura Hulbrand, – si ce que j’entends est vrai, puissé-je mourir dans un baiser de toi !
– Ainsi en soit-il donc, mon bien-aimé », répondit Ondine. Et elle souleva son voile, et ses traits adorés apparurent, rayonnant d’une beauté céleste. Éperdu d’amour, enivré de désirs de mort, le chevalier s’inclina vers elle et lui donna un divin baiser. Mais elle ne le quitta plus, elle pressa son bien–aimé contre son cœur, ses yeux devinrent comme deux ruisseaux de larmes et elle pleurait, et pleurait encore, comme si toute son âme s’en allait dans ses larmes. Elles inondaient le visage et les yeux de Huldbrand, qui les sentait pénétrer en lui avec une suave douceur, jusqu’à ce qu’enfin toute respiration vint à lui manquer, et que des bras bénis d’Ondine il eût glissé, inanimé, mort[9].
Huldbrand, en somme, cède au chant des sirènes. L’illimitation fusionnelle, échouant à se sublimer (à s’édulcorer) dans l’infini chrétien, conserve ici toute sa puissance et déploie ses ravages. La scène de l’ouverture du puits évoque, mais sous forme inversée, la visite des saintes femmes au tombeau du Christ : la pierre qui scellait la tombe est roulée sur le côté, Jésus en est sorti, il est revenu parmi les vivants, et du même coup, il a rouvert aux humains la porte de l’éternité. L’apparition de la revenante est tellement esthétisée par La Motte-Fouqué et elle se mêle si bien à la douceur aimante d’Ondine que le lecteur, lui aussi, cède confusément aux délices de sa propre illimitation. La beauté et la séduction des images du récit, offrant leur support à l’expansion de soi éprouvée par le lecteur, justifient à ses yeux le plaisir qu’il y prend. Un plaisir dans lequel le rêve d’amour s’avoue son désir de complétude et de fusion, mais continue de méconnaître la nostalgie maternelle et incestueuse qui l’alimente. Le retour d’Ondine est bien plus que le châtiment d’une infidélité. C’est l’aboutissement d’un amour où se brouillent les frontières fondatrices, la réalisation d’un désir transgressif qui s’était déjà manifesté par le refus du deuil. En effet, ce franchissement de la frontière qui sépare les vivants des revenants répond à deux épisodes qui précèdent, épisodes dans lesquels le temps du deuil et des rites funéraires se trouve court-circuité. Le premier épisode est celui dans lequel la fille du pêcheur et de sa femme disparaît et se trouve aussitôt remplacée par Ondine. Le pêcheur s’en fait le narrateur :Ma femme était assise sur le bord du lac avec l’enfant, jouant avec elle, sans souci et heureuse, lorsque tout à coup la petite se penche en avant, comme si elle avait aperçu dans l’eau quelque chose de très beau. […] Ce mouvement avait été trop vif, et au même instant l’enfant glisse des bras de sa mère et disparaît sous le miroir de l’onde. Je cherchai longtemps la petite morte, mais ce fut en vain, je ne pus retrouver d’elle aucune trace.
Le soir même du jour où la fillette disparut, continue le vieil homme :(…) nous entendons comme un léger bruissement dehors, et puis la porte s’ouvre, et nous apercevons une fillette de trois ou quatre ans, richement parée et d’une merveilleuse beauté, qui se tient sur le seuil et qui nous sourit. (…) Je remarquai que ses cheveux d’or et ses riches vêtements ruisselaient d’eau, et je conclus qu’elle avait peut-être dû tomber dans le lac et qu’il fallait sans tarder lui porter secours. Personne n’a pu sauver notre chère petite fille, dis-je à ma femme, taisons du moins pour les autres ce qui aurait été notre plus grande joie sur la terre, si quelqu’un avait pu le faire pour nous[10].
Quelques lignes plus loin, Je pêcheur ajoute : « Que cette enfant trouvée dût prendre la place de notre chère petite morte, cela avait tout de suite convenu. » Pas de corps, pas de funérailles, pas de deuil été et la petite disparue remplacée le soir même par une autre qui prend sa place ! Une confusion, un brouillage, acceptés par les parents avec bonne conscience et même avec joie, alors que leur enfant, en réalité, a été ravie par un ondin qui lui a substitué une fille des eaux. Pour saisir toute la portée de cet épisode, il faut le situer par rapport aux croyances qui l’ont inspiré, les histoires de changelins. Celles-ci sont familières aux folkloristes: un être surnaturel (fée, démon, etc.) enlève un enfant et dépose à sa place son propre rejeton. Le nourrisson manifeste une avidité et une insatisfaction inquiétantes qui alertent la mère et, finalement, lui font découvrir la vérité. Il apparaît que, contrairement aux nourrissons humains, le changelin a déjà derrière lui plusieurs siècles de vie. La mère entreprend alors de se faire restituer son enfant par la ravisseuse et y parvient[11]. La transformation que La Motte-Fouqué fait subir à ce type de récits saute aux yeux : dans Ondine, les parents ne veulent pas savoir que l’enfant substitué est un changelin et par conséquent ne cherchent pas à se faire restituer leur fille. Les parents ne pensent pas que leur fille est encore en vie (ils cessent donc de la rechercher), mais ils ne prennent pas non plus le temps de la pleurer. Contrairement à la mère qui perce la véritable identité du changelin, le pêcheur et sa femme se font donc les complices d’une illimitation qui s’introduit en contrebande dans le monde des humains et d’un brouillage qui abolit la frontière entre deux identités. Le deuxième épisode est celui du remariage prématuré du chevalier, alors qu’il ignore si Ondine est morte et que, de toute manière, il n’en a pas fait son deuil (une situation qui répète donc la précédente, avec cette différence que la disparue est maintenant Ondine). Le père Heilmann avait béni le premier mariage de Huldbrand; lorsque celui-ci lui demande de célébrer le second, il n’est donc pas étonnant qu’il élève des objections:Je vous demanderai devant tous si vous avez une certitude si absolue que votre première épouse soit morte ? Pour moi, cela ne me paraît aucunement certain. […] Depuis quelque temps elle m’apparaît chaque nuit dans mes rêves : je la vois qui se tient debout près de ma couche, se tordant les mains avec anxiété, et répétant sans cesse au milieu de soupirs : «Empêchez cet hymen, ô mon père, car je vis toujours. Sauvez son corps et sauvez son âme» […] Huldbrand ! Renonce à cette jeune fille! Bertalda ! Renonce au chevalier ! Il appartient encore à une autre : ne vois-tu pas comme les traits de son visage témoignent, par la souffrance qu’ils expriment, que son premier amour n’est pas mort[12]?
Un amour qui ne peut se détacher de l’infini rend le deuil impossible et se mue en désir de mort: demeurant attaché à l’objet auquel il aurait fallu renoncer pour s’engager du côté de la vie et de son incomplétude, cet amour rouvre les portes de la mort. La fille du pêcheur (c’est-à-dire Bertalda) à peine disparue, Ondine prend sa place. Ondine disparue à son tour dans les eaux, Bertalda s’apprête à la remplacer auprès du chevalier. Ce chassé-croisé le montre bien : il n’y a ici qu’une place pour deux. Bertalda et Ondine sont doublement rivales, par rapport au pêcheur et à sa femme, et par rapport au chevalier. Comment expliquer, dans ces conditions, l’étrange période d’amitié entre Ondine et Bertalda, qui donne au lecteur l’impression qu’elles forment avec Huldbrand une sorte de ménage à trois ? Car Bertalda, malgré la déception de voir son chevalier lui revenir au bras d’une autre, fait bonne figure à Ondine. Quant à celle-ci, elle s’attache chaque jour davantage à Bertalda.Nous devons nous être connues jadis, – avait-elle coutume de lui dire souvent, – ou il faut qu’il y ait quelque rapport merveilleux entre nous, car on n’aime pas ainsi sans motif, je veux dire sans un motif profond et secret, de la manière extraordinaire dont je vous ai aimée dès le premier moment où je vous ai vue[13].
Ondine, on s’en souvient, informe Bertalda de sa véritable filiation. Ondine sait donc qu’elle a enlevé à Bertalda à la fois son fiancé et ses parents adoptifs de haute naissance. Et pourtant, elle ne conçoit toujours pas que leur relation puisse être empreinte d’hostilité et de jalousie :« Dès ma plus tendre enfance, j’ai pris ta place», reconnaît Ondine ; ce qui ne l’empêche pas d’ajouter: « Nos destinées sont liées l’une à l’autre depuis ce temps, resserrons ces liens, unissons-nous tellement désormais qu’aucun pouvoir humain ne puisse plus nous séparer. […] Nous vivrons comme deux sœurs[14]. »
Ici encore, le récit de La Motte-Fouqué contraste singulièrement avec les sources populaires qui l’ont inspiré. Qu’une humaine cherche à arracher son fiancé ou son époux à la femme surnaturelle qui le lui a ravi, assumant ainsi ouvertement la relation de rivalité, c’est une intrigue que l’on trouve dans nombre de contes et de légendes. Nous l’avons déjà rencontrée avec un conte de Grimm, L’Ondine dans son étang. On la retrouve dans des légendes scandinaves : un enfant est ravi par la Fée blanche, la Vierge des Glaciers ou la Reine du Pôle, et sa mère ou sa fiancée affrontera de dures épreuves pour le lui arracher[15]. Andersen s’est inspiré de ce type de récit pour écrire La Reine des neiges ainsi que La Vierge des glaces. Dans tous ces récits, aucun accommodement entre l’héroïne et la ravisseuse n’est concevable. Et pour le garçon, il n’y a pas non plus de moyen terme: ou bien, ensorcelé par l’étendue sans limites où la fée l’a attiré, il s’y abîme sans espoir de retour, ou bien, grâce à la mère ou la jeune fille qui l’aiment, il revient parmi les humains. Quant à la fée, étant entièrement du côté de l’illimité, elle ne manifeste pas les sentiments humains qui permettraient au lecteur de sympathiser avec elle. Il n’est donc pas question non plus pour la fée d’acquérir une âme, de s’humaniser. Entre l’infini et le fini, il faut choisir, et mieux vaut choisir le fini. Ondine, elle, est partagée – comme nous tous – entre un versant d’illimitation et son désir d’être une femme pour un homme, donc d’occuper une place délimitée. Ces traits font d’elle un personnage certes moins éloigné d’une femme que le sont les sirènes païennes et les fées des neiges. Mais cela ne nous explique toujours pas qu’Ondine enterre sa rivalité avec Bertalda sous une épaisse couche de bons sentiments. Pour comprendre cet aspect du récit de La Motte-Fouqué, il faut le situer non plus par rapport à une tradition populaire, mais dans un courant littéraire dont Rousseau fut sans doute l’initiateur. Son roman, Julie ou la nouvelle Héloïse, présente en effet dès 1761 le modèle de ces ménages à trois qui jalonneront la littérature romantique. Saint-Preux et Julie sont follement amoureux l’un de l’autre. Mais la différence de leurs conditions rend le mariage impossible. Julie se marie avec M. de Wolmar. Celui-ci invite l’amant à partager la vie du couple : « Venez, mon ami ; nous vous attendons avec empressement». SaintPreux, pour sa part, est disposé à sublimer son amour, dont la chasteté exalte la ferveur. Voici donc, à côté de la nouvelle Héloïse, un nouvel Abélard, avec la différence que celui-ci renonce volontairement à la chair et que tous deux partagent la même retraite, participent à la même petite société idéale en compagnie de M. de Wolmar. Dans une nouvelle d’Achim von Arnim, Meluck Marie Blainville, on voit une femme-magicienne partager la vie du comte de Saintrée et de son épouse ; la jalousie des deux femmes est dépassée dans une tendre amitié[16]. Une pièce de Goethe, Stella, présente une situation analogue. « Nous vivrons comme deux sœurs »: c’est également l’idéal que propose le philosophe allemand Jacobi dans son roman, Woldemar. Mme de Staël fait à ce propos la remarque suivante: « Il me semble que Jacobi entend moins bien l’amour que la religion, parce qu’il veut trop les confondre; il n’est pas vrai que l’amour puisse, comme la religion, trouver tout son bonheur dans l’abnégation du bonheur même[17]. » Madame de Staël voit juste. Renoncer à la chair pour se consacrer entièrement à l’amour de Dieu, tel est l’idéal chrétien. Renoncer à la chair pour conserver à un amour terrestre sa dimension d’absolue, tel est l idéal qui, à partir du roman de Rousseau, sera inlassablement décliné par la littérature romantique. Rousseau, en lisant les lettres attribuées à Héloïse, y avait trouvé une forme d’alliance entre l’idéal chrétien de la jeune nonne et la persistance sublimée de son amour pour Abélard. Dans ce roman, le modèle de la « petite société » (constitué par Julie, son mari, son amant et ses enfants) se substitue à l’idéal monastique. Cette « petite société » était utopique, tout en étant terrestre et séculière, n’en réalise pas moins un dépassement de la condition humaine ordinaire, dépassement dans lequel l’amour continue à être vécu dans une visée d’absolue. Le mouvement romantique délaisse l’au-delà pour investir le monde sensible, mais sans pour autant renoncer perspectives infinies que le christianisme place dans l’au-delà. Dans la vie réelle, une telle tentative ne peut déboucher que sur un échec, mais dans le domaine de la création littéraire, elle est viable. L’atmosphère délétère dans laquelle baigne la fin du récit de La Motte Fouqué, la confusion des sentiments dont témoignent les relations d’Ondine avec Bertalda, le désir de mort qui submerge Huldbrand nous déprimeraient si nous les rencontrions pour de bon chez des personnes de notre entourage. Mais dans la fiction que nous lisons, ils s’ajoutent à notre plaisir. Le récit nous rend témoins les effets destructeurs de l’illimitation, certes, mais grâce à cela, nous jouis sons de la peinture poétique qui en est faite, et celle-ci nous offre l’occasion d’épancher le sentiment que nous avons de notre propre infinitude. Le baiser de mort qu’Ondine donne à Huldbrand et qui l’arrache définitivement à sa fiancée tc1Testre, on le retrouve chez Andersen: dans La Vierge des glaces, un jeune homme et sa fiancée sont en barque sur un lac, la tempête se lève, le Jeune homme se Jette à l’eau, la Vierge des glaces qui l’attendait lui donne le baiser fatal qui le rend à jamais captif de son royaume au fond du lac. Un homme entre deux femmes encore une fois, comme dans d’autres contes d’Andersen, La Reine des Neiges (Kay entre Gerda et la Reine) ou L’Histoire d’une mère (l’enfant entre sa mère et la Mort) et, toujours, les images d’une dissolution de soi dans un sein océanique. La petite sirène reprend cette situation à trois (le jeune prince entre sa fiancée et la sirène). Cependant, dans ce conte, la sirène ne présente plus aucun des traits mortifères que l’on trouve chez les fées des neiges ou des glaces et qui subsistent encore chez Ondine. La christianisation partielle du personnage d’Ondine devient complète chez la petite sirène. Ceci grâce à un double renversement : d’une part, la petite sirène, loin de donner la mort à l’homme qu’elle aime, va au-devant de la sienne en un sacrifice sublime. D’autre part, ce n’est pas un amour terrestre qui lui permet d’acquérir une âme immortelle, mais au contraire le renoncement à cet amour. En 1837 (c’est-à-dire un an après avoir publié La Petite Sirène), Andersen écrivait dans une lettre : « Je n’ai pas, comme La MotteFouqué, dans Ondine, fait en sorte que l’acquisition d’une âme immortelle par la sirène dépendît d’une autre créature, de l’amour d’un être humain. Jamais je n’accepterais de telles choses en ce monde. 1 » J’ai fait en sorte que ma sirène suivît un chemin plus naturel, plus divin[18].Bien loin dans la mer, l’eau est bleue comme les pétales du plus beau bleuet, pure comme le verre le plus transparent, mais elle est très profonde, si profonde qu’il serait inutile d’y jeter l’ancre, et qu’il faudrait empiler une grande quantité de clochers pour monter du fond à la surface. C’est là en bas que demeure le peuple de la mer.
Telles sont les premières lignes du conte, dont voici un résumé : Le roi de la mer habite un château avec ses six filles et leur grand- mère. Chaque jeune sirène a son jardin. Celui de la dernière est orné de la statue d’un jeune garçon. « Quand vous aurez quinze ans, dit leur grand-mère, il vous sera permis de sortir au-dessus de la mer, de découvrir le monde des hommes. » La plus jeune attend son tour et, tous les ans, écoute le récit que lui fait celle de ses sœurs qui a atteint l’âge requis. Enfin, c’est à elle de monter à la surface ! Elle sort la tête de l’eau au coucher du soleil et voit un vaisseau brillamment éclairé : une fête se déroule à bord. Par la fenêtre du vaisseau, elle aperçoit un jeune prince dont c’est l’anniversaire. Après un feu d’artifice, un orage éclate. La tempête fait rage et le navire sombre. La sirène sauve le prince, inconscient. Le soleil se lève, elle dépose un baiser sur son front et le ramène sur le rivage. Des jeunes filles, venant d’un couvent voisin, s’approchent du prince pour le secourir. La sirène s’éloigne et se cache. Toute triste, elle retourne à sa demeure sous-marine. Souvent, la nuit, elle nage jusqu’au château du prince, situé au bord de la mer. Elle regarde par les fenêtres, elle le voit, lui qui ne sait même pas qu’il lui doit la vie. Elle apprend que les humains ont une âme immortelle, et qu’ellemême pourrait en obtenir une à la condition d’être aimée d’un homme et de se marier avec lui. Elle considère tristement sa queue de poisson. Alors qu’un bal se donne au château sous-marin, la sirène s’éclipse pour se rendre au gouffre où habite une sorcière. Celle-ci lui compose un breuvage qui permettra à sa queue de poisson de se diviser pour former de jolies jambes. Mais elle exige en paiement sa très belle voix de sirène. De plus, la sorcière lui annonce que chaque pas lui donnera l’impression de marcher sur un couteau tranchant et qu’elle ne pourra plus jamais redevenir une sirène. L’héroïne aborde au château du prince et, de fait, son corps se métamorphose. Le prince la recueille et la traite avec affection, comme une enfant. Il croit avoir été sauvé par l’une des jeunes filles qui l’ont trouvé sur le rivage, et la sirène, muette, ne peut le détromper ! On doit marier le prince à la fille d’un roi voisin. Le prince découvre alors – heureux hasard – qu’il s’agit précisément de la jeune fille dont il gardait le souvenir, celle qui avait pris soin de lui sur le rivage ! La sirène, tandis qu’elle tient la traîne de la mariée, pense à sa mort prochaine : ayant échoué dans sa tentative de gagner l’amour d’un homme, elle se dissoudra en écume le matin venu. On célèbre les noces sur le vaisseau du prince. Puis, dans la nuit redevenue calme, la sirène voit ses sœurs s’approcher. « Nous avons donné nos cheveux à la sorcière, lui disent-elles, pour que tu puisses redescendre parmi nous. Mais tu dois prendre ce poignard et tuer le prince. » La sirène ne peut s’y résoudre. Le soleil se lève, et … elle se voit transformée en fille de l’air. Après trois cents ans d’épreuves, elle obtiendra une âme immortelle. Pour la première fois, elle verse des larmes. Ondine possède d’emblée un corps de femme. Ce qui, en définitive, l’empêche de prendre place parmi les humains n’est pas un trait physique mais la persistance de ses liens avec le monde inquiétant des ondins. Dans La Petite Sirène le problème du passage (possible ou impossible) de l’infini au fini, De l’illimité ou délimité, se cristallise autour de la puberté, du passage de l’état d’enfant celui de femme. Atteindre l’âge de quinze ans, c’est accéder au privilège de sortir la tête de l’eau et de découvrir, enfin, le monde des hommes. C’est également, pour l’héroïne, l’âge d’une autre transformation physique irréversible, transformation désirée puisqu’elle la rend désirable aux yeux des hommes, mais qui s’accompagne d’une évocation de douleur et de sang (« comme si tu marchais sur un couteau bien affilé qui ferais couler ton sang », « ses pieds délicat saignaient »). Regardons de plus près les deux scènes, celle de la première révélation du monde des hommes et celle de la visite chez la sorcière.Le jour vint où elle eut enfin quinze ans.
« Tu échappes maintenant à notre autorité, dit la grand-mère, la vieille douairière. Viens que je te fasse ta toilette comme à tes sœurs. »
[…]
« Adieu ! » dit-elle ; et, légère et transparente comme une bulle, elle traversa l’eau.
Lorsque sa tête apparut à la surface de la mer, le soleil venait de se coucher; mais tous les nuages brillaient encore comme des roses et de l’or et, dans l’air rose pâle, l’étoile du soir scintillait, claire et belle ; l’air était doux, et frais la mer parfaitement calme. Il y avait là un grand navire à trois mâts[19].
La sirène s’approche du vaisseau où brillent cent lanternes de différentes couleurs et nage jusqu’à la fenêtre du salon. Là, à travers les vitres, elle voit un prince qui paraît n’avoir guère plus de seize ans, entouré de personnes auxquelles elle ne prête aucune attention tant elle est fascinée par la beauté du jeune homme. On reconnaît ici la scène-type de l’énamoration et du ravissement, si fréquente dans la littérature romantique (elle occupera encore une place centrale dans Le Château des Carpates de Jules Verne). Devant le spectacle du ciel coloré par le coucher du soleil, « l’imagination se figure par-delà l’horizon, écrit M de Staël, un asile d’espérance, une patrie de l’amour, et la nature semble répéter silencieusement que l’homme est immortel [20]». Le navire est l’objet médiateur entre deux espaces : le monde inférieur de la spectatrice en proie au ravissement et le monde supérieur où lui apparaît un personnage auréolé de complétude. Médiation redoublée par la fenêtre vitrée du vaisseau et par le regard de la sirène, puisque ceux-ci la mettent en contact avec l’objet de son désir, mais lui font mesurer aussi la distance qui l’en sépare. De même, au théâtre, à l’opéra, une invisible frontière rapproche et sépare à la fois la salle obscure de la scène illuminée – dans la salle le regard sombre d’un jeune homme, sur la scène la silhouette éclatante de la diva sur laquelle son désir se cristallise. Proches et éloignés, pour prendre un autre exemple, le monde d’où vient Emma Bovary et celui auquel elle aspire: lors d’une soirée aristocratique à laquelle elle est invitée, « un domestique monta sur une chaise et cassa deux vitres; au bruit des éclats de verre, Mme Bovary tourna la tête et aperçut dans le jardin, contre les carreaux, des faces de paysans qui regardaient. Alors le souvenir des Bertaux lui arriva. Elle revit la ferme, la mare bourbeuse[21]… » En somme, toute la tension que l’imagerie chrétienne avait déployée entre l’ici-bas et le Ciel, entre un dévot ou un saint et le personnage divin qui se manifeste à lui et perce son âme de ses rayons, le romantisme la reprend à son compte, mais pour en situer les deux niveaux à l’intérieur même du monde sensible. Dans ces conditions, la contradiction inhérente au rêve d’amour est portée à son comble: la délimitation de soi qu’il faudrait accepter pour faire place à l’autre est inconciliable avec le mirage de complétude qui s’empare de l’amant(e) à la vue de l’objet d’amour. La sirène optera-t-elle pour l’incomplétude qui va de pair avec la sexuation, ou poursuivra-t-elle envers et contre tout son rêve d’un accomplissement sans bornes? Les conditions de sa transformation physique vont nous apporter la réponse. Avec sa queue de poisson, pense la sirène, impossible de se faire aimer d’un homme. Il lui faut une paire de jambes, c’est la première des conditions qu’il lui faut remplir. Une condition qu’elle s’impose à ellemême car, après tout, le lecteur accepterait sans peine que la sirène soit aimée du prince tout en conservant sa queue de poisson. Mais une femme qui serait affligée d’une queue de poisson perdrait beaucoup en séduction ; pour compenser ce handicap, il lui faudrait une langue bien pendue, une parole par laquelle elle sache se faire reconnaître et aimer par-delà les apparences (un peu comme le fait la Bête dans le conte de La Belle et la Bête). Une fois engagée dans son choix, la sirène n’a plus qu’à se plier à la seconde condition, celle que lui impose la sorcière : se faire couper la langue, sacrifier sa voix. Avec cette conséquence qu’elle perd ainsi le pouvoir de se faire reconnaître du prince. Éblouie par l’image du prince, la sirène croit pouvoir séduire à son tour par l’image, et du coup renonce au langage.Le prince lui demanda qui elle était et comment elle était arrivée là et elle le regarda d’un air doux et pourtant si triste avec ses yeux bleu foncé car, bien sûr, elle ne pouvait pas parler[22].
« J’espère que tu ne crains pas la mer, mon enfant muette ! », lui dit le prince. Et il lui parla de tempête et de mer calme, de poissons étranges au fond des eaux, et de ce que le plongeur y avait vu, et elle souriait en l’entendant parler de ces choses, car elle connaissait mieux que quiconque le fond de la mer. [23]»
La sirène a tout le charme possible, elle danse mieux que les jolies esclaves du prince, mais, comme on dit d’un enfant boudeur, elle a perdu sa langue. Et, comme l’enfant qui boude, elle ne compense sa trop réelle impuissance que par une revanche imaginaire ou en se complaisant dans le rôle de victime. Son choix – l’image de préférence au langage – se révèle d’autant plus malheureux que son image se distingue mal de celle de sa rivale. En effet, celle-ci (la jeune fille qui a pris soin du prince après que la sirène a sauvé celui-ci de la noyade) lui ressemble. De phis, le prince est convaincu que c’est elle et non la sirène qui lui a sauvé la vie : cette jeune fille, lui dit le prince, « me trouva sur le rivage et me sauva la vie … : c’est elle seule que j’aurais pu aimer dans ce monde, mais tu lui ressembles. Tu effaces presque son image dans mon âme. » Presque, mais pas tout à fait. Et même, pas du tout, car le prince n’hésite pas un instant à épouser cette jeune fille lorsqu’il la retrouve. Ainsi, avec ses jambes chèrement acquises, la sirène parvient à n être qu’un reflet de celle que le prince aime; alors qu’avec sa voix, elle se serait clairement distinguée d’elle, aurait pu se faire reconnaître et rétablir la vérité à son profit. Pour bien saisir la portée du mutisme volontaire de la sirène, il faut le placer en regard des motifs analogues que présentent plusieurs contes de tradition orale. Car Andersen, ici, s’est inspiré de ces contes, mais en inversant un de leurs traits essentiels. L’écrivain danois connaissait bien La Fille à la recherche de ses frères puisqu’il en a lui-même proposé dans Les Cygnes sauvages une version fidèle à l’intrigue traditionnelle. Dans ce conte, l’héroïne s’astreint volontairement au mutisme, et son silence est le prix qu’elle doit payer pour que ses frères, qui ont été métamorphosés en oiseaux, retrouvent leur forme humaine. Son engagement dans une tâche qu’elle doit taire la rend suspecte à son entourage au point que son époux se résout à la condamner à mort. Le gain (un corps humain) comme le coût (le silence et l’acceptation de la mort) sont donc très proches de ceux que l’on trouve dans La Petite Sirène. Et pourtant, le résultat du sacrifice consenti est très différent. En effet, dès que les frères reprennent forme humaine, ils retrouvent aussi la parole et innocentent leur sœur. Et l’héroïne aussi, enfin affranchie de son vœu de silence, peut se justifier auprès de son mari. Ainsi, le temps de silence débouche sur la parole, la situation de non-reconnaissance se résout en une reconnaissance, et celle-ci permet à chacun des protagonistes de retrouver sa place auprès des autres. Il en va bien différemment dans le cas de la sirène puisque son silence, loin de n’être qu’une étape permettant de parvenir à une reconnaissance, l’enferme définitivement dans une situation de non-reconnaissance. Le motif de la marche douloureuse nous invite à comparer la sirène à l’héroïne d’un autre conte, La Femme à la recherche de son époux disparu. Celle-ci en effet doit tant marcher pour retrouver son mari qu’elle use plusieurs paires de chaussures en cours de route. On trouve également dans ce conte la situation de rivalité qu’Ondine et la Petite Sirène nous ont rendue familière : l’héroïne parvient à un château où son mari s’apprête à se remarier. Après s’être fait engager comme fille de ferme, l’héroïne cède à la future épouse de précieux objets ou des robes merveilleuses en échange de trois nuits qu’elle pourra passer auprès de son mari. Les deux premières nuits, l’homme, sous l’effet d’un narcotique que lui a fait boire à son insu la rivale de son ancienne femme, reste sourd aux appels de celle-ci. Mais la troisième nuit, il l’entend, il la reconnaît et la reprend pour épouse. Ici aussi, le contraste avec le conte d’Andersen est frappant : là où la sirène renonce à la parole pour améliorer son apparence, la femme à la recherche de son mari fait l’inverse: elle sacrifie tout ce qui lui aurait permis de donner une belle image d’elle-même pour pouvoir parler à l’homme qu’elle aime et se faire reconnaître de lui. C’est que les contes de tradition orale appartiennent à des cultures dans lesquelles la question d’être soi trouve sa réponse dans le champ d’une interdépendance entre soi et les autres: être soi, c’est avoir une place parmi les autres, avoir une place par rapport à d’autres. Le récit romantique, lui, se situe dans le prolongement du christianisme; on peut même dire qu’il radicalise la croyance en l’innéité de l’âme: mon véritable moi est en moi, il ne dépend pas des autres, il ne doit rien à la société. Du coup, la nonreconnaissance cesse d’être cette passe douloureuse dont il est nécessaire de sortir pour se réaliser. Elle devient au contraire le terme, le lieu de l’accomplissement véritable, le moment de l’accès à un soi qu’on ne doit qu’à soi. En n’étant rien, je suis tout! Plénitude de l’image ou identité limitée : auquel des deux donner la priorité ? Telle est également l’alternative dans laquelle nous place l’adolescence, puisque pour devenir, soit un homme, soit une femme, il faut quitter la complétude de l’enfance et renoncer, pour ainsi dire, à une part de soi. C’est cette exigence que, dans sa complaisance narcissique, le rêve d’amour voudrait éluder. À plus forte raison le rêve d’amour romantique puisque, comme nous l’avons vu, l’objet aimé y répond à un fantasme de complétude, occupant à la fois la place que la religion donne la divinité et celle qu’une nostalgie incestueuse donne à la mer. En somme, la petite sirène a beau franchir le seuil de la puberté, elle ne devient pas femme pour autant. Le prix à payer est trop élevé pour elle : renoncer à la complétude ? Abandonner l’infini pour le fini ? Plutôt mourir ! Huldbrand aussi, en définitive, fait le choix de mourir. Cette mort est esthétisée, mais elle n’est pas présentée comme un idéal moral (le père Heilmann lui refuse sa bénédiction). Dans le conte d’Andersen, en revanche, le choix de la sirène n’est pas seulement auréolé d’une valeur esthétique: il est également présenté comme un itinéraire de sainteté. Mais, une fois placé au service d’un message édifiant, le récit ne peut plus laisser jouer librement son déploiement esthétique. L’intensité des affects et leur libre expression se trouvent restreintes, voire même refoulées par une excessive idéalisation. D’où une certaine mièvrerie qui affaiblit la fin du conte. Dans La Petite Sirène comme dans Ondine, l’effusion de larmes témoigne d’un niveau d’extase auquel la prosaïque union sexuelle ne saurait prétendre, d’un point d’excès où douleur et félicité se confondent. Mais les larmes d’Ondine expriment la même énergie mortifère que les eaux qui débordent et qui noient. Les larmes de la petite sirène, au contraire, subliment le sombre accomplissement auquel elles participaient dans le récit de La Motte-Fouqué: pleurer, c’est avoir une âme, et cette âme est le don que la sirène reçoit pour avoir fait le sacrifice de sa vie: finalement transformée en fille de l’air, « la petite sirène éleva ses bras transparents vers le soleil de Dieu, et pour la première fois, des larmes lui vinrent». Un personnage aussi sublime, aussi rempli de bons sentiments ne peut qu’éveiller les soupçons du lecteur (à moins, bien sûr qu’il ne cède lui aussi à l’excessive idéalisation de soi que le récit lui donne en modèle). Andersen, pour sa part, trouvait manifestement son compte dans ce genre d’intrigue où l’incapacité à renoncer à la complétude se voile d’une justification religieuse. « Si l’on excepte l’histoire de la petite abbesse dans L’Improvisateur, écrit-il dans une lettre de 1837, c’est la seule œuvre qui m’ait touché lorsque je l’ai écrite.» Dans L’Improvisateur, roman publié un an avant La Petite Sirène, le personnage principal, Antonio, retrouve après bien des années celle qui, petite fille déjà, était destinée à entrer au couvent et que, pour cette raison, on avait surnommée la petite abbesse. L’amitié douce et fraternelle qui lie les deux jeunes gens se transforme, chez Antonio, en un sentiment amoureux. Cependant, la jeune fille persiste dans son intention de prendre le voile. Antonio la voit une dernière fois, conduite à l’autel par ses parents. Elle s’étend dans son cercueil, conformément au rite. Puis « la morte se releva, elle était devenue l’épouse du ciel[24] ». Pour bien comprendre la portée du choix narratif qu’a fait Andersen, il faut comparer cet épisode à un poème de Goethe qu’il connaissait certainement, La Fiancée de Corinthe. La comparaison révèle le même contraste que nous avons déjà observé entre les scènes finales de La Petite Sirène et d’Ondine. Deux jeunes gens, l’un d’Athènes, l’autre de Corinthe, sont fiancés. Mais la famille de la jeune fille s’est convertie au christianisme, et la mère, sans tenir compte des fiançailles de sa fille, l’a consacrée au service de Dieu. Une nuit, le jeune Athénien se rend chez sa fiancée. Étreignant la jeune fille, il sent ses membres glacés. Il comprend qu’il a affaire à une revenante (en effet, à la suite du vœu par lequel sa mère avait contrarié son amour, la jeune Corinthienne était morte), mais le jeune homme ne l’en désire pas moins. Mme de Staël commente ainsi la fin du poème :Alors commence la scène la plus extraordinaire que l’imagination en délire ait pu se figurer; un mélange d’amour et d’effroi, une union redoutable de la mort et de la vie. Il y a comme une volupté funèbre dans ce tableau, où l’amour fait alliance avec la tombe, où la beauté même ne semble qu’une apparition effrayante.[25]
Pareillement destinées à prendre le voile, la petite abbesse et la fiancée de Corinthe entrent au tombeau et en sortent. Mais la première échappe ainsi volontairement et définitivement à celui qui l’aime, tandis que la seconde, au contraire, retrouve ainsi une dernière fois son fiancé. A demi christianisée, la Corinthienne retourne à sa nature païenne, comme Ondine. Andersen d’un côté, Goethe et La Motte-Fouqué de l’autre, empruntent deux voies narratives opposées. Dans un cas, c’est l’infini chrétien qui triomphe, infini idéal mais qui ne parle guère à l’imagination. Dans l’autre, c’est l’infini païen, fascinant, mais sombre et destructeur. Ces deux voies conservent quelque chose de commun : elles partagent la même exaltation de l’infini aux dépens du fini. Toutes deux, faisant pencher le rêve d’amour du côté de la complétude, rendent par là même sa réalisation impossible: il faut que la nouvelle Héloïse meure, que Virginie (l ‘amie de Paul) meure, et Atala, et Huldbrand, et la fiancée de Corinthe. Le lecteur, quant à lui, oscille entre deux positions : ou bien séduit par l’idéalisation que ces récits romantiques lui proposent, il y trouve une raison de plus pour justifier son impossibilité de renoncer à la complétude. Ou bien, la lecture lui apportant un épanchement suffisant de sa propre infinitude, il se trouve ensuite plus disposé à accepter l’incomplétude qu’il est nécessaire d’assumer pour vivre (c’est un peu de cette manière que la foi religieuse permet aux fidèles de« faire la part des choses» et d’accepter la réalité – sauf, bien sûr, dans les cas de fanatisme). La sagesse d’Ulysse qui renonce à l’infini pour le fini n’est évidemment ni chrétienne ni romantique. Choisir le fini, c’est choisir de prendre (ou de reprendre) sa place parmi les autres, c’est accepter l’interdépendance humaine : L’Odyssée souligne la force des liens qui rattachent Ulysse à Pénélope et qui l’inscrivent dans un lignage, dans un rôle social, dans la fonction paternelle qu’il assume auprès de Télémaque. La sirène au contraire dissimule derrière la sublimité de son sacrifice et son apparente générosité les maximes d’un individualisme narcissique: être soi par soi, ne rien devoir à personne. Devenue fille de l’air, la sirène « vit le prince et sa belle épouse la chercher, ils fixaient tristement l’écume bouillonnante, comme s’ils savaient qu’elle s’était précipitée dans les flots. Invisible, elle déposa un baiser sur le front de la mariée, adressa un sourire au prince et monta avec les autres enfants de l’air sur le nuage rose qui passait». Quelle souveraine indépendance, quelle revanche ! Balzac exprime avec beaucoup plus de franchise la violente jouissance d’échapper à l’interdépendance lorsqu’il nous montre la duchesse de Langeais retirée dans un couvent et adressant une dernière lettre à l’amant par qui elle s’est crue délaissée:Ah ! j’éprouve une joie sombre à vous écraser, vous qui vous croyez si grand, à vous humilier par le sourire calme et protecteur des anges. [ … ] La pauvre religieuse vous éclairera sans cesse de ses ardentes prières et vous couvrira toujours des ailes de l’amour divin.[26]
[1] Homère, Odyssée, chant XII, vers 39-46 [2] Andersen, Contes, traduction de Marc Auchet, Paris, « Le Livre de Poche », 1987. [3] Homère, Odyssée, chant V, vers 206-213. [4] Mme de Staël, De l’Allemagne (1810), Paris, éd. Firmin Didot, 1862, p. 168-169 et 318. [5] Georges Dumézil, « Njôrdr, Nerthus et le folklore Scandinave des génies de la mer », Du mythe au roman, Paris, PUF, 1970. p. 192-193. Voir également l’introduction d’Erik Dal à La Petite Sirène, Copenhague, sans date, p. 9 ; Xavier Marmier, Histoire de la littérature en Danemark et en Suède, Pans, 1839, p. 232. [6] Voir les notes sur Ondine dans Romantiques allemands, sous la direction de Maxime Alexandre, Paris, éd. Gallimard, coll. « Bibliothèque de La Pléiade», 1963, t1, p1789. [7] Sur les esprits élémentaires dans la littérature française et allemande, voir G.L. Fink, Naissance et Apogée du conte merveilleux en Allemagne, 1740-1800 , Paris, éd. Les Belles Lettres, 1966, p. 47 et suiv. et p. 263-264. [8] Je cite d’après la traduction de Jean Thorel, Romantiques allemands Paris éd. Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1963, t.1, p.1386-1387. [9] Romantiques allemands, op. cité., p1434. [10] Ibid, p 1356. [11] Jean-Michel Doulet, Quand les démons enlevaient les enfants. Les changelins : étude d’une figure mytique, Paris, Presse de l’Université de Paris-Sorbonne, 2002. Voir également Jean-Claude Schmitt, Le Saint Lévrier. Guinefort, guérisseur d’enfants depuis le XIIIè siècle, Paris, éd. Flammarion, 1979, p 109-110. [12] Romantiques allemands, op. cit., p 1427. [13] Ibid., p1393 [14] Ibid., p1403 [15] Frédéric Dobritz, Contes et Légendes scandinaves, Paris, éd, Calmann-Lévy, 1887 [16] Romantiques allemands, op. cit., 1973, t.11, p. 683-711. Voir également, dans le même volume, « Isabelle d’Égypte », p. 462-582. [17] De L’Allemagne, op. cit., p494 [18] Cité dans l’introduction de Erik Dai à La Petite Sirène, Copenhague, s. d., p· 13. [19] Andersen, Contes, traduction de Marc Auchet. éd. Hachette, coll. « Le Livre de Poche », 1987, p17 18. [20] Mme de Staël, op. cit., p. 572. [21] Gustave Flaubert, Madame Bovary, Paris, éd. Hachette, coll. « Le Livre de Poche », 1978, p.61. [22] Andersen, Contes. traduction de Marc Auchet. éd. Hachette, coll.« Le Livre de Poche», 1987, p. 30. [23] Ibid., p. 33. [24] Andersen, L ‘Improvisateur, Paris, éd. Albin Michel, 1944, p. 345. [25] Mme de Staël, op. cit., p. 176. [26] Honoré de Balzac, La Duchesse de Langeais, Paris, éd. Hachelle, coll. « Le Livre de Poche», 1983, p. 340.