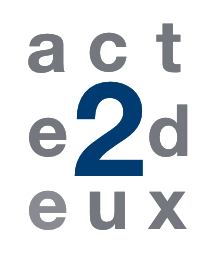Famille, je vous hais !
Quelques semaines après la création de Catégorie 3 de Lars Noren à Nanterre, et peu de jours avant la venue dans le même théâtre du suédois en tant que metteur en scène de la Mouette cette fois, Claude Baqué fait découvrir au Théâtre de l’Opprimé, à Paris, sa pièce au titre énigmatique : « Bobby Fischer vit à Pasadena »
D’abord, il y a le père qui ne dit rien. Et puis la mère qui parle tout le temps. Ensuite, il y a le fils, autiste. Enfin la fille, qui boit. Rassemblés comme dans une chanson de Brel, ce sont les personnages de «Bobby Fischer vit à Pasadena» du suédois Lars Noren. Mais leur monde n’est pas celui des petites gens; il est celui de la bourgeoisie où le whisky remplacer le «rouge qui tâche». De retour d’une soirée au théâtre, ils se retrouvent le temps d’une réunion de famille impromptue autour d’un verre pris sur la petite table basse. Les banalités s’échangent. Dans les premières minutes, on ne soupçonne rien. Puis, peu à peu, l’atmosphère se tend. Aux tirades de la mère répondent les «petites phrases» ironiques de sa fille, dont on apprend qu’elle ne vit plus depuis longtemps sour leur toit. Le père fait semblant de ne rien entendre. Le fils, lui, intervient par à-coups, sans autre logique apparente que la sienne. Bientôt sonne l’heure des mises en accusations, des cadavres qu’on ressort du placard. C’est le grand déballage. Il durera jusqu’au matin…
De même que Jon Fosse, son voisin norvégien (mais dans un style différent !), Lars Noren est passsé maître dans l’art de faire entendre ce qui ne se dit pas, ce qui ne s’avoue jamais à soi comme aux autres – blessures secrètes, douleurs cachées, désirs refoulés, rancœurs rentrées… enfermés depuis longtemps sous la double chape de la bonne conscience et du contentement de soi. Usant de la psychanalyse comme de la critique sociale, ce sont ces vérités qu’il fait remonter à la surface au fil d’une écriture qui gratte où ça fait mal, taille dans la chair.
Metteur en scène, Claude Baqué a créé cette pièce en France au début du mois de mars. C’était à Mayenne. Il reprend ce spectacle pour quelques jours encore à Paris, dans un théâtre «alternatif» (et essentiel!) : le Théâtre de l’Opprimé. Il serait dommage qu’il nesoit pas représenté par la suite ailleurs. C’est qu’ici tout n’est qu’évidence, simplicité savante -du décor (un salon chic, sans chichis…) aux déplacements et au jeu des comédiens (ces «adultes qui font semblant, qui parlent et tournent en rond», comme l’affirme une réplique!). L’air de rien, ils font éclater le vernis des bonnes manières comme des bons (ou mauvais) sentiments pour conduire jusqu’au plus profond désarroi d’être. C’est vrai de Geneviève Esménard, la mère abusive et castratrice, hier actrice, aujourd’hui femme délaissée qui monopolise la parole parce que parler est pour elle la seule façon qui lui reste d’être au monde. C’est vrai d’Alexis Nitzer, le père démissionnaire vis-à-vis de ses enfants comme de sa femme qu’il délaisse, préférant faire chambre à part. C’est vrai encore de Nicolas Struve, le fils qui s’est retiré sur de lointaines terres sans que personne (ni lui sans doute) sache pourquoi, comme d’Isabelle Habiague, la fille mortifère depuis la mort de son enfant, noyant dans l’alcool son incapacité à se libérer de son angoisse face au monde, à l’absence du père, à l’omniprésence maternelle…
Didier Méreuze