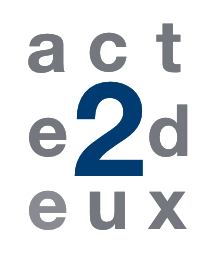James Joyce / Le nouveau drame d’Ibsen
 James Joyce
James Joyce
Le nouveau drame d’Ibsen
[Théâtre Populaire, n°9, 1945. Traduit de l’anglais par Anne Garnier.]
Dans leur jeunesse, les grands hommes ont parfois des admirations exclusives : Joyce isolé en Irlande catholique se défendit mal contre le mythe qui faisait d’Ibsen le grand dramaturge révolutionnaire de l’émancipation universelle. Il alla même jusqu’à étudier le norvégien pour mieux goûter, dans leur plein texte, les œuvres de son idole. Au moment où l’Irlande s’éveillait à l’art dramatique, nul ne se fit mieux que lui, à Dublin, le propagateur des idées ibséniennes – au point d’encourir la surveillance ecclésiastique et le discrédit de l’Université.
C’est à dix-sept ans, dans toute l’ardeur de cette lutte, qu’il rédigea l’essai que l’on va lire, le premier écrit qu’il ait publié. Ce texte nous intéresse donc à double titre ; d’abord pour sa valeur documentaire. Aujourd’hui, en effet, le crédit dont put jouir Ibsen comme prophète de la révolte paraît affaibli, dans une époque qui lui préfère son rival Strindberg. Mais la passion qu’aux alentours de 1900, toute une génération éprouva pour Le Canard Sauvage ou Rosmersholm, il n’est pas inutile de rappeler qu’elle prépara la création d’Ulysse et de Dedalus. Ensuite, n’est-ce pas une sorte de psychanalyse de son adolescence que nous livre ici Joyce, étouffant dans le puritanisme irlandais et regardant vers le monde de la scène, comme vers celui de la liberté ?
Voici vingt ans qu’Henrik Ibsen écrivit Maison de Poupée, œuvre qui devait faire date dans l’histoire du drame. Sa renommée dès lors gagna deux continents, provoquant plus de débats et de critiques que celle d’aucun de ses contemporains. Certains ont salué en lui un réformateur religieux, un révolutionnaire social, un défenseur passionné de la justice, un grand dramaturge. D’autres l’ont dénoncé comme un impertinent touche-à-tout, un artiste raté, un incompréhensible mystique, voire, pour reprendre l’expression savoureuse d’un critique anglais, comme « un chien furetant dans la crotte ». Mais, malgré les contradictions de la critique, le génie d’Ibsen s’affirme chaque jour davantage, tel un héros triomphant de ses épreuves, et tandis que les fausses notes se font plus rares, le chœur des louanges ne cesse de s’accroître. Le spectateur le plus indifférent trouvera significatif que l’intérêt suscité par ce Norvégien n’ait point faibli depuis un quart de siècle. On peut se demander quel autre homme a su exercer une semblable emprise sur la pensée moderne. Ni Rousseau, ni Emerson, ni Carlyle, ni aucun de ces géants dont l’œuvre passe de si loin la condition humaine. L’influence d’Ibsen sur deux générations s’explique en partie par la réserve de l’homme. Jamais, ou peu s’en faut, il n’a daigné descendre dans l’arène. Sa sérénité merveilleuse ne fut guère troublée, semble-t-il, par les discussions orageuses qui éclataient autour de lui. L’opposition n’a pas eu la moindre répercussion sur son œuvre. Sa production s’est accomplie dans l’ordre le plus sûr, et selon une routine d’horloger, telle qu’on en trouve peu chez les grands génies. Une fois seulement, il a répondu à l’attaque violente de ses ennemis, à propos des Revenants. Mais, depuis Le Canard sauvage jusqu’à Jean-Gabriel Borkman, ses drames ont paru avec une régularité quasi-mécanique, tous les deux ans. On a tendance à sous-estimer l’effort constant que requiert un tel plan de travail., Plus admirable encore est l’avance lente, irrésistible de cet homme extraordinaire. Onze pièces ont été publiées, qui traitent toutes de sujets modernes. En voici la liste : Maison de Poupée, Les Revenants, Un Ennemi du peup1e, Le Canard sauvage, Rosmersholm, La Dame de la mer, Hedda Gabler, Solness le Constructeur, Le Petit Eyolf, John-Gabriel Borkman et, pour finir, son nouveau drame, paru à Copenhague le 19 décembre 1899: Quand nous nous réveillerons d’entre les morts. On est déjà en train de traduire cette pièce en une douzaine de langues ; voilà qui en dit long sur la renommée. de l’auteur. Il s’agit ici de trois actes en prose.

Edvard Münch. Quand nous nous réveillerons d’entre les morts. 1909
Entreprendre le compte rendu d’une pièce d’Ibsen n’est assurément pas chose facile. Le sujet en est très limité et très vaste tout ensemble. On peut, sans risque d’erreur, prédire que les trois-quarts des résumés qu’on en fera débuteront comme suit: « Arnold Rubek et sa femme, Maïa, sont mariés depuis quatre ans quand la pièce commence. Leur union, toutefois, n’est pas heureuse. Chacun est mécontent de l’autre ». Compte rendu irréprochable, certes, mais qui ne va pas bien loin et ne donne pas la moindre idée des relations du Professeur et de sa femme. Ce n’est qu’une version plate, scolaire, de nuances sans nombre et indéfinissables. Comme si l’histoire d’une vie tragique pouvait s’inscrire aussi grossièrement en deux colonnes : pour et contre[1] (1). On n’exagérera nullement en affirmant que les trois actes disent ce qui est essentiel au drame; c’est à peine s’il y a un seul mot superflu dans la pièce entière. L’œuvre même exprime donc sa propre philosophie avec toute la concision que permet la forme dramatique. On conçoit dès lors facilement qu’un résumé ne saurait donner une notion exacte du drame. Il n’en va pas de même pour la plupart des pièces auxquelles la critique peut rendre justice en quelques lignes. Plats réchauffés, le plus souvent, compositions sans originalité, d’où toute finesse psychologique est sereinement absente et où l’auteur parle strictement pour la galerie, œuvres d’histrions, pour tout dire, et qui ne méritent rien d’autre qu’un accueil froid et désinvolte. Mais quand il s’attaque à un homme comme Ibsen, le critique sent son courage sombrer devant l’immensité de la tâche. Tout ce qu’il peut espérer faire, c’est établir un lien entre quelques-uns des éléments essentiels, de façon à suggérer plutôt qu’à indiquer la complexité de l’intrigue. Bien avant cette pièce, Ibsen a acquis une maîtrise telle de son art, qu’au moyen d’un dialogue apparemment très simple, il présente ses héros au cœur de différentes crises morales. Il a ainsi recours sans réserve à une méthode analytique qui lui permet de faire tenir la vie de tous ses personnages en l’espace assez bref de deux jours. Prenons-en pour exemple Solness, que nous croyons voir agir pendant une nuit et jusqu’au lendemain soir , en fait nous avons été des témoins passionnés de sa vie tout entière -jusqu’au moment où Hilda Wangel entre dans sa maison[2]. Il en va de même avec l’œuvre que nous étudions aujourd’hui ; lorsque nous voyons le Professeur Rubek pour la première fois, il est assis dans un jardin, son journal à la main; mais voici que le livre de sa vie passée s’ouvre devant nous, et nous avons la joie, non pas d’en entendre le récit, mais de le lire nous-mêmes, d’en joindre les divers épisodes et de nous approcher pour y voir de plus près, quand le sens vient à manquer.
Ainsi donc, au lever du rideau, notre héros est assis dans les jardins d’un hôtel à l’heure du petit déjeuner. Près de lui se trouve Maïa, sa femme. La scène se passe en Norvège, dans une station thermale réputée, au bord de la mer. À travers les arbres, on aperçoit le port, le fjord et les vapeurs qui y louvoient. Au loin, des îlots et des langues de terre. Rubek est un sculpteur célèbre, d’âge moyen, et Maïa une femme encore jeune, aux yeux vifs mais ombrés d’une légère tristesse. Ils lisent tranquillement, dans la quiétude du matin. Tout semblerait idyllique à l’œil inattentif. La femme rompt soudain le silence, avec éclat en se plaignant de la paix profonde qui règne autour d’eux. Arnold pose son journal et proteste doucement. Ils se mettent alors à causer, du silence, du lieu, des gens, des gares qu’ils ont traversées la nuit précédente, avec leurs porteurs ensommeillés et1es lanternes qui se balançaient sans but. Ils bavardent ensuite sur les changements survenus chez les gens et tout ce qui s’est transformé depuis leur mariage. Les voici tout près du sujet brûlant. Tandis qu’ils parlent de leur vie conjugale, on découvre vite que leurs relations sont loin d’être aussi harmonieuses qu’on pensait. Leur âme apparaît lentement dans ses replis les plus profonds, et l’on discerne déjà dans cette scène fin-de-siècle le drame qui se prépare. La dame semble une petite personne pointilleuse. Elle se plaint des promesses vaines dont son mari a nourri ses aspirations.
MAÏA. – Tu m’as dit que tu m’emmènerais sur une haute montagne, pour me montrer toutes les splendeurs de la terre.
RUBEK, troublé. – Vrai, je te l’ai promis aussi ?[3].
Bref, il y a quelque chose de faux à la base de leur union. Cependant les clients de l’hôtel, qui prennent des bains, sortent à droite, babillant et riant. L’inspecteur des bains les conduit sans cérémonie. C’est le type même~ du fonctionnaire conventionnel. Il salue M. et M- Rubek, leur demande comment ils ont dormi. À son tour, Rubek lui demande si certains hôtes prennent des bains la nuit, car il a vu une silhouette blanche glisser dans le parc très tard. Maïa se rit de la question, mais l’inspecteur répond qu’une étrangère a loué le pavillon de gauche, et y demeure avec une dame de compagnie, une diaconesse. Tandis qu’ils devisent, l’étrangère et sa compagne traversent lentement le parc et entrent dans le pavillon. L’incident semble impressionner Rubek, et la curiosité de sa femme est piquée.
MAÏA, un peu troublée et désagréablement frappée. – Cette dame t’a peut-être servi de modèle, un jour, Rubek ? Tâche de te souvenir…
RUBEK, fixant sur elle un regard aigu. – De modèle ?
MAÏA, avec un sourire taquin. – Oui, dans ta jeunesse… Tu as eu, sans doute, d’innombrables modèles… dans le temps, bien entendu.
RUBEK, du même ton. – Mais.non, ma petite Madame Maïa, je n’ai jamais eu qu’un modèle, un seul… pour toutes mes créations.
Comme cette discussion se poursuit, l’inspecteur prend subitement peur en voyant quelqu’un approcher et il essaye de s’enfuir dans l’hôtel, mais une voix stridente l’arrête.
Voix D’ULFHEIM, à l’extérieur. – Mais attendez donc, nom d’un chien ! Vous détalez toujours devant moi.
Entre alors en scène le héros numéro deux. Il est décrit comme un homme long, maigre, musculeux, d’âge indécis, grand tueur d’ours. Son valet Lars l’accompagne, menant deux chiens couplés. Lars n’ouvrira jamais la bouche. Ulfheim le renvoie d’un coup de pied et s’approche de M. et Mme Rubek. Il entame une conversation avec eux, car il connaît déjà le célèbre artiste. Sur la sculpture ce chasseur farouche tient des propos piquants.
ULFHEIM. – Nous travaillons dans le dur, Madame, votre mari et moi. Il peine sur le marbre, et moi sur des muscles d’ours tendus et palpitants. Et tous les deux nous finirons par asservir la matière et nous en rendre maîtres. Nous n’avons de trêve que nous ne soyons venus à bout de sa résistance.
RUBEK, pensif. – Voilà des paroles de vérité.
Cet être excentrique, peut-être en raison même de son excentricité, est en train d’ensorceler Maïa. Chaque mot qu’il prononce, accroît le charme fascinant qu’il exerce déjà sur elle. La robe noire de la diaconesse le fait ricaner. Il parle froidement de tous ses amis proches, qu’il a envoyés dans l’autre monde.
MAïA. – Et qu’avez-vous fait pour vos proches ?
ULFHEIM. – Je leur ai lâché à chacun un coup de fusil, bien sûr !
RUBEK, le regardant. – Un coup de fusil ?
MAïA, écartant sa chaise. – Vous les avez tués ?
ULFHEIM, inclinant la tête. – Je ne rate jamais, Madame.
Mais on découvre vite que par ses proches Ulfheim entend ses chiens, et ses interlocuteurs en éprouvent quelque soulagement. Cependant la diaconesse a préparé un léger repas pour sa maîtresse à l’une des tables dressées près du pavillon. La frugalité du menu met Ulfhheim en joie, et il dénigre vertement ce régime efféminé. Il lui faut, à table, des mets plus substantiels.
ULFHEIM, se levant. – Vous êtes une maîtresse femme, vous. Venez avec moi. Vous les (ses chiens) verrez avaler de gros os saignants, les vomir et les ravaler ensuite. C’est un festin rien que de les voir !
Maïa répond à cette invitation mi – horrible, mi-comique, et laisse son mari en compagnie de l’étrangère qui sort à ce moment du pavillon. Ils se reconnaissent au même instant, La dame a servi de modèle à Rubek pour la figure centrale de son fameux chef-d’œuvre « Le jour de la Résurrection ». Au terme de ce travail, elle s’était enfuie mystérieusement, sans laisser aucune trace derrière elle. Ils conversent familièrement. A une question qu’elle lui pose, il répond, non sans hésitation, que la personne qui vient de sortir est sa femme, et lui demande à son tour si elle est mariée. Elle répond affirmativement.
RUBEK. – Où est-il maintenant ?
IRÈNE. – Quelque part dans un cimetière… sous un superbe monument… avec une balle de plomb dans le crâne.
RUBEK. – S’est-il tué de sa propre main ?
IRÈNE. – Oui, il a tenu à me devancer.
RUBEK. – Le regrettes-tu, Irène ?
IRÈNE, sans comprendre. – Qui regretterais-je ?
RUBEK. – Mais… M. de Satow!
IRÈNE. – Il ne s’appelait pas M. de Satow.
RUBEK. – Comment cela?
IRÈNE. – C’est le nom de mon second mari, un Russe.
RUBEK. – Et où est-il, celui-ci ?
IRÈNE. – Très loin, dans l’Oural… au milieu de ses mines d’or.
RUBEK. – Il y passe sa vie ?
IRÈNE, haussant les épaules. – Sa vie ? sa vie ?… À vrai dire, je l’ai tué aussi.
RUBEK, sursautant. – Tué !
IRÈNE. – Avec un poignard effilé que j’ai toujours dans mon lit.
Rubek commence à comprendre qu’il y a un sens caché derrière ces étranges paroles. Il se met à songer à lui, à son art, à cette femme, et envisage son existence passée depuis la création du « Jour de la Résurrection ». Il sent qu’il n’a pas tenu la promesse de cette œuvre, et entrevoit la grave carence de son existence. Il s’enquiert auprès d’Irène de sa vie après leur rupture, et la réponse qu’elle lui donne est d’une importance capitale, car c’est l’idée dominante de tout le drame.
IRÈNE, se levant lentement de sa chaise, dit d’une voix tremblante. – J’étais morte depuis des années. Ils étaient venus me garrotter. Ils m’avaient lié les mains derrière le dos. Ils m’avaient descendue dans un sépulcre et l’avaient fermé avec des barreaux de fer, après en avoir matelassé les parois, en sorte que personne ne pouvait entendre les lamentations venant du sépulcre…
Dans cette allusion à la situation du modèle, Ibsen donne encore une preuve de sa connaissance intime du cœur humain. Nul autre n’aurait su aussi subtilement exprimer la nature des relations entre le sculpteur et son modèle.
IRÈNE. – je me suis exposée à tes yeux, tout entière, sans réserve… (Plus bas.) Et pas une fois tu ne m’as touchée…
RUBEK, la regardant avec insistance. – J’étais artiste, Irène.
IRÈNE, d’une voix sombre. – justement!… justement !
Tandis qu’il réfléchit profondément sur lui-même et sur son attitude passée envers cette femme, Rubek est frappé de l’abîme qui sépare son art de sa vie et réalise que même en art son génie est loin d’être irréprochable. Depuis le départ d’Irène, il n’a fait que sculpter des bustes de tiers et de quarts. Bref, une énergie nouvelle s’empare de lui et il décide de mettre un terme à tout ce gaspillage, car, selon lui, rien n’est encore perdu. Les lignes qui suivent font songer à la glorification de la volonté dans Brand.
RUBEK, hésitant, en proie à une lutte intérieure. – Si nous pouvions! oh ! si nous pouvions!…
IRÈNE. – Pourquoi ne pourrions-nous pas ce que nous voulons ?
Ils sont d’accord l’un et l’autre pour juger, insupportable leur condition actuelle. Irène estime que Rubek lui doit beaucoup, il n’en disconvient pas, et l’acte se termine avec l’entrée en scène de Maïa, toujours sous le charme d’Ulfheim.
RUBEK. – Quand as-tu commencé à me chercher, Irène ?
IRÈNE, avec un accent d’amère raillerie. – Depuis que je me suis aperçue du don que je t’avais fait… je t’avais donné, Arnold, ce dont on ne se passe pas, ce qui aurait dû rester inséparable de moi-même.
RUBEK, hochant la tête. – Oui, c’est cruellement vrai! Tu m’as donné trois ou quatre de tes jeunes années.
IRÈNE. – Je t’ai donné bien plus que cela, prodigue que j’étais en ce temps. –
RUBEK. – Oui, Irène, tu étais une prodigue. Tu m’as donné toute ton adorable nudité…
IRÈNE. – A contempler…
RUBEK. – Et à glorifier…
IRÈNE. – Mais tu oublies le don le plus précieux.
RUBEK. – Le plus précieux ?… Qu’était-ce donc ?
IRÈNE. – Je t’ai donné mon âme jeune et vivante. Et je suis restée avec un grand vide en moi, sans âme. (Le regardant fixement.) C’est là ce qui m’a fait mourir, Arnold.

Edvard Münch. Quand nous nous réveillerons d’entre les morts, 1909
On voit clairement, même à travers ce résumé incomplet, la perfection du premier acte. Le drame prend corps imperceptiblement et se précise sans effort apparent. La pelouse coquette de cet hôtel du dix-neuvième devient lentement le lieu d’un conflit tragique qui se développe de scène en scène. Chacun des personnages suscite notre intérêt, et nous attendons curieusement l’acte suivant. La situation n’est pas stupidement exposée, l’action prend place et, quand le rideau tombe, la pièce a vraiment progressé.
Le second acte se passe dans la montagne, près d’un sanatorium. D’un rocher jaillit une cascade, à droite. Sur le bord du torrent des enfants jouent en riant. Le crépuscule tombe. À gauche est assis Rubek, sur un monticule. Maïa entre bientôt, vêtue en alpiniste. Elle franchit le torrent en s’aidant de son bâton et appelle Rubek. Il lui demande si elle s’amuse bien avec son compagnon, et s’intéresse à leur chasse. Une conversation délicieusement spirituelle s’ensuit. À la question de Rubek, qui s’enquiert de l’endroit où ils ont l’intention de chasser l’ours, Maïa répond d’un air de supériorité : « On ne rencontre pas d’ours sur un plateau nu, que je sache ». C’est ensuite le brutal Ulfheim qui fait l’objet de leurs propos. Maïa l’admire à cause de sa laideur. Elle se tourne soudain vers son mari et lui dit qu’il est laid lui aussi. Il invoque son âge. « On vieillit, Madame Maïa, on vieillit ». Ces plaisanteries aigres-douces les conduisent vers des problèmes plus graves. Maïa est allongée sur la bruyère molle et. se moque doucement du Professeur. Pour les mystères et les revendications de l’art, elle a un dédain moqueur.
MAÏA, avec un rire un peu méprisant. – Ah, tu es et tu resteras toujours artiste, toi !
Et :
… Tu n’aimes pas la société, Rubek. Tu préfères vivre seul avec tes pensées. Moi, de mon côté, je ne puis m’entretenir avec toi, comme il le faudrait, de ce qui t’intéresse, de l’art, et cætera. (Avec un geste d’insouciance.) Et je ne m’en soucie pas beaucoup, à dire vrai.
Elle le raille à propos de l’étrangère et fait une perfide allusion à leur complicité. Rubek affirme qu’elle n’était pour lui que la source de son inspiration, en tant qu’artiste. Il avoue que les cinq années de sa vie conjugale ont été pour lui une période de famine intellectuelle. Il connaît ce qu’il ressent pour son art.
RUBEK, souriant. – Mais il ne s’agit pas de cela.
MAïA. – De quoi donc s’agit-il ?
RUBEK, de nouveau grave. – De ce que tout, vocation, travail d’artiste, et tout ce qui s’ensuit… oui, tout cela m 1 apparaissait soudain comme choses creuses, vides, insignifiantes au fond.
MAïA. – Et que voulais-tu mettre à la place ?
RUBEK. – La vie, Maïa.
Le problème essentiel de leur bonheur est abordé et, au terme d’une vive discussion, ils tombent d’accord tacitement pour se séparer. Les choses en sont là, lorsqu’Irène apparaît au bout de la lande. Elle est entourée d’enfants 1 rieurs et demeure un instant parmi eux. Maïa se relève d’un bond et va lui dire, d’un ton énigmatique, que son mari a besoin d’aide pour «ouvrir un coffret précieux ». Irène s’incline et s’approche de Rubek, tandis que Maïa s’en va gaiement à la recherche de son chasseur. L’entrevue qui va suivre est remarquable, même d’un point de vue scénique. Cœur de l’acte deux, elle est passionnante et appelle tout le talent des acteurs qui voudraient la jouer. Seule une interprétation parfaite des deux rôles peut donner une idée des subtilités de ce dialogue. Quand on songe au petit nombre d’artistes assez intelligents pour s’attaquer à cette scène et assez brillants pour l’enlever avec succès, on se sent pris de peur.
Dans l’entretien de ces deux êtres sur la lande, c’est la substance même de leur vie qu’exprime la main hardie et ferme de leur créateur. Depuis les premières paroles qu’ils échangent, chaque phrase est un monde d’expériences. Irène fait allusion à l’ombre noire de la diaconesse qui la suit partout, comme suit Arnold l’ombre de sa conscience inquiète. En faisant presque malgré lui cette confession, Rubek détruit une des barrières qui les séparaient ; une partie de la vieille confiance qu’ils avaient l’un en l’autre ressuscite, et ils retrouvent leur franchise d’antan. Irène peut alors ouvertement parler des sentiments à qu’elle a éprouvés et de sa haine contre le sculpteur.
IRÈNE, avec un retour de violence. – Oui, contre toi, contre l’artiste qui, de ses mains légères et insouciantes, a pris un corps palpitant de jeunesse et de vie, et l’a dépouillé de son âme afin de s’en mieux servir pour créer son œuvre d’art.
La faute de Rubek fut grande en vérité. Non seulement il s’est emparé de l’âme de la jeune fille, mais encore il a dépossédé de son trône légitime son enfant. Par son enfant, Irène entend la statue. Il lui semble, en effet, qu’elle a, au sens strict du mot, donné naissance à cette statue. Au fur et à mesure qu’elle voyait grandir la sculpture, sous la main habile de l’artiste, un secret instinct maternel s’est développé en elle, d’amour et de possession.
IRÈNE, changeant de ton, d’une voix chaude et émue. – Mais cette figure qui se modelait dans l’argile molle et vivante, cette figure, je l’aimais de plus en plus, à mesure que la matière brute, que la masse informe se transformait en un enfant dont l’âme parlait à la mienne, qui était notre création, notre enfant, à toi et à moi.
De fait, c’est à cause de ces sentiments passionnés qu’elle s’est tenue à l’écart pendant cinq ans. Quand elle apprend ce qu’il a fait de l’enfant – de son enfant – alors toute sa rancune éclate, plus violente que jamais. Rubek essaye désespérément de tout lui expliquer, mais elle écoute avec la férocité d’une mère à laquelle on aurait arraché son petit.
RUBEK. – J’étais jeune, ignorant de la vie. je pensais qu’on ne pouvait donner à la Résurrection une apparence plus belle, plus radieuse que celle d’une jeune fille intacte, n’ayant rien éprouvé de la vie terrestre, et s’éveillant à la lumière, à la joie triomphale, sans avoir à se séparer de quelque laideur, de quelque impureté que ce soit.
Une expérience plus grande de la vie l’a conduit à modifier son idéal, et c’est alors qu »il a fait de son enfant à elle, non plus la figure centrale de I’œuvre, mais un motif intermédiaire. Rubek se tourne vers la jeune femme, au moment où elle allait le poignarder. Pris d’épouvante et de remords, il cherche à se défendre, et plaide désespérément pour ses erreurs passées. Aux yeux d’Irène pourtant, il essaye de parer son crime de poésie, et s’il se montre repentant, c’est avec une volupté douloureuse. L’idée qu’elle a pu se donner tout entière à un art mensonger lui ronge atrocement le cœur. Sans éclats, elle fait son mea culpa, avec une tristesse profonde.
IRÈNE, se maîtrisant en apparence. – J’aurais dû mettre des enfants au monde… beaucoup d’enfants… de vrais enfants, et non de ceux que l’on conserve dans des sépulcres. C’était là ma vocation. jamais je n’aurais dû te servir, poète !
Perdu dans ses rêveries, Rubek ne souffle mot ; il songe aux beaux jours d’autrefois. Le souvenir des joies qu’ils ont connues ensemble adoucit sa peine. Mais Irène, rappelle une phrase qui avait échappé à l’artiste par mégarde. En lui disant gratitude pour l’aide qu’elle lui avait apportée, il avait ajouté que ce serait un épisode béni de sa vie. Déjà tant accablée, l’âme torturée de Rubek n’en peut plus. Il se met à lancer des fleurs dans le torrent, comme jadis près du lac de Taunitz, et évoque l’époque où ils jouaient à faire un petit-bateau de feuilles et à l’attacher derrière un nénuphar, cygne de Lohengrin. Dans leurs jeux mêmes, il faut trouver le sens caché.
IRÈNE. – Tu disais que j’étais le cygne qui guidait ton bateau.
RUBEK. – Ai-je dis cela ? C’est possible. (Absorbé par le jeu.) Vois-tu, vois-tu comme les mouettes descendent le courant!
IRÈNE, riant. – Et tous tes bateaux chavirent.
RUBEK, jetant de nouvelles feuilles dans le torrent. J’ai des bateaux de réserve.
Cependant qu’ils jouent sans but, dans une sorte de désespoir d’enfant, Ulfheim et Maïa arrivent sur la lande. Ils vont chercher l’aventure sur les hauts-plateaux. Maïa chante à son mari un petit air qu’elle a inventé dans sa joie insouciante. Ulfheim. lance à Rubek un bonsoir ricanant et disparaît dans la montagne avec sa compagne. La même idée traverse l’esprit du sculpteur et de son amie. Mais à ce moment précis surgit dans le crépuscule la silhouette lugubre de la diaconesse, et son regard lourd s’arrête sur eux deux. Irène prend congé et promet de rencontrer Rubek cette nuit-là sur la lande.
RUBEK. – Tu viendras, Irène ?
IRÈNE. – Je viendrai sans faute. Attends-moi ici.
RUBEK, répète comme en rêve. – Une nuit sur la lande… avec toi… avec toi… (Leurs regards se rencontrent.) Oh ! Irène, c’eût été la vie… et nous l’avons manquée, tous deux.
IRÈNE. – L’irréparable ne nous apparaîtra que… (S’interrompant soudain.)
RUBEK, avec un regard interrogateur. – Que ?…
IRÈNE. – Quand, nous nous réveillerons d’entre les morts.
Le troisième acte se passe sur un vaste plateau, dans la haute montagne. Le sol est déchiré par des crevasses béantes. A droite, les cîmes se perdent dans des nuées errantes. À gauche, une vieille hutte délabrée. À l’heure où le ciel prend des couleurs de perle. On voit le jour poindre. Maïa et Ulfheim. descendent vers le plateau. Le dialogue qui s’engage est assez explicite.
MAïA, essayant de se dégager. – Lâchez-moi ! Lâchez-moi, vous dis-je !
ULFHEIM. – Allons, allons, il ne vous manque plus que de mordre… Vous êtes méchante comme une guêpe.
Comme Ulfheim continue ses agaceries, Maïa menace de le planter là. Il rétorque que sans lui elle se rompra le cou. Afin de n’être pas interrompu, il a sagement envoyé Lars chercher les chiens et ajoute qu’on peut lui faire confiance : les bêtes ne seront pas retrouvées de sitôt.
MAïA, avec un regard courroucé. – Je le sais bien.
ULFHEIM, lui saisissant le bras. Lars, voyez-vous, connaît mes habitudes de sport.
Avec un grand sang-froid, Maïa lui dit alors crûment ce qu’elle pense de lui. Et ses remarques peu flatteuses ont le don de mettre en joie le chasseur d’ours, tandis qu’elle doit faire appel à toute sa présence d’esprit pour le tenir à distance. Lorsqu’elle parle de s’en retourner seule à l’hôtel, il propose fort galamment de la porter sur ses épaules, mais on lui rit au nez. C’est le chat guettant la souris. Au milieu de cette escarmouche, un propos échappe à Ulfheim, qui mérite l’attention, car il éclaire sa vie passée.
ULFHEIM, avec une sourde colère. – Il m’arriva un jour de me charger d’une charmante enfant que j’avais enlevée à la fange des rues pour la porter dans mes bras. Je l’aurais portée ainsi à travers toute la vie, afin qu’elle ne se meure pas aux cailloux du chemin (Avec un gros rire.) Et savez-vous comment elle me récompensa?
MAÏA. – Non, dites !
ULFHEIM, la regarde en souriant et en hochant la tête. – Les cornes que vous distinguiez tout à l’heure… c’est un présent que je tiens d’elle. N’est-ce pas une plaisante histoire, madame la tueuse d’ours ?
Confidence pour confidence, Maïa lui conte brièvement sa vie, sa vie conjugale surtout. Bref, ces deux âmes indécises se sentent attirées l’une vers l’autre, et Ulfheim résume la situation avec beaucoup de pittoresque. «Voulez-vous que nous mettions ensemble nos pauvres haillons ? » Maïa, contente que dans cet engagement il ne soit point question de lui montrer toutes les splendeurs de la terre ni d’emplir d’art sa maison, donne son accord tacite en l’autorisant à la porter jusque dans la vallée. Mais voici que Rubek et Irène arrivent au-devant d’eux. Ils ont aussi passé la nuit sur le plateau et, lorsqu’Ulfheim demande à Rubek s’il est monté par le même chemin que cette dame, le sculpteur répond . « Bien entendu. (Avec un regard vers Maïa.) Madame et moi, nous suivons désormais la même route ».
Cependant qu’ils font assaut d’esprit, les éléments entrent en jeu, comme s’ils comprenaient qu’il y avait là un problème gigantesque à résoudre et qu’un drame poignant avançait vers son dénouement. Les frêles silhouettes de Maïa et d’Ulfheim s’amenuisent encore au seuil de la tempête. Leurs destins se décident dans une paix relative, et ils cessent de nous intéresser vraiment. L’autre couple, au contraire, absorbe toute notre attention, figures centrales d’un intérêt humain infini. Ulfheim montre soudain les cimes du doigt.
ULFHEIM. – Mais vous ne voyez donc pas l’orage au-dessus de nos têtes ? Entendez-vous les rafales ?
RUBEK, écoutant. – On dirait le prélude de la Résurrection des morts.
MAïA, tirant Ulfheim par la manche. – Hâtons-nous de descendre.
Comme il ne peut prendre qu’une personne à,la fois, Ulfheim promet d’envoyer de l’aide et, saisissant Maïa, descend rapidement mais avec précaution. Sur le plateau dénudé, dans la lueur de. l’aube, il n’y a plus d’artiste ni de modèle, mais un homme et une femme face à face. Une grande métamorphose va s’accomplir. Irène dit à Arnold que jamais plus elle ne retournera en bas, elle ne veut pas qu’on vienne la secourir. Elle lui avoue aussi – ne peut-elle désormais tout lui dire – la tentation dévorante qu’elle a eue de le tuer.
RUBEK, d’une voix sombre. – Et pourquoi ne l’as-tu pas fait ?
IRÈNE. – Parce que je m’aperçus tout à coup, avec épouvante, que tu étais mort… depuis longtemps.
Pourtant, dira Rubek, leur amour n’est pas mort, il est encore vivace et ardent dans leur cœur.
IRÈNE. – L’amour, fruit de la vie terrestre, de la vie terrestre faite de merveilles, de beautés, de mystères – cet amour-là est bien mort en nous.
Et puis il y a tous les obstacles de leur vie passée. Ici encore, à l’endroit le plus sublime de la pièce, Ibsen maîtrise sa matière. Son génie n’élude aucun fait. À la fin de Solness le Constructeur déjà, il avait eu une trouvaille géniale ; on se rappelle l’épouvantable phrase: «Oh ! la tête est toute écrasée» Un artiste moins sûr eût baigné cette tragédie d’une lumière spirituelle. Dans son dernier drame, c’est Irène qui souligne qu’elle s’est exposée nue aux regards des hommes, que la société l’a rejetée, qu’il est trop tard. Peu importe à Rubek, qui repousse toutes ces objections.
RUBEK, la saisissant violemment dans ses bras. – Eh bien, veux-tu qu’en une seule fois nous vivions la vie jusqu’au fond… avant de regagner nos tombes
IRÈNE, poussant un cri. -Arnold!
RUBEK. – Mais pas ici dans la pénombre, dans l’horreur de ce linceul humide qui nous enveloppe 1
IRÈNE, dans un élan passionné. – Non, non… dans la splendeur lumineuse des sommets, sur la cime de l’oubli.
RUBEK. – Irène, mon adorée… oui, c’est là que nous célébrerons notre fête nuptiale!
IRÈNE, fièrement. – Le soleil peut nous contempler, Arnold.
RUBEK. – Toutes les puissances de la lumière peuvent nous contempler… et toutes celles des ténèbres aussi. (Il lui saisit la main.) Veux~tu me suivre, ma fiancée de grâce ?
IRÈNE, comme transfigurée. – Je suivrai volontiers, sans réserve, mon maître et seigneur.
RUBEK, l’entraînant. – D’abord, Irène, nous fendrons les brouillards, et puis…
IRÈNE. – Oui, à travers les brouillards, vers les sommets où resplendit le soleil levant.
Les nuées descendent et s’épaississent. Rubek et Irène, la main dans la main, montent, traversant le névé à droite, et disparaissent bientôt dans le brouillard qui tombe. Bruit strident de rafale. La diaconesse apparaît, gravissant l’éboulement à gauche. Elle s’arrête et regarde en silence autour d’elle, cherchant des yeux. Voix de Maïa montant au loin, en un chant joyeux.
MAïA. – Libre, libre, échappée de cage, je fends les airs, oiseau volage, Libre, libre, échappée de cage.
On entend soudain comme un bruit de tonnerre descendant du névé qui s’écroule, et l’on aperçoit vaguement Rubek et Irène entraînés par l’avalanche. L’abîme les engloutit.
La diaconesse, poussant un cri et tendant les bras vers eux : Irène ! Elle reste silencieuse un instant, puis fait un signe de croix sur l’abîme et dit : Que la paix soit avec vous !
On entend encore, venant d’en bas et de plus en plus lointain, le chant joyeux de Maïa.
Telle est, sous une forme grossière et décousue, l’intrigue de ce nouveau drame. L’intérêt, chez Ibsen, ne vient pas de l’action ni des événements. La peinture même des caractères, si, parfaite soit-elle, n’est pas l’élément primordial de ses pièces. Ce qui nous frappe surtout, c’est le drame nu – c’est-à-dire la perception d’une grande vérité, ou l’amorce d’une question essentielle, d’un conflit grave qui existe en dehors des acteurs qui le vivent et dont l’importance, passée comme présente, est immense. Ibsen a choisi, pour ses dernières pièces, de peindre des vies moyennes dans une vérité sans fard[4]. Il a abandonné la forme en vers, et n’a jamais cherché à embellir son œuvre selon les procédés conventionnels. Lors même que son thème dramatique atteignait son point culminant, il n’a pas essayé de le parer d’ornements criards et clinquants. Qu’il eût été facile, pourtant, d’écrire Un Ennemi du peuple sur un ton faussement sublime, en remplaçant le bourgeois par un héros plus spectaculaire ! Les critiques auraient pu alors célébrer le grandiose d’une situation dont ils ont si souvent dénoncé la banalité. Mais le milieu ne compte pas pour Ibsen. Le drame seul importe. Grâce à un génie puissant et à l’habileté consommée qui caractérise toutes ses entreprises, ce dramaturge force, depuis bien des années, l’attention du monde civilisé. Il s’en faut de beaucoup, il est vrai, qu’on lui rende déjà tous les honneurs qui lui sont dûs, mais ce n’est point faute de mérite chez cet homme éminent. Je ne me propose pas d’examiner ici toutes les questions de dramaturgie relatives à cette pièce, mais simplement d’aborder la peinture des caractères.
Jamais les personnages d’Ibsen ne se répètent. Dans ce drame – le dernier d’une longue liste – l’auteur a peint et différencié ses héros avec son adresse habituelle. Quelle création originale qu’Ulfheim ! Certes, la main qui l’a produit n’a rien perdu de son talent. Ulfheim est, selon moi, le caractère le plus nouveau de la pièce, une sorte de pochette surprise. Et c’est pourquoi, dès le début, il surgit vivant sous nos yeux. Il est magnifiquement sauvage et fascinant à la manière des primitifs. Ses yeux farouches roulent et menacent comme ceux de Yégof ou de Herne. Quant à Lars, autant ne pas en parler, car il n’ouvre jamais la bouche. La diaconesse, elle, prend la parole une seule fois, mais fort à propos. Ombre muette à la majesté symbolique, elle suit silencieusement Irène, telle l’image du châtiment.
Irène aussi est digne de figurer en si bonne compagnie. C’est surtout dans ses portraits de femmes qu’apparaît la connaissance profonde qu’Ibsen avait du cœur humain. Il semble les connaître mieux qu’elles ne se connaissent elles-mêmes, et son extrême subtilité nous confond. En vérité, il y a chez Ibsen quelque chose de la femme, si l’on peut dire cela d’un être éminemment viril. Sa précision achevée, de légères traces de féminité, la délicatesse de ses touches vives, pourraient peut-être s’expliquer ainsi. En tous cas, il connaît admirablement les femmes et semble les avoir sondées jusqu’au tréfonds de leur être. Près de ses portraits, les études psychologiques de Hardy et de Tourgueniev ou les élaborations exhaustives de Meredith font pauvre mine. Un trait habile, une phrase, un mot, et il en dit plus long qu’eux dans des chapitres entiers.
La compétition est rude, certes, mais Irène s’en sort à son avantage. Pour être uniformément vraies, les femmes d’Ibsen ne s’en présentent pas moins sous des jours différents. C’est ainsi que si Gina Ekdal est une figure comique, Hedda Gabler, elle, est tragique- si tant est qu’on puisse sans incongruité employer des termes aussi éculés. Mais Irène échappe davantage à la classification, car la passion lui demeure étrangère. Elle exerce sur nous un attrait singulier, quasi-magnétique, dû à sa force de caractère. Pour prodigieuses que soient les créations précédentes d’Ibsen, on peut se demander si un seul de ses personnages féminins avait atteint la profondeur d’Irène. Par la simple puissance de son intelligence, elle accapare notre attention. En outre, c’est un être intensément spirituel – au sens le plus vrai du mot. Son esprit plane au-dessus de celui de Rubek, et nous avons parfois le sentiment d’être dépassés. D’aucuns déploreront que l’auteur ait fait un modèle de cette femme si raffinée, et iront même jusqu’à souhaiter qu’un semblable épisode n’ait point altéré l’harmonie du drame. Je n’approuve aucunement cette opinion qui me paraît hors de propos[5]. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons qu’admirer Ibsen pour la façon dont il traite ce sujet, avec toute la pénétration, toute la mesure et toute la sympathie que nous lui connaissions déjà. Il envisage la situation dans son ensemble, calmement, lucidement, avec hauteur et hardiesse, aussi indifférent qu’un ange[6]. Ibsen diffère donc, en tous points, des pourvoyeurs habituels de la scène.
En dehors de sa valeur d’individu, Maïa assume une fonction précise dans la pièce dont elle rompt la tension. souvent excessive. Sa fraîcheur enjouée est comme un souffle d’air pur. Cet élan vers une vie ardente, sans entraves, qui est son trait dominant, contrebalance l’austérité d’Irène et le sérieux morne de Rubek. Maïa joue ici à peu de choses près le rôle d’Hilda Wangel dans Solness le Constructeur. Mais elle est loin d’attirer notre sympathie comme Nora Helmer. L’auteur a pour elle d’autres intentions.
Rubek est le protagoniste et, chose étrange, le personnage le plus conventionnel de ce drame. Certes, si on le compare à son prédécesseur napoléonien, Jean-Gabriel Borkman, il n’en est qu’un pâle reflet. N’oublions pas, pourtant, que Borkman est vivant, énergiquement, passionnément, frénétiquement vivant, du début à la fin, jusqu’à son trépas. Rubek, lui, est mort,désespérément mort, et c’est seulement au tomber du rideau qu’il revient à la vie. Il est pourtant un caractère fascinant, moins en soi que par sa signification dramatique.
Le théâtre d’Ibsen, je l’ai déjà dit, est totalement indépendant des personnages qui peuvent être mortellement ennuyeux, sans que le drame où ils évoluent perde de sa puissance. Non pas que Rubek nous ennuie! Il est infiniment plus intéressant que Torvald Helmer ou que Tesman, qui ont déjà des traits fort caractéristiques. D’autre part, l’auteur ne se propose point d’en faire un génie, comme Eljert Lovborg. L’eût-il été qu’il eût alors mieux compris le sens de sa vie. Le fait qu’il soit dévoué à son art et qu’il en ait acquis une certaine maîtrise – habileté manuelle mais pensée limitée – nous laisse cependant supposer que gisent peut-être en lui des aptitudes à une vie plus noble, qui seront exploitées lorsqu’il se réveillera d’entre les morts.
Le seul personnage que j’ai négligé est l’inspecteur des bains, et je me hâte de lui rendre justice, chichement il est vrai. Il n’est rien de plus, rien de moins qu’un inspecteur ordinaire des bains. Mais cela, il l’est bien.
Voilà pour la peinture des caractères ; elle est toujours très pénétrante. En dehors des personnages, toutefois, il y aurait quelques remarques à formuler sur certaines intentions dont la fréquence et l’ampleur nous arrêtent. La plus frappante d’entre elles pourrait, à première vue, ne paraître qu’un trait scénique accidentel. C’est du milieu où se déroule le drame que je veux Parler. On est obligé de constater, dans les dernières œuvres d’Ibsen, une tendance à s’évader des intérieurs. Cette évolution se fait sentir depuis Hedda Gabler. Le dernier acte du Constructeur et celui de Jean-Gabriel Borkman ont lieu en plein air. Ici ce sont les trois actes qui se jouent al fresco. Certains. penseront que c’est faire preuve d’un fanatisme outrancier que de s’attacher à de tels détails. Mais ce n’est que payer son tribut à l’œuvre d’un grand artiste. D’ailleurs ce trait saillant me semble des plus significatifs.
On peut aussi remarquer, dans les derniers drames sociaux d’Ibsen, une pitié touchante pour l’humanité, accent nouveau et qui détonne avec l’intransigeance inflexible de ces années 80, La façon dont Rubek modifie la figure féminine de son chef-d’œuvre «Le Jour de la Résurrection» implique toute une philosophie de sagesse et de sympathie envers les multiples contradictions de la vie, qui deviennent ainsi conciliables avec un réveil plein de promesses, lorsque le travail douloureux de notre pauvre humanité aura porté ses fruits. Quant au drame même, il est peu probable qu’on serve une cause juste en essayant de le critiquer. Bien des faits inclineraient à le prouver. Henrik Ibsen est un de ces grands hommes devant qui la critique fait piètre figure. La seule estimation qui vaille, c’est d’écouter et d’apprécier. En outre, cette espèce de critique qui s’intitule dramatique n’est qu’un accessoire parfaitement inutile de ses pièces. Lorsque l’art d’un dramaturge atteint la perfection, les commentaires sont superflus. La vie n’est point faite pour être jugée, mais pour être affrontée et vécue. Et puis, s’il existe des pièces qui réclament une scène, ce sont bien celles d’Ibsen. Et ceci non seulement parce qu’elles n’ont pas été écrites pour encombrer les rayons d’une bibliothèque, mais parce que les idées y abondent. Au hasard d’une phrase un problème surgit qui torture l’esprit et ouvre, en un éclair, d’immenses perspectives. Mais à moins de s’y attarder sciemment, cette découverte n’est que fugitive. Et c’est précisément pour interdire une méditation trop prolongée qu’Ibsen demande à être joué. Enfin, il est ridicule de croire qu’une question qui a préoccupé Ibsen pendant près de trois ans puisse nous paraître lumineuse à première lecture. Mieux vaut donc laisser le drame plaider sa propre cause.
Du moins reste-t-il évident que, dans cette dernière pièce, Ibsen nous a donné sa meilleure mesure. L’action n’est pas paralysée par des complications excessives, comme dans Les Piliers de la Société, ni déchirante de simplicité comme celle des Revenants. Nous avons ici le caprice et l’extravagance chez Ulfheim, l’humour le plus subtil aussi dans le mépris sournois que se témoignent Rubek et Maïa. Mais Ibsen a voulu que rien ne vînt entraver la libre action de son drame. Aussi n’a-t-il point soigné, comme à l’accoutumée, ses personnages secondaires. Dans nombre de ses œuvres, ceux-ci sont des créations achevées. Qu’on songe seulement à Jacob Engstrand, à Tonnesen ou au démoniaque Molvik. Ici, l’auteur ne permet pas que notre intérêt se disperse sur des figures d’arrière-plan.
Quand nous nous réveillerons d’entre les morts rivalise dignement avec les plus belles productions d’Ibsen, peut-être même est-ce son chef-d’œuvre suprême. Dernière d’une liste qui débuta avec Maison de Poupée, cette pièce constitue l’épilogue grandiose d’une longue carrière. Par leur technique comme par l’intérêt qu’ils suscitent, peu de drames anciens ou modernes passent le théâtre d’Ibsen.
James Joyce.
[1] Joyce réagit là contre une tendance des plus répandues dans la critique littéraire et dramatique bourgeoise: la réduction de l’œuvre à, l’anecdote et le jugement soi-disant objectif. N. d. T.
[2] 2 – C’est donc à Ibsen que Joyce semblerait avoir emprunté l’idée de son Ulysse : présenter en vingt-quatre heures la vie entière de ses héros Bloom-Uysse et Stephen-Télémaque. -N. d. T.
[3] Traduction M.- Prozor.
[4] 4 – Tel est exactement, de Dubliners à Finnegans Wake, le programme que Joyce observera lui-même. Comme Ibsen, il choisira ses héros parmi la classe moyenne, et les montrera engagés dans un immense déterminisme à la fois social, cosmique et mythique. N. d~ T.
[5] On jugera, par le besoin qu’éprouve Joyce de justifier cette « audace », du puritanisme de la société dans laquelle il suffoquait. N. d. T
[6] Telle est peut-être l’influence essentielle qu’Ibsen a pu exercer sur le romancier ; le détachement vis-à-vis de ses héros restera le trait le plus frappant de l’œuvre joycienne. Cf. Dedalus . « L’artiste, comme le Dieu de la création, reste à l’intérieur, ou derrière, ou au-delà, ou au-dessus de son œuvre, invisible, subtilisé, hors de l’existence, indifférent, en train de se curer les ongles. » N, d. T.