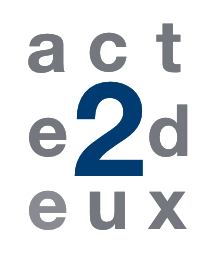Extraits de Presse / Entre courir et voler y a qu’un pas papa
L’Échappée belle de Jacques Gamblin. « Je ne savais plus si j’étais encore né ou si j’étais déjà mort ». S’il fallait retenir une phrase de la pièce adaptée de son livre, Entre courir et voler il n’y a qu’un pas papa, que Jacques Gamblin joue jusqu’au 8 février au Théâtre de Saint Quentin-en-Yvelines, ce serait peut-être celle-là. Parce qu’entre la naissance et la mort, il y a la vie, c’est sûr. Cette vie que le personnage de Jacques tente de rattraper, à moins qu’il ne la fuie parce qu’il en a peur. Jacques ne sait plus très bien pourquoi il est. Alors il court, éperdument, sur la bande d’arrêt d’urgence où il a abandonné sa voiture. Et on le suit, dans ce monologue effréné, très joliment mis en scène par Claude Baqué. Une mise ne scène sobre, dépouillée, avec juste ce qu’il faut de décor, de bande-son, de projection vidéo. Intervenant par touches, accompagnant les courbes du texte. Comme les virgules que Jacques Gamblin injecte dans un monologue qui aborde des sujets graves, avec légèreté, et beaucoup de délicatesse.
Caroline Braud, Le Parisien – 3 février 2004
L’élan Gamblin. La beauté de Jacques Gamblin n’est dépourvue ni d’hésitation ni de fragilité. Elle s’appuie même sur l’une et l’autre, c’est un muscle qui vacille. Son nouveau et second spectacle met en scène, comme le précédent, un homme qui se raconte, ou plutôt s’ébauche, à travers son corps en action. ?Dans Le Toucher de la hanche, écrit en 1997, il était danseur. Cette fois, il est marathonien. Toujours seul sur scène, il dégurgite comme un adolescent gracieux et gêné ce texte assez autobiographique. Il le dit sur une «quatre voies» de traviole, ondulant comme sous l’effet d’un alcool ou d’un tremblement de terre. L’existence a de ces dos-d’âne et Gamblin a quelques raisons d’être perturbé : sa fille naît, son père meurt. Entre les deux, il court, il court, du kilomètre 271 au kilomètre 313. Un marathon vers la Normandie natale qui n’achève ni ses chevaux ni ses rêves, mais les perturbe de manière sensible et subtile.? Aérien. Tout commence par l’histoire d’un homme qui trouve que sa voiture porte à droite. Il est le seul. Ni le garagiste ni sa femme ni ses amis, n’éprouvent la même chose que lui. Il est comme le personnage d’un roman d’Emmanuel Carrère, qui croit s’être rasé la moustache, mais s’aperçoit que personne autour de lui ne l’a jamais vu avec. La comparaison s’arrête là. L’homme à la moustache s’enlisait dans un malaise ne pouvant ouvrir que sur la folie et la mort. L’homme de Gamblin est plus aérien, presque naïf. Sa faiblesse face aux bouleversements intimes le saoule de perceptions. Il court seul sur la route dans la nuit. Il devient violent avec ceux qui le contrarient. Il ne sait plus vraiment quel est le sens de la course. Mais, finalement, il s’en sort : la grâce est la plus forte. ?Nuages de mots. Jacques Gamblin ne dit pas son texte : il le lâche en riant, en pouffant, en soufflant, comme si les mots intimidaient son existence. Le décor d’une route qui déraille est bien utilisé. L’acteur s’allonge sur les ondulations. Il s’installe dans un trou au sommet d’un mamelon. Il fait reposer son corps sur un seul bras, le long d’une pente. Il se dénude peu à peu, tous muscles dehors, comme pour renaître en compagnie du vivant (sa fille) et du mort (son père).? Le texte n’est pas linéaire mais brossé, guidé et haché par les impressions, les souvenirs, les angoisses. Le corps est traversé par ces nuages de mots, sans autre logique que celle du coeur. Il ne faut pas chercher à tout saisir, à tout mettre en ordre. Simplement suivre l’homme en spectacle dans ses détours et jusque dans ses ratés. La beauté est imparfaite, Gamblin aussi, tant mieux.
Philippe LANÇON, Libération
Il n’est que légèreté, envol. Il n’est que grâce, allant. Il a le délié nerveux des athlètes. Il court, il file (…). C’est saisissant, Jacques Gamblin auteur et acteur est un enfant de Raymond Devos. C’est la même poésie, la même humeur de jongleur, la même époustouflante virtuosité (…). C’est fluide et enlevé, moiré. Un enchantement, de cocasserie à profonde émotion, de rire franc à sourire, et jusqu’aux larmes tant il y a dans ce Gamblin des ferments de chagrin qui n’interdisent pas la joie pourtant… On aimerait demeurer longtemps encore avec lui. On devine les rayons du soleil…
Armelle Héliot, Le Figaro
Des kilomètres avant l’âge d’homme Trop-plein. Dans Entre courir et voler il n’y a qu’un pas papa, Jacques Gamblin nous touche avec son texte, où l’acte de courir évince l’angoisse. Quand il ne descend pas en courant les gradins jusqu’à la scène, une route artificielle, bitume, bosses et bandes blanches, Jacques Gamblin raconte ses heures passées à courir. Une course compulsive, de fond. Entêtant est ce besoin de courir et, tout autant, celui de comprendre pourquoi.?Le spectacle Entre courir et voler il n’y a qu’un pas papa est d’abord un roman révélant une sensualité intuitive du langage. Et une cocasserie jumelée à l’angoisse. L’auteur-comédien y avance un peu au fil de la plume. Ses mots, loin de la phrase classique, courent eux aussi comme pour laisser de la page aux suivants. « Courir comme on pense », lit-on.
Aude Brédy, L’Humanité
La course de la vie racontée par Jacques Gamblin, un régal ! Voilà un homme jeté dans la course de la vie, une quête mêlée de joies et de douleurs, de vie et de mort, un élan éperdu profondément habité et porté par les êtres aimés. Le père, qui parle très peu, la femme, prête à accoucher, et l’enfant à naître. Le texte écrit et interprété par Jacques Gamblin montre le corps et l’esprit en mouvement, sur un ruban d’asphalte factice astucieusement bosselé. Par monts et par vaux, sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute, l’homme né près des dunes et de l’herbe grasse qu’on imagine normandes court. Entre chien et loup, il raconte sa vie, et même la vie tout court, entre tendres fulgurances, rancoeurs passagères et acceptations fondamentales – par exemple la volonté d’être père. Il nous dit d’ailleurs que 8700 femmes accouchent toutes les heures sur terre, ce qui est peut-être vrai. ?13435 heures assis à écouter les maîtres et les professeurs Les questions fusent, les réponses se bousculent, et le jeu inventif de l’acteur traduit à merveille comment les nouvelles du monde rebondissent sur l’homme, depuis les rendez-vous ratés de l’enfance, jusqu’au désir de réussir et de maîtriser les lignes qu’il doit franchir. Il a passé 13435 heures assis à écouter les maîtres et les professeurs (« peut mieux faire » , résume-t-il sobrement). Le spectacle parle à tous les publics, mais ne sombre jamais dans la guimauve ou les clichés. Car l’athlète en lice sait faire surgir des bribes de poésie et de rêve au cœur du réel, il a du souffle, du rythme et du répondant. Qui dit course pense aussi début et fin, mais le bonheur ou plus simplement la finalité de l’action se confond ici avec la maîtrise de soi et la richesse de l’imaginaire, avec l’effort même du coureur qui est la véritable raison de la course. Comme un rite initiatique joyeux pour masquer la noirceur du monde, pour dépasser ses peurs et accepter de vivre au mieux, malgré les proches qui sont partis.
Agnès Santi, La Terrasse
Un enfant de haut vol Il est unique. Il écrit comme il respire, il joue comme il court. Un athlète. Un affectif. Un ultra-sensible. Jamais sans doute il n’avait donné au public le plus large autant de preuves de la force de sa personnalité et de l’audace de ses propositions.?ICI, dans ces colonnes, on le disait depuis longtemps. Alors on est content : Jacques Gamblin est un enfant de haut vol. On pense, et on ne craint pas de l’écrire, qu’il est un rejeton de Raymond Devos. On prend cette évidence de plein fouet en découvrant et le texte, et l’interprétation, et la mise en scène. (…) Dans un décor de route bitumée (Alain Burkarth), avec ses signalisations au sol, Jacques Gamblin va son texte avec la fraîcheur d’un innocent qui raconterait ses aventures sans prendre la mesure de leur démesure… On le suivrait au bout du monde ce personnage un peu paumé, cet ahuri, ce désarmé-désarmant. Et l’on suit Jacques Gamblin, fin, délié, nerveux, un être tout en haute souplesse, en muscles longs, en charme. Ses radieux sourires, son élégance, la précision de son interprétation musicale, au soupir près.?On ne parle pas du fond. ?On vous laisse découvrir ce très original poète du quotidien qu’est Jacques Gamblin. Sa capacité de faire du plus prosaïque, quelque chose qui flambe et nous transfigure. A la fin, sous la couverture de survie fine comme du papier à chocolat et dorée comme les rayons du soleil qu’il contemple, vieux sage, vieil indien, on n’a qu’une envie. Rester là, ne pas rompre le charme.
Armelle Héliot, Le Quotidien du médecin
Seul sur scène, Jacques Gamblin mime une course interminable pendant 1h30 où il déroule au rythme de ses foulées, les événements de sa vie, la perte des êtres chers, les joies et douleurs du quotidien, les horreurs des voitures qui tirent à droite, la peur obsessionnelle, la naissance d’un enfant…?Réel et imaginaire s’entremêlent dans un texte plein de poésie et d’humour où Gamblin , corps et esprit toujours en éveil s’interrogent sur tout ce que l’on fait sans y penser, sur la nécessité (est-ce si nécessaire ?) de passer 13 435 heures assis à écouter maîtres et professeurs… « Peut mieux faire » conclut-il.?L’effort du coureur, véritable raison de la course, est un rite pour dépasser ses peurs et accepter la vie telle qu’elle est. Avec l’humour si particulier de Jacques Gamblin, le spectateur rêve au cœur du réel.?L’effort de l’athlète mène à la maîtrise de soi et à l’acceptation de la perte des êtres aimés. Tout en courant, Gamblin raconte sa vie, rêve et vocifère, prenant son public à témoin des incongruités ou des beautés de la vie.?Très poétique, plein d’humour.
Jeannine Schneider, Exit Paris