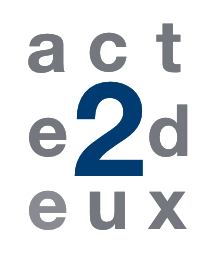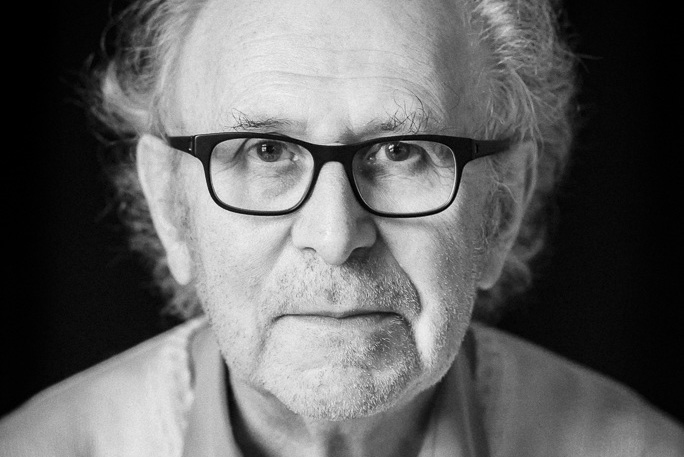Écrits / Sur Henrik Ibsen
Jean-Pierre Sarrazac
Théâtre intimes
L'Épilogue ibsénien
 Extrait de Théâtres intimes, Actes Sud, 1989
Extrait de Théâtres intimes, Actes Sud, 1989
« Epilogue dramatique » : c’est ainsi qu’Ibsen qualifiait Quand nous nous réveillerons d’entre les morts (1899), la pièce qui, écrite peu avant son attaque d’apoplexie, fut son ultime œuvre littéraire. La formule convient parfaitement à ce drame où un grand sculpteur et son ancien modèle ne se retrouvent après des années de séparation que pour se déclarer leur amour mutuel et marcher ensemble à la rencontre de la mort ; mais elle éclaire également la production dramatique antérieure de l’écrivain norvégien depuis Maison de poupée (1879). Chacun des drames intimes – ou « domestiques » – d’Ibsen se présente, en effet, comme l’épilogue d’un roman non écrit dont la matière constituerait la trame et l’aliment exclusif de l’action dramatique. Lorsqu’ils entrent en scène, les personnages de Hedda Gabler ou de Rosmersholm, du Canard sauvage ou de Solness le constructeur ont déjà incubé comme une maladie ce « roman familial » qui couvre leur existence commune et remonte jusqu’avant leur naissance. Il ne leur reste plus qu’à en jouer le climax, le dénouement, la Catastrophe. « Tout est déjà là et n’est que porté au jour », pour reprendre l’analyse d’Œdipe roi par Schiller déjà appliquée par Peter Szondi au drame ibsénien.
Cependant, dans la dramaturgie ibsénienne, à la différence de la sophocléenne, ce sont moins des faits – comme avoir tué son père et épousé sa mère – qui émergent du passé et contaminent le présent qu’un sentiment diffus de culpabilité. Objectivement, les personnages ibséniens n’ont rien de plus grave à se reprocher que quelques lâchetés, négligences ou malversations ordinaires. Subjectivement, ils se sentent coupables au dernier degré. Chez Ibsen, le tragique n’est pas relié à un événement ou à une fatalité extérieurs au personnage mais déterminé par un état et une évolution psychiques internes qui, à la limite, n’ont d’existence que pour ce seul personnage. A l’inverse de l’Œdipe de Sophocle, qui reste jusqu’au dernier moment dans l’ignorance de la faute qu’il a commise malgré lui, le personnage ibsénien est, d’entrée de jeu, miné par le sentiment d’une faute qu’il n’a peut-être pas commise.
Dans l’intime de l’être…
Maeterlinck a donné un nom paradoxal à ce tragique moderne qui s’impose à partir d’Ibsen; il l’a appelé le « tragique du bonheur ». Tragique de la « vie immobile » que traduira un « théâtre statique » : « Est-il donc hasardeux, s’interroge le poète et dramaturge belge, d’affirmer que le véritable tragique de la vie, le tragique normal, profond et général, ne commence qu’au moment où ce qu’on appelle les aventures, les douleurs et les dangers sont passés ? Le bonheur n’aurait-il pas le bras plus long que le malheur et certaines de ses forces ne s’approcheraient-elles pas davantage de l’âme humaine ? ( … ) N’est-ce pas quand un homme se croit à l’abri de la mort extérieure que l’étrange et silencieuse tragédie de l’être et de l’immensité ouvre vraiment les portes de son théâtre? » Hedda Gabler ou Hialmar Ekdal nous paraissent d’autant plus pitoyables que le bonheur – entendons une existence familiale paisible et harmonieuse – est à tout moment à portée de leur main et qu’ils sont incapables de le saisir, et qu’ils se laissent submerger par un malheur d’origine inconnue, souterraine. L’être intime des principaux personnages ibséniens est le site de cette fatale résurgence, le lieu où ils ne cessent de ruminer, de ressasser, jusqu’à la Catastrophe, en une sorte de cure mortifère, de psychanalyse à l’envers, leur « roman familial ». Après celle du grand (Edipe, le théâtre d’Ibsen n’inaugure-t-il pas l’ère des petits œdipes que nous sommes tous au-dedans de nous-mêmes ? Métamorphose que nous avait laissé pressentir, en se situant à mi-chemin du héros antique et du « petit homme » moderne, le Hamlet de Shakespeare.
Déjà Hamlet puisait son infortune dans ses soupçons, dans ses visions et dans ses fantasmes ; son destin procédait d’une intériorité maladive tout autant que de l’événement extérieur. Hedda et Hialmar parachèvent cette subjectivisation du malheur. Le tragique moderne, dont Ibsen établit les prémices, ne nous donne plus à voir la grandiose culbute d’un héros mais le périple immobile, le long stationnement au bord du vide d’hommes ordinaires en proie à la pulsion de mort. La névrose et tout le cortège des maladies de l’âme font leur entrée sur la scène. Désormais, les retournements de fortune, les péripéties n’auront d’autre théâtre que celui de l’être intime. Ainsi de la Rebecca West de Rosmersbolm, que Freud, précisément, érigera en personnage emblématique de ces névrosés qui « échouent devant le succès » : après avoir souhaité conquérir Rosmer et son domaine et au moment où cet homme lui propose le mariage, elle ne consent qu’à aller se jeter dans le torrent avec lui. Quelques années avant les principales découvertes du freudisme, Ibsen dote ses personnages d’une psyché qui déborde largement leur conscience et ne cesse de la troubler. Et, tout en prétendant préserver l’intégrité de la forme et de l’action dramatiques, il transforme la scène, quasiment malgré lui, en un écran sur lequel seront projetés les scénarios fantasmatiques et les pulsions inconscientes de ses personnages.
Le rôle-titre du Petit Eyolf, un garçon infirme de neuf ans, meurt par noyade – d’une mort qui ressemble étrangement à un suicide – à l’instant même où, sur la scène, sa mère est en train de trahir, devant son mari, son désir subconscient de cette disparition :
« RITA. Tu ne peux pas prononcer le nom d’Eyolf sans émotion, sans que ta voix tremble. (D’une voix menaçante, les poings serrés.) Ah ! je souhaiterais presque… Enfin!
ALLMERS (avec un regard anxieux). Que souhaiterais-tu, Rita ?…
RITA (avec emportement, s’écartant de lui). Non, non, non, je ne veux pas le dire. Je ne le dirai pas!
ALLMERS (s’approchant d’elle). Rita !Pour ton propre bonheur comme pour le mien, je t’en supplie, ne te laisse pas aller à de mauvaises pensées. »
La coïncidence entre la pulsion infanticide jusqu’alors refoulée et le tragique « accident » est trop forte pour qu’on n’invoque pas ce chapitre clé de l’Interprétation des rêves où il est question du « rêve de la mort de personnes chères ». D’autant que l’émergence progressive du roman implicite confirme l’hypothèse d’une cohérence onirique du drame de la mort du Petit Eyolf. Un peu plus tard, Allmers prend Asta à témoin de son désespoir et lui demande : « Est-ce donc vrai, Asta ? Ou suis-je devenu fou? Ou bien n’est-ce qu’un songe ? Oh, si ce n’était qu’un songe ! Quelle joie, dis, si j’allais m’éveiller? » Gageons que, si Allmers était un simple mortel et non point un personnage de théâtre – d’un théâtre qui explore les régions les plus secrètes de l’âme -, il s’éveillerait… ainsi qu’il nous arrive, à chaque fois que nous rêvons de la mort d’un être cher et que ce cauchemar nous devient insupportable !… On apprendra également qu’Eyolf – le Grand Eyolf – est le prénom masculin dont Allmers affublait dans l’enfance (sans doute pour masquer une attirance incestueuse) sa demi-sœur Asta et que Rita, épouse sensuelle et jalouse d’Allmers, a découvert cette communauté de prénoms entre son fils et sa belle-sœur. Quant au dialogue conflictuel qui s’instaure entre les époux, après la mort du Petit Eyolf, c’est une mine de révélations.
Lorsque le Petit Eyolf a fait, étant bébé, cette chute qui l’a rendu infirme, ses parents étaient en train de faire l’amour. « Il dormait d’un si bon sommeil », objecte Rita pour se disculper ; mais, quelques répliques plus tôt, confondant ce premier accident et le second, qui fut fatal à l’enfant, elle se contredit et évoque un Petit Eyolf « étendu au fond du fjord. Tout au fond, sous l’eau transparente ( … ) étendu sur le dos, les yeux grands ouverts ». C’est donc sous le regard bien ouvert de son fils que Rita se revoit faisant l’amour avec son mari.
Comment, dès lors, ne pas reconnaître, dans ce que Rita appelle pudiquement 1″‘heure furtive ( … ) cette heure de feu et d’irrésistible beauté », la scène originaire freudienne dont Rita et Allmers restent à jamais les acteurs culpabilisés et le Petit Eyolf l’innocente victime ? « Qui sait, s’interroge Allmers, s’il n’y a pas deux grands yeux d’enfant qui nous regardent nuit et jour ? »… Le roman personnel sous-jacent au drame est constitué par un réseau serré de pensées associatives où s’exprime, selon un processus analogue à l’anamnèse de la psychanalyse, l’inconscient des personnages. Force est de se rendre à l’intuition de Maeterlinck selon laquelle Ibsen aurait « tenté de mêler dans une même expression le dialogue intérieur et extérieur. ( … ) Tout ce qui s’y dit cache et découvre à la fois les sources d’une vie inconnue. Et si nous sommes étonnés par moments, il ne faut pas perdre de vue que notre âme est souvent, à nos propres yeux, une puissance très folle, et qu’il y a en l’homme des régions plus fécondes, plus profondes et plus intéressantes que celle de la raison ou de l’intelligence… » Contrairement à ce que fera plus tard O’Neill, distinguant et articulant, dans L’Etrange Intermède, dialogue et monologue intérieur, Ibsen prépare en secret l’amalgame du dialogue extérieur et du soliloque intime, du réalisme et de l’onirisme. A nous de savoir entendre l’inconscient des personnages et voir 1″‘autre scène » derrière le réalisme bourgeois apparent de cette dramaturgie. Toujours est-il que l’intime du personnage ibsénien se trouve mis à découvert. À la différence du drame bourgeois, l’intimité n’apparaît plus ici comme le vêtement négligé et confortable de l’individu socialisé, mais comme une dernière protection, qui ne peut manquer de tomber, serait-ce au prix d’une désintégration de l’être lui-même.
Avec Ibsen, pour la première fois au théâtre, le drame domestique devient drame intime. L‘intrasubjectivité (relation du personnage avec la part inconnue de lui-même) empiète sur l’intersubjectivité (relation que les différents personnages entretiennent ensemble) ; la parole intime prend le pas sur la parole partagée. Aussi perspicaces qu’elles soient, les analyses de Peter Szondi sous-estiment le rôle de l’intime et de la subjectivité dans la dramaturgie ibsénienne. « La représentation dramatique ibsénienne, peut-on lire dans Théorie du drame moderne, reste reléguée dans le passé et dans l’intériorité. C’est bien là le problème de la forme dramatique chez Ibsen’. » Il est vrai que, dans presque tous ses drames domestiques, Ibsen croit devoir compenser le déficit en action dramatique qu’engendrent l’intériorisation et la rétrospection par un mouvement et une construction dramatiques « scribéens » en trompe-l’œil. Quelquefois, en effet, on est frappé par une contradiction flagrante entre la forme et la matière du drame : rythmes antagoniques du travail intérieur de remémoration et du carrousel endiablé de personnages qui, dans Hedda Gabler, ne font qu’entrer et sortir; antinomie de la multiplication et de la succession rapide des scènes avec la lenteur obligée des conversations… Il n’en reste pas moins que la critique de Szondi, trop prompte à démêler une crise définitive de la forme dramatique et peut-être aveuglée par son allégeance au théâtre épique de Brecht, passe à côté de l’apport décisif du théâtre d’Ibsen : l’invention d’une dramaturgie de la subjectivité (cette même subjectivité sur laquelle le théâtre de Brecht fera l’impasse) dont le ressort principal est, précisément, le travail du passé dans l’intériorité.
Maison hantée, vie fantôme
Le drame ibsénien reprend la structure spatiale du drame bourgeois – le fameux « salon » -, mais en la retournant. Dans le théâtre des Lumières, l’espace intérieur, celui de l’intimité familiale, est constamment menacé par un espace extérieur fauteur de troubles : la crise du Père de famille de Diderot s’ouvre avec une maisonnée en alarme parce que le fils, Saint-Albin, vient de découcher pour la première fois, et elle ne se résoudra que lorsque ce même Saint-Albin sera parvenu à faire accepter par son père et dans sa maison cette Sophie qu’il était allé retrouver dans sa mansarde. Dans les pièces d’Ibsen, au contraire, malheurs et malédictions sont d’emblée installés dans la maison, au cœur de l’espace intime. Des années durant, Mme Alving, des Revenants, a éloigné son fils de sa propre maison afin de le protéger d’un « milieu de souillure » où il ne pouvait que « s’empoisonner ». D’apparence calme et immobile (« Ici, c’est toujours aussi calme. Les jours se suivent et se ressemblent », note Rebecca West au début de Rosmersbolm), la maison ibsénienne renferme un air corrompu par d’anciennes et inexpugnables fautes et par des scandales d’autant plus pernicieux qu’ils ont été étouffés entre les quatre murs. Respirer l’atmosphère de la maison suffit à se charger de ces fautes et à endosser la culpabilité des scandales. « Tout cela dans cette maison, dans cette maison ! » s’écrie le pasteur Manders lorsqu’il apprend la vérité sur le capitaine Alving, sa vie de débauche et ses amours ancillaires. La veuve, qui vient de faire cet aveu, n’a plus elle-même la force de rejeter la faute sur son défunt mari s’adressant à son fils, elle s’enlise dans la culpabilité ‘le crains d’avoir rendu la maison insupportable à ton pauvre père, Oswald. »
L’espace extérieur – le « fjord mélancolique » – n’est certes pas moins sombre que celui de la maison, mais, ici, la nature, le cosmos ne font que refléter l’espace intime, comme ces premiers rayons du soleil matinal qui déclencheront la folie autodestructrice d’Oswald
« Mère, donne-moi le soleil ( … ) le soleil… le soleil !… » Un lieu hanté où les morts pèsent sur les vivants et déterminent leur existence, telle est la maison. Une fois refermée l’heureuse parenthèse des années de jeunesse passées à Paris, Oswald se replie « comme un mort vivant » dans la maison qui l’a vu naître ; il tente de séduire la jeune bonne – qui se révélera sa demi-sœur : la fille naturelle du capitaine et d’une domestique – et, sous le regard halluciné de sa mère, reproduit les comportements de son père:
« MADAME ALVING. Des revenants. Le couple du jardin d’hiver qui revient ( … ).
LE PASTEUR. Comment avez-vous dit ?
MADAME ALVING. J’ai dit un monde de revenants. Quand j’ai entendu là, à côté, Régine et Oswald, ç’a été comme si le passé s’était dressé devant moi. Mais je suis près de croire, pasteur, que nous sommes tous des revenants. Ce n’est pas seulement le sang de nos père et mère qui coule en nous, c’est encore une espèce d’idée détruite, une sorte de croyance morte, et tout ce qui s’ensuit. Cela ne vit pas, mais ce n’en est pas moins là, au fond de nous-mêmes, et jamais nous ne pourrons nous en délivrer. »
Quant à la belle, sensuelle et libre Rebecca West, j’ai déjà évoqué la dégradation progressive, sous l’emprise de la « Maison-Rosmer », de son appétit de la vie et de l’amour en un besoin de paix que les psychanalystes appelleraient « pulsion de nirvâna » : « Rosmersholm m’a volé ma force. Ici, on a rogné les ailes de ma volonté. On m’a mutilée. Le temps n’est plus où j’aurais pu oser n’importe quoi. J’ai perdu la faculté d’agir, Rosmer ( … ). C’est arrivé peu à peu – tu comprends. C’était presque imperceptible au début – et à la fin tout était changé. J’ai été atteinte jusqu’au fond de mon âme ( … ). Tout le reste – ce qui était laid – le désir, l’ivresse des sens – m’a paru si loin, si loin. Toute cette agitation des instincts s’est calmée – jusqu’au silence. J’ai connu une paix profonde – un silence comme celui qui règne là-haut, chez nous, sous le soleil de minuit, sur les rochers où nichent les oiseaux. »
Toutes les maisons ibséniennes sont pareilles à Rosmersholm – « où, comme l’écrit Bernard Dort, les enfants ne crient pas et où personne ne rit jamais. » : maisons hantées, maisons-tombeaux. Si la maison possède ce pouvoir mortifère, c’est qu’elle n’est pas ou n’est plus, pour reprendre un terme qui exprime toute la nostalgie de Solness l’architecte, un « foyer »… « Abandonner ton foyer, ton mari, tes enfants ! » s’exclame Helmer lorsque Nora lui fait part de sa décision de déserter le domicile conjugal ; et l’épouse de rétorquer que ce « foyer » n’est plus, dès lors que l’amour s’en est retiré, qu’une « maison » : « J’avais vécu dans cette maison huit années avec un étranger et ( … ) j’avais eu trois enfants… Ah! je ne puis seulement pas y penser! » « Maison de poupée », qui ne saurait produire qu’une vie naine, atrophiée, mutilée. De même que l’espace extérieur – immensité neigeuse ou océane – métaphorise l’aridité intime, l’espace intérieur trahit l’humanité blessée de ceux qui l’habitent. jamais le « grand salon » de Hedda Gabler ne deviendra ce lieu intime où pourrait se consolider le couple disparate que forment la fille du général et Tessman, son époux : à la première, il manquera toujours un nouveau piano, un maître d’hôtel, une vie mondaine pour que ce lieu corresponde à ses fantasmes d’aristocrate ; et, sur le second, cette demeure trop luxueuse, à l’opposé du « foyer » dont il rêvait, pèsera toujours comme un fardeau. Le Canard sauvage illustre parfaitement ce conflit de la maison et du foyer. Tout le drame se trouve résumé dans l’opposition de l’imposante maison de l’industriel Haakon Werlé, fréquentée par les notables, et du modeste foyer qui abrite Hialmar Hekdal, son épouse Gina, leur fille Hedwige et le Vieil Hekdal, ancien associé de Werlé mis au rancart. Par l’entremise de Grégoire Werlé, fils d’Haakon et dangereux sectateur de la vérité, la maison va ruiner le foyer, provoquer le rejet par Hialmar de sa vie familiale et le suicide d’Hedwige.
Mais la funeste domination du foyer par la maison renvoie, bien sûr, à un autre écrasement : celui de la conscience des personnages par ces puissances invisibles qui hantent leur être intime. Freud a mis en lumière l’analogie de la maison et du moi: « Dans certaines maladies et de fait dans les névroses ( … ) le moi se sent mal à l’aise, il touche aux limites de sa puissance en sa propre maison, l’âme. Des pensées surgissent subitement dont on ne sait d’où elles viennent ; on n’est pas non plus capable de les chasser. Ces hôtes étrangers semblent même plus forts que ceux qui sont soumis au moi. » Cette part occulte de lui-même, son inconscient, le Solness d’Ibsen lui a même donné un nom imagé : il l’appelle « ses trolls », du nom des génies qui hantent Peer Gynt… Ainsi se présentent la plupart des créatures d’Ibsen : leur moi « n’est pas, dirait Freud, maître dans (leur) propre maison ». La partie obscure de leur psyché annihile en eux l’instinct de vie, les métamorphose en « morts vivants » et transforme leur existence en un fantôme de vie. Les personnages ne cessent de pleurer leur « vie perdue », leur « vie gâchée » (Allmers, dans Le Petit Eyo~f- « Il n’y a plus pour moi de vie à vivre » ; Irène à Rubek, dans Quand nous nous réveillerons d’entre les morts – « Le désir de vivre est mort en moi, Arnold ( … ). Je m’aperçois que toi et la vie… vous n’êtes que des cadavres au tombeau… comme je le fus moi-même »), et ce leitmotiv structure le drame, lui confère sa structure spatio-temporelle.
Avant-dernière pièce d’Ibsen, Jean-Gabriel Borkman porte ces thèmes fondamentaux à leur point culminant. La grande maison de Jean-Gabriel Borkman, qui fut autrefois riche et puissante, n’est plus qu’une espèce de caveau conjugal où se tiennent emmurés, dans deux appartements différents, l’ex-banquier et son épouse Gunhild. Depuis de longues années, les époux ruminent séparément à huis clos la chute de leur empire et de leur maison. Lorsque Borkman a la velléité de sortir de son enfermement volontaire, de renouer avec la vie en reprenant ce combat financier messianique qui l’entraîna jadis en prison, Gunhild le renvoie implacablement à son état de mort vivant:
« BORKMAN. On dirait vraiment que je suis mort!
MADAME BORKMAN (d’un ton ferme). Tu l’es(… )Ne rêve plus jamais de vivre ! Reste étendu où tu es
Au vrai, ce n’est pas tant l’expiation du crime financier que celle d’une faute plus secrète, un crime contre l’amour, progressivement révélé au cours de la pièce, qui a transformé la demeure des Borkman en maison hantée et leur existence en vie fantôme. Borkman a, dans sa jeunesse, renoncé à son amour partagé pour Ella, la sœur jumelle de son épouse Gunhild, afin de mieux asseoir sa puissance. « Tu es un meurtrier! jette à la figure de Borkman Ella, sa belle-sœur. Tu as commis le grand péché de mort ! ( … ) Tu as tué en moi la vie d’amour ( … ). Tu n’as pas craint de sacrifier à ta cupidité ce que tu avais de plus cher au monde. En cela tu as été doublement criminel. Tu as assassiné ta propre âme et la mienne ! » Pulsion de vie retournée en pulsion de mort ; existence convertie en deuil permanent.
Le propre de la névrose, nous dit Freud, est de rendre l’amour impossible. Et ce manque plonge les personnages ibséniens au plus profond de la mélancolie. De même que la psychanalyse nous ramène des conflits que nous vivons avec d’autres individus vers ceux que nous avions, sans le savoir, avec nous-mêmes, le théâtre d’Ibsen fait parcourir à ses personnages le chemin qui les conduit de leurs affrontements avec leurs proches, leur entourage, la société jusqu’à leurs déchirements intimes. Dans les deux cas, cela se fait à la faveur d’une émergence progressive des pensées inconscientes. « Il est si facile de perdre la mémoire de soi-même », constate Mme Alving. Tout au long du drame ibsénien, ce n’est pas seulement le passé des personnages – leur roman familial – qui remonte à la conscience des personnages, mais, comme dans une psychanalyse, ce qui, dans ce passé, fait sens, ce qui a été refoulé et, du même coup, se répète inconsciemment dans le présent et obère l’avenir. Mais l’analogie du théâtre ibsénien et de la psychanalyse s’arrête là : le but de celle-ci est de tenter de rendre à la vie ses patients ; la tension de celui-là, théâtre du tragique domestique et intime, ne saurait être que la mise à mort du personnage : la pulsion de mort dans son cours irrépressible et suicidaire, telle qu’elle s’exprime dans l’objurgation d’Oswald à sa mère, Mme Alving : « Quelle sorte de vie m’as-tu donnée? je n’en veux pas! Reprends-la ! «
Scène d’amour au seuil de la mort
Le cours de la « vie perdue » n’est pas susceptible d’être redressé. Le seul salut que puissent espérer les personnages, c’est une miraculeuse renaissance, un « réveil d’entre les morts » à la fois intime et cosmique, un « revivre » aussi éclatant qu’éphémère. « Oh! Que ne puis-je revivre ! – faire que tout cela ne soit pas arrivé ! » s’exclame Oswald, le petit œdipe, dans ce même délire où il demande à sa mère de lui donner le soleil. Eblouissement : ultime et première jouissance concomitante d’une mort dont la mère serait la pourvoyeuse. Dételer cette « vie gâchée » et en inaugurer une nouvelle, fût-elle extrêmement brève, fût-elle rêvée, c’est le sens de l’épilogue, de la Catastrophe en forme de Gloire qui clôt plusieurs drames d’Ibsen. Epilogue doit ici être entendu dans une seconde signification, complémentaire de celle, précédemment dégagée, qui fait du drame le dénouement du roman non écrit : une scène d’amour au seuil de la mort présente, en filigrane, dans toutes les pièces et, de façon manifeste, dans Rosmersbolm et dans la dernière, Quand nous nous réveillerons d’entre les morts.
Aux dernières secondes de Rosmersbolm, Mme Helseth, la gouvernante, se fait, auprès du public, la messagère quelque peu mystifiée de la bienfaisante Catastropbe: » (regardant autour d’elle). Sortis ? Dehors, tous les deux, à cette heure-ci ( … ). (Se dirigeant vers là,fenêtre et regardant au-dehors.) Seigneur Jésus ! Cette tache blanche, là-bas_ ! Oh, mon Dieu, ils sont tous les deux sur le pont ! Ayez pitié des pauvres pécheurs. Ne voilà-t-il pas qu’ils s’embrassent ! (Poussant un grand cri.) Oh – par-dessus le parapet -, tous les deux ! Droit dans le torrent. Au secours ! Au secours ! » Quant aux amants de Quand nous nous réveillerons d’entre les morts, ils mettent fin à des années de vie « séparée » et « gâchée » en escaladant la montagne et en allant au-devant d’une avalanche qui sera leur lit nuptial et, aussi, leur linceul :
« RUBEK (la saisissant violemment dans ses bras). Eh bien, veux-tu qu’en une seule fois nous vivions la vie jusqu’au fond… avant de regagner nos tombes ?…
IRÈNE. Dans la splendeur lumineuse des sommets, sur la cime de l’oubli!
RUBEK. Irène, mon adorée… oui, c’est là que nous célébrerons notre fête nuptiale ( … ).
IRÈNE (comme transfigurée). Je suivrai volontiers, sans réserve, mon màltre et seigneur.
RUBEK (l’entraînant). D’abord, Irène, nous fendrons les brouillards et puis…
IRÈNE. Oui, à travers les brouillards vers les sommets, où resplendit le soleil levant.
Les nuées descendent et s’épaississent. Rubek et Irène, la main dans la main, montent, traversant le névé et disparaissent bientôt dans le brouillard qui tombe.
La scène d’amour au seuil de la mort peut se présenter, dans les autres drames, sur un mode plus discret ou dégradé, elle n’en constitue pas moins, dans son ambivalence de mort-résurrection, la seule issue possible au tragique ibsénien : Solness grimpant en haut de la tour, en communion télépathique avec Hilde, puis s’écrasant aux pieds de la jeune fille; Mme Alving sur le point d’offrir à Oswald, d’un même geste, la mort et le soleil orgastique qu’il réclame ; Allmers et Rita, les parents du Petit Eyolf, regardant ensemble, statufiés, « vers les sommets, vers les étoiles. Et vers le grand silence » ; Ella et Gunhild, les jumelles rivales, penchées sur la dépouille mortelle de Borkman telles « deux ombres au-dessus du mort » ; ou encore, dans un esprit plus ironique, Helmer se mettant à espérer, aussitôt que Nora a quitté la « maison de poupée », « le plus grand des prodiges » et Hedda-Lovborg se donnant tous deux la mort – l’une volontairement, l’autre dans une sorte d’acte manqué – tandis que Tesman et Mme Elvsted s’efforcent de reconstituer le manuscrit br-ûlé, cette relique.
Dans sa dimension sacrificielle, le suicide du couple, à quoi se résume la scène d’amour au seuil de la mort, ressortit plus à une élévation qu’à une chute. Assomption des amants ou des époux par la force de l’amour retrouvé. Perte qui est aussi un gain, comme l’affirme Allmers à Rita, dans Le Petit Eyo~f :
« ALLMERS. …Une résurrection, le passage à une vie plus haute.
RITA (avec un regard de désespérance). Oui, mais au prix du bonheur, de tout le bonheur de la vie.
ALLMERS. C’est un gain, Rita, que cette perte. »
Ainsi l’apaisement final – qui n’est pas celui d’un conflit intersubjectif mais celui des tensions internes aux personnages – réalise une double fusion rédemptrice. Fusion de deux êtres (Rebekka et Rosmer, l’un à l’autre : « Maintenant nous sommes un »). Fusion de l’intime – valeur interdite dans la « grande maison » – avec le cosmos.
De Rosmersbolm à Quand nous nous réveillerons, Ibsen épure sa dramaturgie. Il l’allège de toute intrigue secondaire, réduit le nombre des personnages et les entrées-sorties qui donnaient à des pièces comme Maison de poupée, Le Canard sauvage ou Hedda Gabler des allures de drame bourgeois. Coïncident enfin la pièce et l’épilogue, cette scène d’amour au seuil de la mort. Et c’est à juste titre que le vieil écrivain peut appeler Quand nous nous réveillerons…. la plus dépouillée de ses œuvres (un « échange » au sens claudélien : Rubek, l’artiste mélancolique, retrouve Irène, femme dont la vie s’est jadis arrêtée ; Maïa, son épouse, affamée des bonheurs terrestres, part avec le Chasseur d’ours, force de la nature et viveur impénitent), son épilogue dramatique. Ibsen, qui proclamait qu »‘écrire, c’est appeler sur soi le jugement dernier », livre in extremis son lever de rideau pour le jour de la Résurrection. A ce degré de jubilation et d’élévation artistique, il ne lui reste plus, à l’instar de Rubek, qu’à attendre que la mort fonde sur lui, Ce qui se produit presque immédiatement, par l’entremise d’une attaque d’apoplexie qui, tout en lui accordant six années de survie, le statufie physiquement et littérairement. Quand nous nous réveillerons… se substitue ainsi, à titre de testament littéraire, aux Mémoires que l’écrivain norvégien annonçait dans le discours de son jubilé : « un gros volume que j’ai l’intention d’écrire, un livre qui unira ma vie et ma production et en montrera l’unité ». Mais la personnalité et l’art ibséniens n’étaient-ils pas fondamentalement étrangers à ce projet d’une synthèse de la vie et de la production littéraire, à cette pratique de la « confession » ou, pour prendre un terme plus moderne, de l »‘autobiographie » qui fondera I’œuvre d’un Strindberg ?
Au vrai, l’opposition entre Ibsen et son cadet Strindberg – et, depuis, l’affrontement des ibséniens et des strindbergiens – résume l’alternative du drame au tournant du siècle dernier. Des deux dramaturges scandinaves, le premier se tourne vers le passé et achève, en une sorte d’apothéose funèbre – l’épilogue dramatique -, l’histoire de la tragédie bourgeoise que Diderot avait ouverte dans le plus grand optimisme; le second, au contraire, ne cesse d’interpeller l’avenir, d’essayer de faire table rase de la dramaturgie héritée des XVIII et XIX siècles et d’inventer des formes nouvelles. Tandis qu’Ibsen se veut un constructeur et sacrifie tout à ce « long et patient travail de construction dramatique, excitant et énervant », Strindberg s’affirme, dès Le Fils de la servante, comme un destructeur: « On le traitait volontiers, relate-t-il, de génie destructeur, car il démontait tout : jouets, montres, tout ce qui lui tombait sous la main. » Contemporains de Freud, les deux génies dramatiques accordent le rôle prépondérant aux pulsions inconscientes. Ils pressentent l’un comme l’autre que, désormais, dans le déroulement d’un drame, l’intrasubjectivité pèsera plus lourd que l’intersubjectivité. Bref, ils installent le drame dans l’intime de l’être. Mais, à partir de là, leurs chemins se séparent. Et le meilleur témoignage de cette divergence se trouve dans la lecture tendancieuse que, dans ses Vivisections, Strindberg donne de Rosmersbolm : il ne s’intéresse qu’au « meurtre psychique » que Rebecca West aurait perpétré, bien avant le lever de rideau, sur l’épouse de Rosmer ; il croit déceler une lutte mentale, un « combat des cerveaux » là où règne la foncière passivité du personnage ibsénien.
Strindberg inventera une dramaturgie de part en part subjective, un théâtre autobiographique où il impose constamment sa propre présence au milieu de ses personnages et où ces personnages ne sont que des projections et des dédoublements de lui-même. Ibsen, à l’opposé, aura été le dernier grand dramaturge à observer cette loi selon laquelle l’auteur doit complètement s’effacer devant ses personnages et rester invisible et silencieux tout au long de la pièce. Même lorsqu’il serre au plus près, à travers le personnage de Rubek, ses angoisses et sa mélancolie personnelles de grand artiste au seuil de la mort, Ibsen, homme d’un autre temps et d’une autre tradition, refuse de céder à ce théâtre à la première personne que prépare en son athanor l’alchimiste Strindberg.
NOTES
1. Peter Szondi, Théorie du drame moderne, traduit de l’allemand par Patrice Pavis, avec la collaboration de jean et Mayotte Bollack, L’Age d’homme, coll. « Théâtre-Recherche », 1983.
2. Maurice Maeterlinck, « Le Tragique quotidien », in Le Trésor des humbles, Editions Labor, Bruxelles, 1986.
3. Bernard Dort, « A la croisée des chemins », in Rosmenbolm, texte français de Terje Sinding et Bernard Dort, Editions du Théâtre national de Strasbourg, 1987. C’est ce texte de Rosmersbolm que je cite dans le présent chapitre.
4. Sigmund Freud, « Une difficulté de la psychanalyse », in Essais de psychanalyse appliquée, Idées/Gallimard, n° 353.
5. Henrik Ibsen, Un poème, cité par Terje Sinding dans son article « Strindberg, Ibsen – tours et détours de la subjectivité » in Théâtrelpublic, n° 73, consacré à Strindberg, janvier-février 1987.

James Joyce
Théâtre Populaire N°9 / Septembre-Octobre 1954
Le nouveau drame d'Ibsen
[Théâtre Populaire, n°9, 1945. Traduit de l’anglais par Anne Garnier.]
Dans leur jeunesse, les grands hommes ont parfois des admirations exclusives : Joyce isolé en Irlande catholique se défendit mal contre le mythe qui faisait d’Ibsen le grand dramaturge révolutionnaire de l’émancipation universelle. Il alla même jusqu’à étudier le norvégien pour mieux goûter, dans leur plein texte, les œuvres de son idole. Au moment où l’Irlande s’éveillait à l’art dramatique, nul ne se fit mieux que lui, à Dublin, le propagateur des idées ibséniennes – au point d’encourir la surveillance ecclésiastique et le discrédit de l’Université.
C’est à dix-sept ans, dans toute l’ardeur de cette lutte, qu’il rédigea l’essai que l’on va lire, le premier écrit qu’il ait publié. Ce texte nous intéresse donc à double titre ; d’abord pour sa valeur documentaire. Aujourd’hui, en effet, le crédit dont put jouir Ibsen comme prophète de la révolte paraît affaibli, dans une époque qui lui préfère son rival Strindberg. Mais la passion qu’aux alentours de 1900, toute une génération éprouva pour Le Canard Sauvage ou Rosmersholm, il n’est pas inutile de rappeler qu’elle prépara la création d’Ulysse et de Dedalus. Ensuite, n’est-ce pas une sorte de psychanalyse de son adolescence que nous livre ici Joyce, étouffant dans le puritanisme irlandais et regardant vers le monde de la scène, comme vers celui de la liberté ?
Voici vingt ans qu’Henrik Ibsen écrivit Maison de Poupée, œuvre qui devait faire date dans l’histoire du drame. Sa renommée dès lors gagna deux continents, provoquant plus de débats et de critiques que celle d’aucun de ses contemporains. Certains ont salué en lui un réformateur religieux, un révolutionnaire social, un défenseur passionné de la justice, un grand dramaturge. D’autres l’ont dénoncé comme un impertinent touche-à-tout, un artiste raté, un incompréhensible mystique, voire, pour reprendre l’expression savoureuse d’un critique anglais, comme « un chien furetant dans la crotte ». Mais, malgré les contradictions de la critique, le génie d’Ibsen s’affirme chaque jour davantage, tel un héros triomphant de ses épreuves, et tandis que les fausses notes se font plus rares, le chœur des louanges ne cesse de s’accroître. Le spectateur le plus indifférent trouvera significatif que l’intérêt suscité par ce Norvégien n’ait point faibli depuis un quart de siècle. On peut se demander quel autre homme a su exercer une semblable emprise sur la pensée moderne. Ni Rousseau, ni Emerson, ni Carlyle, ni aucun de ces géants dont l’œuvre passe de si loin la condition humaine. L’influence d’Ibsen sur deux générations s’explique en partie par la réserve de l’homme. Jamais, ou peu s’en faut, il n’a daigné descendre dans l’arène. Sa sérénité merveilleuse ne fut guère troublée, semble-t-il, par les discussions orageuses qui éclataient autour de lui. L’opposition n’a pas eu la moindre répercussion sur son œuvre. Sa production s’est accomplie dans l’ordre le plus sûr, et selon une routine d’horloger, telle qu’on en trouve peu chez les grands génies. Une fois seulement, il a répondu à l’attaque violente de ses ennemis, à propos des Revenants. Mais, depuis Le Canard sauvage jusqu’à Jean-Gabriel Borkman, ses drames ont paru avec une régularité quasi-mécanique, tous les deux ans. On a tendance à sous-estimer l’effort constant que requiert un tel plan de travail., Plus admirable encore est l’avance lente, irrésistible de cet homme extraordinaire. Onze pièces ont été publiées, qui traitent toutes de sujets modernes. En voici la liste : Maison de Poupée, Les Revenants, Un Ennemi du peup1e, Le Canard sauvage, Rosmersholm, La Dame de la mer, Hedda Gabler, Solness le Constructeur, Le Petit Eyolf, John-Gabriel Borkman et, pour finir, son nouveau drame, paru à Copenhague le 19 décembre 1899: Quand nous nous réveillerons d’entre les morts. On est déjà en train de traduire cette pièce en une douzaine de langues ; voilà qui en dit long sur la renommée. de l’auteur. Il s’agit ici de trois actes en prose.

Edvard Münch. Quand nous nous réveillerons d’entre les morts. 1909
Entreprendre le compte rendu d’une pièce d’Ibsen n’est assurément pas chose facile. Le sujet en est très limité et très vaste tout ensemble. On peut, sans risque d’erreur, prédire que les trois-quarts des résumés qu’on en fera débuteront comme suit: « Arnold Rubek et sa femme, Maïa, sont mariés depuis quatre ans quand la pièce commence. Leur union, toutefois, n’est pas heureuse. Chacun est mécontent de l’autre ». Compte rendu irréprochable, certes, mais qui ne va pas bien loin et ne donne pas la moindre idée des relations du Professeur et de sa femme. Ce n’est qu’une version plate, scolaire, de nuances sans nombre et indéfinissables. Comme si l’histoire d’une vie tragique pouvait s’inscrire aussi grossièrement en deux colonnes : pour et contre[1] (1). On n’exagérera nullement en affirmant que les trois actes disent ce qui est essentiel au drame; c’est à peine s’il y a un seul mot superflu dans la pièce entière. L’œuvre même exprime donc sa propre philosophie avec toute la concision que permet la forme dramatique. On conçoit dès lors facilement qu’un résumé ne saurait donner une notion exacte du drame. Il n’en va pas de même pour la plupart des pièces auxquelles la critique peut rendre justice en quelques lignes. Plats réchauffés, le plus souvent, compositions sans originalité, d’où toute finesse psychologique est sereinement absente et où l’auteur parle strictement pour la galerie, œuvres d’histrions, pour tout dire, et qui ne méritent rien d’autre qu’un accueil froid et désinvolte. Mais quand il s’attaque à un homme comme Ibsen, le critique sent son courage sombrer devant l’immensité de la tâche. Tout ce qu’il peut espérer faire, c’est établir un lien entre quelques-uns des éléments essentiels, de façon à suggérer plutôt qu’à indiquer la complexité de l’intrigue. Bien avant cette pièce, Ibsen a acquis une maîtrise telle de son art, qu’au moyen d’un dialogue apparemment très simple, il présente ses héros au cœur de différentes crises morales. Il a ainsi recours sans réserve à une méthode analytique qui lui permet de faire tenir la vie de tous ses personnages en l’espace assez bref de deux jours. Prenons-en pour exemple Solness, que nous croyons voir agir pendant une nuit et jusqu’au lendemain soir , en fait nous avons été des témoins passionnés de sa vie tout entière -jusqu’au moment où Hilda Wangel entre dans sa maison[2]. Il en va de même avec l’œuvre que nous étudions aujourd’hui ; lorsque nous voyons le Professeur Rubek pour la première fois, il est assis dans un jardin, son journal à la main; mais voici que le livre de sa vie passée s’ouvre devant nous, et nous avons la joie, non pas d’en entendre le récit, mais de le lire nous-mêmes, d’en joindre les divers épisodes et de nous approcher pour y voir de plus près, quand le sens vient à manquer.
Ainsi donc, au lever du rideau, notre héros est assis dans les jardins d’un hôtel à l’heure du petit déjeuner. Près de lui se trouve Maïa, sa femme. La scène se passe en Norvège, dans une station thermale réputée, au bord de la mer. À travers les arbres, on aperçoit le port, le fjord et les vapeurs qui y louvoient. Au loin, des îlots et des langues de terre. Rubek est un sculpteur célèbre, d’âge moyen, et Maïa une femme encore jeune, aux yeux vifs mais ombrés d’une légère tristesse. Ils lisent tranquillement, dans la quiétude du matin. Tout semblerait idyllique à l’œil inattentif. La femme rompt soudain le silence, avec éclat en se plaignant de la paix profonde qui règne autour d’eux. Arnold pose son journal et proteste doucement. Ils se mettent alors à causer, du silence, du lieu, des gens, des gares qu’ils ont traversées la nuit précédente, avec leurs porteurs ensommeillés et1es lanternes qui se balançaient sans but. Ils bavardent ensuite sur les changements survenus chez les gens et tout ce qui s’est transformé depuis leur mariage. Les voici tout près du sujet brûlant. Tandis qu’ils parlent de leur vie conjugale, on découvre vite que leurs relations sont loin d’être aussi harmonieuses qu’on pensait. Leur âme apparaît lentement dans ses replis les plus profonds, et l’on discerne déjà dans cette scène fin-de-siècle le drame qui se prépare. La dame semble une petite personne pointilleuse. Elle se plaint des promesses vaines dont son mari a nourri ses aspirations.
MAÏA. – Tu m’as dit que tu m’emmènerais sur une haute montagne, pour me montrer toutes les splendeurs de la terre.
RUBEK, troublé. – Vrai, je te l’ai promis aussi ?[3].
Bref, il y a quelque chose de faux à la base de leur union. Cependant les clients de l’hôtel, qui prennent des bains, sortent à droite, babillant et riant. L’inspecteur des bains les conduit sans cérémonie. C’est le type même~ du fonctionnaire conventionnel. Il salue M. et M- Rubek, leur demande comment ils ont dormi. À son tour, Rubek lui demande si certains hôtes prennent des bains la nuit, car il a vu une silhouette blanche glisser dans le parc très tard. Maïa se rit de la question, mais l’inspecteur répond qu’une étrangère a loué le pavillon de gauche, et y demeure avec une dame de compagnie, une diaconesse. Tandis qu’ils devisent, l’étrangère et sa compagne traversent lentement le parc et entrent dans le pavillon. L’incident semble impressionner Rubek, et la curiosité de sa femme est piquée.
MAÏA, un peu troublée et désagréablement frappée. – Cette dame t’a peut-être servi de modèle, un jour, Rubek ? Tâche de te souvenir…
RUBEK, fixant sur elle un regard aigu. – De modèle ?
MAÏA, avec un sourire taquin. – Oui, dans ta jeunesse… Tu as eu, sans doute, d’innombrables modèles… dans le temps, bien entendu.
RUBEK, du même ton. – Mais.non, ma petite Madame Maïa, je n’ai jamais eu qu’un modèle, un seul… pour toutes mes créations.
Comme cette discussion se poursuit, l’inspecteur prend subitement peur en voyant quelqu’un approcher et il essaye de s’enfuir dans l’hôtel, mais une voix stridente l’arrête.
Voix D’ULFHEIM, à l’extérieur. – Mais attendez donc, nom d’un chien ! Vous détalez toujours devant moi.
Entre alors en scène le héros numéro deux. Il est décrit comme un homme long, maigre, musculeux, d’âge indécis, grand tueur d’ours. Son valet Lars l’accompagne, menant deux chiens couplés. Lars n’ouvrira jamais la bouche. Ulfheim le renvoie d’un coup de pied et s’approche de M. et Mme Rubek. Il entame une conversation avec eux, car il connaît déjà le célèbre artiste. Sur la sculpture ce chasseur farouche tient des propos piquants.
ULFHEIM. – Nous travaillons dans le dur, Madame, votre mari et moi. Il peine sur le marbre, et moi sur des muscles d’ours tendus et palpitants. Et tous les deux nous finirons par asservir la matière et nous en rendre maîtres. Nous n’avons de trêve que nous ne soyons venus à bout de sa résistance.
RUBEK, pensif. – Voilà des paroles de vérité.
Cet être excentrique, peut-être en raison même de son excentricité, est en train d’ensorceler Maïa. Chaque mot qu’il prononce, accroît le charme fascinant qu’il exerce déjà sur elle. La robe noire de la diaconesse le fait ricaner. Il parle froidement de tous ses amis proches, qu’il a envoyés dans l’autre monde.
MAïA. – Et qu’avez-vous fait pour vos proches ?
ULFHEIM. – Je leur ai lâché à chacun un coup de fusil, bien sûr !
RUBEK, le regardant. – Un coup de fusil ?
MAïA, écartant sa chaise. – Vous les avez tués ?
ULFHEIM, inclinant la tête. – Je ne rate jamais, Madame.
Mais on découvre vite que par ses proches Ulfheim entend ses chiens, et ses interlocuteurs en éprouvent quelque soulagement. Cependant la diaconesse a préparé un léger repas pour sa maîtresse à l’une des tables dressées près du pavillon. La frugalité du menu met Ulfhheim en joie, et il dénigre vertement ce régime efféminé. Il lui faut, à table, des mets plus substantiels.
ULFHEIM, se levant. – Vous êtes une maîtresse femme, vous. Venez avec moi. Vous les (ses chiens) verrez avaler de gros os saignants, les vomir et les ravaler ensuite. C’est un festin rien que de les voir !
Maïa répond à cette invitation mi – horrible, mi-comique, et laisse son mari en compagnie de l’étrangère qui sort à ce moment du pavillon. Ils se reconnaissent au même instant, La dame a servi de modèle à Rubek pour la figure centrale de son fameux chef-d’œuvre « Le jour de la Résurrection ». Au terme de ce travail, elle s’était enfuie mystérieusement, sans laisser aucune trace derrière elle. Ils conversent familièrement. A une question qu’elle lui pose, il répond, non sans hésitation, que la personne qui vient de sortir est sa femme, et lui demande à son tour si elle est mariée. Elle répond affirmativement.
RUBEK. – Où est-il maintenant ?
IRÈNE. – Quelque part dans un cimetière… sous un superbe monument… avec une balle de plomb dans le crâne.
RUBEK. – S’est-il tué de sa propre main ?
IRÈNE. – Oui, il a tenu à me devancer.
RUBEK. – Le regrettes-tu, Irène ?
IRÈNE, sans comprendre. – Qui regretterais-je ?
RUBEK. – Mais… M. de Satow!
IRÈNE. – Il ne s’appelait pas M. de Satow.
RUBEK. – Comment cela?
IRÈNE. – C’est le nom de mon second mari, un Russe.
RUBEK. – Et où est-il, celui-ci ?
IRÈNE. – Très loin, dans l’Oural… au milieu de ses mines d’or.
RUBEK. – Il y passe sa vie ?
IRÈNE, haussant les épaules. – Sa vie ? sa vie ?… À vrai dire, je l’ai tué aussi.
RUBEK, sursautant. – Tué !
IRÈNE. – Avec un poignard effilé que j’ai toujours dans mon lit.
Rubek commence à comprendre qu’il y a un sens caché derrière ces étranges paroles. Il se met à songer à lui, à son art, à cette femme, et envisage son existence passée depuis la création du « Jour de la Résurrection ». Il sent qu’il n’a pas tenu la promesse de cette œuvre, et entrevoit la grave carence de son existence. Il s’enquiert auprès d’Irène de sa vie après leur rupture, et la réponse qu’elle lui donne est d’une importance capitale, car c’est l’idée dominante de tout le drame.
IRÈNE, se levant lentement de sa chaise, dit d’une voix tremblante. – J’étais morte depuis des années. Ils étaient venus me garrotter. Ils m’avaient lié les mains derrière le dos. Ils m’avaient descendue dans un sépulcre et l’avaient fermé avec des barreaux de fer, après en avoir matelassé les parois, en sorte que personne ne pouvait entendre les lamentations venant du sépulcre…
Dans cette allusion à la situation du modèle, Ibsen donne encore une preuve de sa connaissance intime du cœur humain. Nul autre n’aurait su aussi subtilement exprimer la nature des relations entre le sculpteur et son modèle.
IRÈNE. – je me suis exposée à tes yeux, tout entière, sans réserve… (Plus bas.) Et pas une fois tu ne m’as touchée…
RUBEK, la regardant avec insistance. – J’étais artiste, Irène.
IRÈNE, d’une voix sombre. – justement!… justement !
Tandis qu’il réfléchit profondément sur lui-même et sur son attitude passée envers cette femme, Rubek est frappé de l’abîme qui sépare son art de sa vie et réalise que même en art son génie est loin d’être irréprochable. Depuis le départ d’Irène, il n’a fait que sculpter des bustes de tiers et de quarts. Bref, une énergie nouvelle s’empare de lui et il décide de mettre un terme à tout ce gaspillage, car, selon lui, rien n’est encore perdu. Les lignes qui suivent font songer à la glorification de la volonté dans Brand.
RUBEK, hésitant, en proie à une lutte intérieure. – Si nous pouvions! oh ! si nous pouvions!…
IRÈNE. – Pourquoi ne pourrions-nous pas ce que nous voulons ?
Ils sont d’accord l’un et l’autre pour juger, insupportable leur condition actuelle. Irène estime que Rubek lui doit beaucoup, il n’en disconvient pas, et l’acte se termine avec l’entrée en scène de Maïa, toujours sous le charme d’Ulfheim.
RUBEK. – Quand as-tu commencé à me chercher, Irène ?
IRÈNE, avec un accent d’amère raillerie. – Depuis que je me suis aperçue du don que je t’avais fait… je t’avais donné, Arnold, ce dont on ne se passe pas, ce qui aurait dû rester inséparable de moi-même.
RUBEK, hochant la tête. – Oui, c’est cruellement vrai! Tu m’as donné trois ou quatre de tes jeunes années.
IRÈNE. – Je t’ai donné bien plus que cela, prodigue que j’étais en ce temps. –
RUBEK. – Oui, Irène, tu étais une prodigue. Tu m’as donné toute ton adorable nudité…
IRÈNE. – A contempler…
RUBEK. – Et à glorifier…
IRÈNE. – Mais tu oublies le don le plus précieux.
RUBEK. – Le plus précieux ?… Qu’était-ce donc ?
IRÈNE. – Je t’ai donné mon âme jeune et vivante. Et je suis restée avec un grand vide en moi, sans âme. (Le regardant fixement.) C’est là ce qui m’a fait mourir, Arnold.

Edvard Münch. Quand nous nous réveillerons d’entre les morts, 1909
On voit clairement, même à travers ce résumé incomplet, la perfection du premier acte. Le drame prend corps imperceptiblement et se précise sans effort apparent. La pelouse coquette de cet hôtel du dix-neuvième devient lentement le lieu d’un conflit tragique qui se développe de scène en scène. Chacun des personnages suscite notre intérêt, et nous attendons curieusement l’acte suivant. La situation n’est pas stupidement exposée, l’action prend place et, quand le rideau tombe, la pièce a vraiment progressé.
Le second acte se passe dans la montagne, près d’un sanatorium. D’un rocher jaillit une cascade, à droite. Sur le bord du torrent des enfants jouent en riant. Le crépuscule tombe. À gauche est assis Rubek, sur un monticule. Maïa entre bientôt, vêtue en alpiniste. Elle franchit le torrent en s’aidant de son bâton et appelle Rubek. Il lui demande si elle s’amuse bien avec son compagnon, et s’intéresse à leur chasse. Une conversation délicieusement spirituelle s’ensuit. À la question de Rubek, qui s’enquiert de l’endroit où ils ont l’intention de chasser l’ours, Maïa répond d’un air de supériorité : « On ne rencontre pas d’ours sur un plateau nu, que je sache ». C’est ensuite le brutal Ulfheim qui fait l’objet de leurs propos. Maïa l’admire à cause de sa laideur. Elle se tourne soudain vers son mari et lui dit qu’il est laid lui aussi. Il invoque son âge. « On vieillit, Madame Maïa, on vieillit ». Ces plaisanteries aigres-douces les conduisent vers des problèmes plus graves. Maïa est allongée sur la bruyère molle et. se moque doucement du Professeur. Pour les mystères et les revendications de l’art, elle a un dédain moqueur.
MAÏA, avec un rire un peu méprisant. – Ah, tu es et tu resteras toujours artiste, toi !
Et :
… Tu n’aimes pas la société, Rubek. Tu préfères vivre seul avec tes pensées. Moi, de mon côté, je ne puis m’entretenir avec toi, comme il le faudrait, de ce qui t’intéresse, de l’art, et cætera. (Avec un geste d’insouciance.) Et je ne m’en soucie pas beaucoup, à dire vrai.
Elle le raille à propos de l’étrangère et fait une perfide allusion à leur complicité. Rubek affirme qu’elle n’était pour lui que la source de son inspiration, en tant qu’artiste. Il avoue que les cinq années de sa vie conjugale ont été pour lui une période de famine intellectuelle. Il connaît ce qu’il ressent pour son art.
RUBEK, souriant. – Mais il ne s’agit pas de cela.
MAïA. – De quoi donc s’agit-il ?
RUBEK, de nouveau grave. – De ce que tout, vocation, travail d’artiste, et tout ce qui s’ensuit… oui, tout cela m 1 apparaissait soudain comme choses creuses, vides, insignifiantes au fond.
MAïA. – Et que voulais-tu mettre à la place ?
RUBEK. – La vie, Maïa.
Le problème essentiel de leur bonheur est abordé et, au terme d’une vive discussion, ils tombent d’accord tacitement pour se séparer. Les choses en sont là, lorsqu’Irène apparaît au bout de la lande. Elle est entourée d’enfants 1 rieurs et demeure un instant parmi eux. Maïa se relève d’un bond et va lui dire, d’un ton énigmatique, que son mari a besoin d’aide pour «ouvrir un coffret précieux ». Irène s’incline et s’approche de Rubek, tandis que Maïa s’en va gaiement à la recherche de son chasseur. L’entrevue qui va suivre est remarquable, même d’un point de vue scénique. Cœur de l’acte deux, elle est passionnante et appelle tout le talent des acteurs qui voudraient la jouer. Seule une interprétation parfaite des deux rôles peut donner une idée des subtilités de ce dialogue. Quand on songe au petit nombre d’artistes assez intelligents pour s’attaquer à cette scène et assez brillants pour l’enlever avec succès, on se sent pris de peur.
Dans l’entretien de ces deux êtres sur la lande, c’est la substance même de leur vie qu’exprime la main hardie et ferme de leur créateur. Depuis les premières paroles qu’ils échangent, chaque phrase est un monde d’expériences. Irène fait allusion à l’ombre noire de la diaconesse qui la suit partout, comme suit Arnold l’ombre de sa conscience inquiète. En faisant presque malgré lui cette confession, Rubek détruit une des barrières qui les séparaient ; une partie de la vieille confiance qu’ils avaient l’un en l’autre ressuscite, et ils retrouvent leur franchise d’antan. Irène peut alors ouvertement parler des sentiments à qu’elle a éprouvés et de sa haine contre le sculpteur.
IRÈNE, avec un retour de violence. – Oui, contre toi, contre l’artiste qui, de ses mains légères et insouciantes, a pris un corps palpitant de jeunesse et de vie, et l’a dépouillé de son âme afin de s’en mieux servir pour créer son œuvre d’art.
La faute de Rubek fut grande en vérité. Non seulement il s’est emparé de l’âme de la jeune fille, mais encore il a dépossédé de son trône légitime son enfant. Par son enfant, Irène entend la statue. Il lui semble, en effet, qu’elle a, au sens strict du mot, donné naissance à cette statue. Au fur et à mesure qu’elle voyait grandir la sculpture, sous la main habile de l’artiste, un secret instinct maternel s’est développé en elle, d’amour et de possession.
IRÈNE, changeant de ton, d’une voix chaude et émue. – Mais cette figure qui se modelait dans l’argile molle et vivante, cette figure, je l’aimais de plus en plus, à mesure que la matière brute, que la masse informe se transformait en un enfant dont l’âme parlait à la mienne, qui était notre création, notre enfant, à toi et à moi.
De fait, c’est à cause de ces sentiments passionnés qu’elle s’est tenue à l’écart pendant cinq ans. Quand elle apprend ce qu’il a fait de l’enfant – de son enfant – alors toute sa rancune éclate, plus violente que jamais. Rubek essaye désespérément de tout lui expliquer, mais elle écoute avec la férocité d’une mère à laquelle on aurait arraché son petit.
RUBEK. – J’étais jeune, ignorant de la vie. je pensais qu’on ne pouvait donner à la Résurrection une apparence plus belle, plus radieuse que celle d’une jeune fille intacte, n’ayant rien éprouvé de la vie terrestre, et s’éveillant à la lumière, à la joie triomphale, sans avoir à se séparer de quelque laideur, de quelque impureté que ce soit.
Une expérience plus grande de la vie l’a conduit à modifier son idéal, et c’est alors qu »il a fait de son enfant à elle, non plus la figure centrale de I’œuvre, mais un motif intermédiaire. Rubek se tourne vers la jeune femme, au moment où elle allait le poignarder. Pris d’épouvante et de remords, il cherche à se défendre, et plaide désespérément pour ses erreurs passées. Aux yeux d’Irène pourtant, il essaye de parer son crime de poésie, et s’il se montre repentant, c’est avec une volupté douloureuse. L’idée qu’elle a pu se donner tout entière à un art mensonger lui ronge atrocement le cœur. Sans éclats, elle fait son mea culpa, avec une tristesse profonde.
IRÈNE, se maîtrisant en apparence. – J’aurais dû mettre des enfants au monde… beaucoup d’enfants… de vrais enfants, et non de ceux que l’on conserve dans des sépulcres. C’était là ma vocation. jamais je n’aurais dû te servir, poète !
Perdu dans ses rêveries, Rubek ne souffle mot ; il songe aux beaux jours d’autrefois. Le souvenir des joies qu’ils ont connues ensemble adoucit sa peine. Mais Irène, rappelle une phrase qui avait échappé à l’artiste par mégarde. En lui disant gratitude pour l’aide qu’elle lui avait apportée, il avait ajouté que ce serait un épisode béni de sa vie. Déjà tant accablée, l’âme torturée de Rubek n’en peut plus. Il se met à lancer des fleurs dans le torrent, comme jadis près du lac de Taunitz, et évoque l’époque où ils jouaient à faire un petit-bateau de feuilles et à l’attacher derrière un nénuphar, cygne de Lohengrin. Dans leurs jeux mêmes, il faut trouver le sens caché.
IRÈNE. – Tu disais que j’étais le cygne qui guidait ton bateau.
RUBEK. – Ai-je dis cela ? C’est possible. (Absorbé par le jeu.) Vois-tu, vois-tu comme les mouettes descendent le courant!
IRÈNE, riant. – Et tous tes bateaux chavirent.
RUBEK, jetant de nouvelles feuilles dans le torrent. J’ai des bateaux de réserve.
Cependant qu’ils jouent sans but, dans une sorte de désespoir d’enfant, Ulfheim et Maïa arrivent sur la lande. Ils vont chercher l’aventure sur les hauts-plateaux. Maïa chante à son mari un petit air qu’elle a inventé dans sa joie insouciante. Ulfheim. lance à Rubek un bonsoir ricanant et disparaît dans la montagne avec sa compagne. La même idée traverse l’esprit du sculpteur et de son amie. Mais à ce moment précis surgit dans le crépuscule la silhouette lugubre de la diaconesse, et son regard lourd s’arrête sur eux deux. Irène prend congé et promet de rencontrer Rubek cette nuit-là sur la lande.
RUBEK. – Tu viendras, Irène ?
IRÈNE. – Je viendrai sans faute. Attends-moi ici.
RUBEK, répète comme en rêve. – Une nuit sur la lande… avec toi… avec toi… (Leurs regards se rencontrent.) Oh ! Irène, c’eût été la vie… et nous l’avons manquée, tous deux.
IRÈNE. – L’irréparable ne nous apparaîtra que… (S’interrompant soudain.)
RUBEK, avec un regard interrogateur. – Que ?…
IRÈNE. – Quand, nous nous réveillerons d’entre les morts.
Le troisième acte se passe sur un vaste plateau, dans la haute montagne. Le sol est déchiré par des crevasses béantes. A droite, les cîmes se perdent dans des nuées errantes. À gauche, une vieille hutte délabrée. À l’heure où le ciel prend des couleurs de perle. On voit le jour poindre. Maïa et Ulfheim. descendent vers le plateau. Le dialogue qui s’engage est assez explicite.
MAïA, essayant de se dégager. – Lâchez-moi ! Lâchez-moi, vous dis-je !
ULFHEIM. – Allons, allons, il ne vous manque plus que de mordre… Vous êtes méchante comme une guêpe.
Comme Ulfheim continue ses agaceries, Maïa menace de le planter là. Il rétorque que sans lui elle se rompra le cou. Afin de n’être pas interrompu, il a sagement envoyé Lars chercher les chiens et ajoute qu’on peut lui faire confiance : les bêtes ne seront pas retrouvées de sitôt.
MAïA, avec un regard courroucé. – Je le sais bien.
ULFHEIM, lui saisissant le bras. Lars, voyez-vous, connaît mes habitudes de sport.
Avec un grand sang-froid, Maïa lui dit alors crûment ce qu’elle pense de lui. Et ses remarques peu flatteuses ont le don de mettre en joie le chasseur d’ours, tandis qu’elle doit faire appel à toute sa présence d’esprit pour le tenir à distance. Lorsqu’elle parle de s’en retourner seule à l’hôtel, il propose fort galamment de la porter sur ses épaules, mais on lui rit au nez. C’est le chat guettant la souris. Au milieu de cette escarmouche, un propos échappe à Ulfheim, qui mérite l’attention, car il éclaire sa vie passée.
ULFHEIM, avec une sourde colère. – Il m’arriva un jour de me charger d’une charmante enfant que j’avais enlevée à la fange des rues pour la porter dans mes bras. Je l’aurais portée ainsi à travers toute la vie, afin qu’elle ne se meure pas aux cailloux du chemin (Avec un gros rire.) Et savez-vous comment elle me récompensa?
MAÏA. – Non, dites !
ULFHEIM, la regarde en souriant et en hochant la tête. – Les cornes que vous distinguiez tout à l’heure… c’est un présent que je tiens d’elle. N’est-ce pas une plaisante histoire, madame la tueuse d’ours ?
Confidence pour confidence, Maïa lui conte brièvement sa vie, sa vie conjugale surtout. Bref, ces deux âmes indécises se sentent attirées l’une vers l’autre, et Ulfheim résume la situation avec beaucoup de pittoresque. «Voulez-vous que nous mettions ensemble nos pauvres haillons ? » Maïa, contente que dans cet engagement il ne soit point question de lui montrer toutes les splendeurs de la terre ni d’emplir d’art sa maison, donne son accord tacite en l’autorisant à la porter jusque dans la vallée. Mais voici que Rubek et Irène arrivent au-devant d’eux. Ils ont aussi passé la nuit sur le plateau et, lorsqu’Ulfheim demande à Rubek s’il est monté par le même chemin que cette dame, le sculpteur répond . « Bien entendu. (Avec un regard vers Maïa.) Madame et moi, nous suivons désormais la même route ».
Cependant qu’ils font assaut d’esprit, les éléments entrent en jeu, comme s’ils comprenaient qu’il y avait là un problème gigantesque à résoudre et qu’un drame poignant avançait vers son dénouement. Les frêles silhouettes de Maïa et d’Ulfheim s’amenuisent encore au seuil de la tempête. Leurs destins se décident dans une paix relative, et ils cessent de nous intéresser vraiment. L’autre couple, au contraire, absorbe toute notre attention, figures centrales d’un intérêt humain infini. Ulfheim montre soudain les cimes du doigt.
ULFHEIM. – Mais vous ne voyez donc pas l’orage au-dessus de nos têtes ? Entendez-vous les rafales ?
RUBEK, écoutant. – On dirait le prélude de la Résurrection des morts.
MAïA, tirant Ulfheim par la manche. – Hâtons-nous de descendre.
Comme il ne peut prendre qu’une personne à,la fois, Ulfheim promet d’envoyer de l’aide et, saisissant Maïa, descend rapidement mais avec précaution. Sur le plateau dénudé, dans la lueur de. l’aube, il n’y a plus d’artiste ni de modèle, mais un homme et une femme face à face. Une grande métamorphose va s’accomplir. Irène dit à Arnold que jamais plus elle ne retournera en bas, elle ne veut pas qu’on vienne la secourir. Elle lui avoue aussi – ne peut-elle désormais tout lui dire – la tentation dévorante qu’elle a eue de le tuer.
RUBEK, d’une voix sombre. – Et pourquoi ne l’as-tu pas fait ?
IRÈNE. – Parce que je m’aperçus tout à coup, avec épouvante, que tu étais mort… depuis longtemps.
Pourtant, dira Rubek, leur amour n’est pas mort, il est encore vivace et ardent dans leur cœur.
IRÈNE. – L’amour, fruit de la vie terrestre, de la vie terrestre faite de merveilles, de beautés, de mystères – cet amour-là est bien mort en nous.
Et puis il y a tous les obstacles de leur vie passée. Ici encore, à l’endroit le plus sublime de la pièce, Ibsen maîtrise sa matière. Son génie n’élude aucun fait. À la fin de Solness le Constructeur déjà, il avait eu une trouvaille géniale ; on se rappelle l’épouvantable phrase: «Oh ! la tête est toute écrasée» Un artiste moins sûr eût baigné cette tragédie d’une lumière spirituelle. Dans son dernier drame, c’est Irène qui souligne qu’elle s’est exposée nue aux regards des hommes, que la société l’a rejetée, qu’il est trop tard. Peu importe à Rubek, qui repousse toutes ces objections.
RUBEK, la saisissant violemment dans ses bras. – Eh bien, veux-tu qu’en une seule fois nous vivions la vie jusqu’au fond… avant de regagner nos tombes
IRÈNE, poussant un cri. -Arnold!
RUBEK. – Mais pas ici dans la pénombre, dans l’horreur de ce linceul humide qui nous enveloppe 1
IRÈNE, dans un élan passionné. – Non, non… dans la splendeur lumineuse des sommets, sur la cime de l’oubli.
RUBEK. – Irène, mon adorée… oui, c’est là que nous célébrerons notre fête nuptiale!
IRÈNE, fièrement. – Le soleil peut nous contempler, Arnold.
RUBEK. – Toutes les puissances de la lumière peuvent nous contempler… et toutes celles des ténèbres aussi. (Il lui saisit la main.) Veux~tu me suivre, ma fiancée de grâce ?
IRÈNE, comme transfigurée. – Je suivrai volontiers, sans réserve, mon maître et seigneur.
RUBEK, l’entraînant. – D’abord, Irène, nous fendrons les brouillards, et puis…
IRÈNE. – Oui, à travers les brouillards, vers les sommets où resplendit le soleil levant.
Les nuées descendent et s’épaississent. Rubek et Irène, la main dans la main, montent, traversant le névé à droite, et disparaissent bientôt dans le brouillard qui tombe. Bruit strident de rafale. La diaconesse apparaît, gravissant l’éboulement à gauche. Elle s’arrête et regarde en silence autour d’elle, cherchant des yeux. Voix de Maïa montant au loin, en un chant joyeux.
MAïA. – Libre, libre, échappée de cage, je fends les airs, oiseau volage, Libre, libre, échappée de cage.
On entend soudain comme un bruit de tonnerre descendant du névé qui s’écroule, et l’on aperçoit vaguement Rubek et Irène entraînés par l’avalanche. L’abîme les engloutit.
La diaconesse, poussant un cri et tendant les bras vers eux : Irène ! Elle reste silencieuse un instant, puis fait un signe de croix sur l’abîme et dit : Que la paix soit avec vous !
On entend encore, venant d’en bas et de plus en plus lointain, le chant joyeux de Maïa.
Telle est, sous une forme grossière et décousue, l’intrigue de ce nouveau drame. L’intérêt, chez Ibsen, ne vient pas de l’action ni des événements. La peinture même des caractères, si, parfaite soit-elle, n’est pas l’élément primordial de ses pièces. Ce qui nous frappe surtout, c’est le drame nu – c’est-à-dire la perception d’une grande vérité, ou l’amorce d’une question essentielle, d’un conflit grave qui existe en dehors des acteurs qui le vivent et dont l’importance, passée comme présente, est immense. Ibsen a choisi, pour ses dernières pièces, de peindre des vies moyennes dans une vérité sans fard[4]. Il a abandonné la forme en vers, et n’a jamais cherché à embellir son œuvre selon les procédés conventionnels. Lors même que son thème dramatique atteignait son point culminant, il n’a pas essayé de le parer d’ornements criards et clinquants. Qu’il eût été facile, pourtant, d’écrire Un Ennemi du peuple sur un ton faussement sublime, en remplaçant le bourgeois par un héros plus spectaculaire ! Les critiques auraient pu alors célébrer le grandiose d’une situation dont ils ont si souvent dénoncé la banalité. Mais le milieu ne compte pas pour Ibsen. Le drame seul importe. Grâce à un génie puissant et à l’habileté consommée qui caractérise toutes ses entreprises, ce dramaturge force, depuis bien des années, l’attention du monde civilisé. Il s’en faut de beaucoup, il est vrai, qu’on lui rende déjà tous les honneurs qui lui sont dûs, mais ce n’est point faute de mérite chez cet homme éminent. Je ne me propose pas d’examiner ici toutes les questions de dramaturgie relatives à cette pièce, mais simplement d’aborder la peinture des caractères.
Jamais les personnages d’Ibsen ne se répètent. Dans ce drame – le dernier d’une longue liste – l’auteur a peint et différencié ses héros avec son adresse habituelle. Quelle création originale qu’Ulfheim ! Certes, la main qui l’a produit n’a rien perdu de son talent. Ulfheim est, selon moi, le caractère le plus nouveau de la pièce, une sorte de pochette surprise. Et c’est pourquoi, dès le début, il surgit vivant sous nos yeux. Il est magnifiquement sauvage et fascinant à la manière des primitifs. Ses yeux farouches roulent et menacent comme ceux de Yégof ou de Herne. Quant à Lars, autant ne pas en parler, car il n’ouvre jamais la bouche. La diaconesse, elle, prend la parole une seule fois, mais fort à propos. Ombre muette à la majesté symbolique, elle suit silencieusement Irène, telle l’image du châtiment.
Irène aussi est digne de figurer en si bonne compagnie. C’est surtout dans ses portraits de femmes qu’apparaît la connaissance profonde qu’Ibsen avait du cœur humain. Il semble les connaître mieux qu’elles ne se connaissent elles-mêmes, et son extrême subtilité nous confond. En vérité, il y a chez Ibsen quelque chose de la femme, si l’on peut dire cela d’un être éminemment viril. Sa précision achevée, de légères traces de féminité, la délicatesse de ses touches vives, pourraient peut-être s’expliquer ainsi. En tous cas, il connaît admirablement les femmes et semble les avoir sondées jusqu’au tréfonds de leur être. Près de ses portraits, les études psychologiques de Hardy et de Tourgueniev ou les élaborations exhaustives de Meredith font pauvre mine. Un trait habile, une phrase, un mot, et il en dit plus long qu’eux dans des chapitres entiers.
La compétition est rude, certes, mais Irène s’en sort à son avantage. Pour être uniformément vraies, les femmes d’Ibsen ne s’en présentent pas moins sous des jours différents. C’est ainsi que si Gina Ekdal est une figure comique, Hedda Gabler, elle, est tragique- si tant est qu’on puisse sans incongruité employer des termes aussi éculés. Mais Irène échappe davantage à la classification, car la passion lui demeure étrangère. Elle exerce sur nous un attrait singulier, quasi-magnétique, dû à sa force de caractère. Pour prodigieuses que soient les créations précédentes d’Ibsen, on peut se demander si un seul de ses personnages féminins avait atteint la profondeur d’Irène. Par la simple puissance de son intelligence, elle accapare notre attention. En outre, c’est un être intensément spirituel – au sens le plus vrai du mot. Son esprit plane au-dessus de celui de Rubek, et nous avons parfois le sentiment d’être dépassés. D’aucuns déploreront que l’auteur ait fait un modèle de cette femme si raffinée, et iront même jusqu’à souhaiter qu’un semblable épisode n’ait point altéré l’harmonie du drame. Je n’approuve aucunement cette opinion qui me paraît hors de propos[5]. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons qu’admirer Ibsen pour la façon dont il traite ce sujet, avec toute la pénétration, toute la mesure et toute la sympathie que nous lui connaissions déjà. Il envisage la situation dans son ensemble, calmement, lucidement, avec hauteur et hardiesse, aussi indifférent qu’un ange[6]. Ibsen diffère donc, en tous points, des pourvoyeurs habituels de la scène.
En dehors de sa valeur d’individu, Maïa assume une fonction précise dans la pièce dont elle rompt la tension. souvent excessive. Sa fraîcheur enjouée est comme un souffle d’air pur. Cet élan vers une vie ardente, sans entraves, qui est son trait dominant, contrebalance l’austérité d’Irène et le sérieux morne de Rubek. Maïa joue ici à peu de choses près le rôle d’Hilda Wangel dans Solness le Constructeur. Mais elle est loin d’attirer notre sympathie comme Nora Helmer. L’auteur a pour elle d’autres intentions.
Rubek est le protagoniste et, chose étrange, le personnage le plus conventionnel de ce drame. Certes, si on le compare à son prédécesseur napoléonien, Jean-Gabriel Borkman, il n’en est qu’un pâle reflet. N’oublions pas, pourtant, que Borkman est vivant, énergiquement, passionnément, frénétiquement vivant, du début à la fin, jusqu’à son trépas. Rubek, lui, est mort,désespérément mort, et c’est seulement au tomber du rideau qu’il revient à la vie. Il est pourtant un caractère fascinant, moins en soi que par sa signification dramatique.
Le théâtre d’Ibsen, je l’ai déjà dit, est totalement indépendant des personnages qui peuvent être mortellement ennuyeux, sans que le drame où ils évoluent perde de sa puissance. Non pas que Rubek nous ennuie! Il est infiniment plus intéressant que Torvald Helmer ou que Tesman, qui ont déjà des traits fort caractéristiques. D’autre part, l’auteur ne se propose point d’en faire un génie, comme Eljert Lovborg. L’eût-il été qu’il eût alors mieux compris le sens de sa vie. Le fait qu’il soit dévoué à son art et qu’il en ait acquis une certaine maîtrise – habileté manuelle mais pensée limitée – nous laisse cependant supposer que gisent peut-être en lui des aptitudes à une vie plus noble, qui seront exploitées lorsqu’il se réveillera d’entre les morts.
Le seul personnage que j’ai négligé est l’inspecteur des bains, et je me hâte de lui rendre justice, chichement il est vrai. Il n’est rien de plus, rien de moins qu’un inspecteur ordinaire des bains. Mais cela, il l’est bien.
Voilà pour la peinture des caractères ; elle est toujours très pénétrante. En dehors des personnages, toutefois, il y aurait quelques remarques à formuler sur certaines intentions dont la fréquence et l’ampleur nous arrêtent. La plus frappante d’entre elles pourrait, à première vue, ne paraître qu’un trait scénique accidentel. C’est du milieu où se déroule le drame que je veux Parler. On est obligé de constater, dans les dernières œuvres d’Ibsen, une tendance à s’évader des intérieurs. Cette évolution se fait sentir depuis Hedda Gabler. Le dernier acte du Constructeur et celui de Jean-Gabriel Borkman ont lieu en plein air. Ici ce sont les trois actes qui se jouent al fresco. Certains. penseront que c’est faire preuve d’un fanatisme outrancier que de s’attacher à de tels détails. Mais ce n’est que payer son tribut à l’œuvre d’un grand artiste. D’ailleurs ce trait saillant me semble des plus significatifs.
On peut aussi remarquer, dans les derniers drames sociaux d’Ibsen, une pitié touchante pour l’humanité, accent nouveau et qui détonne avec l’intransigeance inflexible de ces années 80, La façon dont Rubek modifie la figure féminine de son chef-d’œuvre «Le Jour de la Résurrection» implique toute une philosophie de sagesse et de sympathie envers les multiples contradictions de la vie, qui deviennent ainsi conciliables avec un réveil plein de promesses, lorsque le travail douloureux de notre pauvre humanité aura porté ses fruits. Quant au drame même, il est peu probable qu’on serve une cause juste en essayant de le critiquer. Bien des faits inclineraient à le prouver. Henrik Ibsen est un de ces grands hommes devant qui la critique fait piètre figure. La seule estimation qui vaille, c’est d’écouter et d’apprécier. En outre, cette espèce de critique qui s’intitule dramatique n’est qu’un accessoire parfaitement inutile de ses pièces. Lorsque l’art d’un dramaturge atteint la perfection, les commentaires sont superflus. La vie n’est point faite pour être jugée, mais pour être affrontée et vécue. Et puis, s’il existe des pièces qui réclament une scène, ce sont bien celles d’Ibsen. Et ceci non seulement parce qu’elles n’ont pas été écrites pour encombrer les rayons d’une bibliothèque, mais parce que les idées y abondent. Au hasard d’une phrase un problème surgit qui torture l’esprit et ouvre, en un éclair, d’immenses perspectives. Mais à moins de s’y attarder sciemment, cette découverte n’est que fugitive. Et c’est précisément pour interdire une méditation trop prolongée qu’Ibsen demande à être joué. Enfin, il est ridicule de croire qu’une question qui a préoccupé Ibsen pendant près de trois ans puisse nous paraître lumineuse à première lecture. Mieux vaut donc laisser le drame plaider sa propre cause.
Du moins reste-t-il évident que, dans cette dernière pièce, Ibsen nous a donné sa meilleure mesure. L’action n’est pas paralysée par des complications excessives, comme dans Les Piliers de la Société, ni déchirante de simplicité comme celle des Revenants. Nous avons ici le caprice et l’extravagance chez Ulfheim, l’humour le plus subtil aussi dans le mépris sournois que se témoignent Rubek et Maïa. Mais Ibsen a voulu que rien ne vînt entraver la libre action de son drame. Aussi n’a-t-il point soigné, comme à l’accoutumée, ses personnages secondaires. Dans nombre de ses œuvres, ceux-ci sont des créations achevées. Qu’on songe seulement à Jacob Engstrand, à Tonnesen ou au démoniaque Molvik. Ici, l’auteur ne permet pas que notre intérêt se disperse sur des figures d’arrière-plan.
Quand nous nous réveillerons d’entre les morts rivalise dignement avec les plus belles productions d’Ibsen, peut-être même est-ce son chef-d’œuvre suprême. Dernière d’une liste qui débuta avec Maison de Poupée, cette pièce constitue l’épilogue grandiose d’une longue carrière. Par leur technique comme par l’intérêt qu’ils suscitent, peu de drames anciens ou modernes passent le théâtre d’Ibsen.
James Joyce.
[1] Joyce réagit là contre une tendance des plus répandues dans la critique littéraire et dramatique bourgeoise: la réduction de l’œuvre à, l’anecdote et le jugement soi-disant objectif. N. d. T.
[2] 2 – C’est donc à Ibsen que Joyce semblerait avoir emprunté l’idée de son Ulysse : présenter en vingt-quatre heures la vie entière de ses héros Bloom-Uysse et Stephen-Télémaque. -N. d. T.
[3] Traduction M.- Prozor.
[4] 4 – Tel est exactement, de Dubliners à Finnegans Wake, le programme que Joyce observera lui-même. Comme Ibsen, il choisira ses héros parmi la classe moyenne, et les montrera engagés dans un immense déterminisme à la fois social, cosmique et mythique. N. d~ T.
[5] On jugera, par le besoin qu’éprouve Joyce de justifier cette « audace », du puritanisme de la société dans laquelle il suffoquait. N. d. T
[6] Telle est peut-être l’influence essentielle qu’Ibsen a pu exercer sur le romancier ; le détachement vis-à-vis de ses héros restera le trait le plus frappant de l’œuvre joycienne. Cf. Dedalus . « L’artiste, comme le Dieu de la création, reste à l’intérieur, ou derrière, ou au-delà, ou au-dessus de son œuvre, invisible, subtilisé, hors de l’existence, indifférent, en train de se curer les ongles. » N, d. T.

Jean Cocteau
Ibsen
Le 9 octobre 1960
« Ibsen. Il est difficile de tenir entre nos mains cette neige sombre et comme éclairée par le soleil noir de la mélancolie de Dürer.
Un schizophrène habite tous les artistes. Beaucoup en éprouvent de la honte et le cachent. D’autres ne sont que sa main-d’œuvre. D’autres collaborent avec lui.
Sans ce fou mêlé à nos ténèbres intimes, une œuvre de poète ne serait rien.
Chez Ibsen, la permanence d’un tel fantôme ressemble à cette fausse nuit nordique où baignent les pièces de Strindberg.
L’admirable d’Ibsen, c’est la force avec la quelle il brave l’hôte inconnu. Il lui oppose la sagesse du psychologue et les pointes de la satire. Peer Gynt résume ce travail s’alchimiste et lorsque Peer devient le cocher du lit de mort de sa mère, l’intelligence (la grande ennemie des poètes) cède la place aux miracles du cœur. Le schizophrène et le dramturge réussissent l’équilibre merveilleux qui ne semble plus venir d’un homme célèbre mais être l’expresssion anonyme d’une époque et d’une patrie.
C’est l’extrême pointe où le style domine un style particulier et rejoint les phénomènes et les énigmes de la nature.
Les revenants, Maison de Poupée, La Comédie de l’amour. Par ces trois contrastes débute un long cortège, véritable avant-garde du réalisme irréel qui sera un jour le signe de notre siècle. »

Ludvig Binswanger
Le Problème de l’autoréalisation dans l’art
La vie comme un drame sur la scène du monde
Extraits de Le Problème de l’autoréalisation dans l’art, Éditions De Boeck Université/Bibliothèque de Pathoanalyse. Texte français Michel Dupuis.
« Se réaliser soi-même dans la conduite de sa vie, c’est, selon, moi, la chose la plushaute qu’un homme puisse atteindre. Cette tâche, nous l’avons tous, les uns comme les autres, mais la plupart des gens la bâclent. » Henrik Ibsen avait cinquante-quatre ans quand il écrivit ces mots à l’ami qui devait être la personne « la plus grande » et la« direction de sa vie », à Björnstjerne Björnson. Ces mots contiennent la confession philosophique de sa vie, le leitmotiv de sa biographie, le résultat de son expérience vécue et, surtout, le problème fondamental autour duquel tourne l’oeuvre de sa vie d’écrivain.
À ce point où s’unissent la biographie, l’expérience et le travail de la vie, dans la perspective d’une hauteur à atteindre, en l’unité d’une forme vitale, d’un style vital, et où ils ne sont rien d’autre que les différents aspects de cette forme unique, c’est là que la vie elle-même est montée comme un drame sur la scène du monde. En effet, l’unité de la forme vitale suppose que toutes les possibilités de la vie n’ont de valeur qu’en fonction d’un tout, que ce tout est pourtant un « problème », une ob-jection [Vor-Wurf]à chercher dans et à travers la vie. Selon Ibsen lui-même, le jugement[1] que l’homme posera sur lui-même dépend de la réussite de ce pro-jet. Tout ceci constitue en fait les marques distinctives de la « tension » dramatique[2].
Les pièces d’Ibsen, ses drames, ne sont en réalité que des reconstructions et des reproductions artistiques du drame de la vie humaine en général, de laquelle sa propre vie n’était non plus qu’une forme spécifique. Le propre de cette forme est précisément que le drame de la vie fut vécu excellemment ici dans la forme du drame poétique, de l’oeuvre d’art dramatique. Nous mettons l’accent sur le mot art. C’est vrai qu’à la basede toute production dramatique réside – pour le dire avec Leopold Ziegler[3] – « la poussée poético-ludique vers la transformation de soi », vers la « métamorphose ».
Cette poussée ludique est pourtant encore très éloignée de l’art. La question de l’autoréalisation dans l’art et par l’art se pose pour la première fois quand l’homme, et c’était le cas chez Ibsen, maîtrise et configure cette poussée dans l’abandon sans condition à l’obligation et à la contrainte de l’art, à ce qui est exclusivement objectif enlui. C’est d’abord de cette manière qu’il parviendra à se préserver de la dissolution dansl’oubli de soi et de la mutilation suicidaire, et qu’il arrivera comme artiste au sommet de ce que l’homme peut atteindre, et par conséquent à la réalisation effective de soi.
L’autoréalisation dans la manière de vivre la vie pratique : le détour en vue du Retour
Ce qu’Ibsen entend par autoréalisation dans la manière de vivre, et ce qu’il désigne aussi ça et là brièvement comme le sérieux dans cette manière de vivre, apparaît à nouveau dans une lettre à son ami, écrite par Ibsen quand il avait trente-neuf ans : « Je sais que j’ai été sérieux dans ma façon de vivre, sous une croûte de non-sens et de saleté. » Comme preuve de ce sérieux, il ajoute du même coup : « Sais-tu que je me suis toute ma vie éloigné de mes parents, de toute ma famille, parce que je ne voulais pas demeurer en l’état de demi-intelligence ? » Cette demi-intelligence concernait surtout le domaine de la religion. D’abord, Ibsen avait quinze ans quand il s’est « enfui», pour assurer lui-même, à partir de ce moment et pendant plusieurs années, sa subsistance comme apprenti et comme premier commis-pharmacien. En décidant de quitter safamille, Ibsen fait le premier pas «sérieux », dont nous ayons connaissance, vers l’autoréalisation. Mais l’anticipation de l’achèvement des possibilités d’être est contenue dans chaque décision actuelle de la vie : de cette manière […], Ibsen a déjà accompli, en cette décision, une pré-décision pour sa vie tout entière. La demi intelligence, l’être-à-demi en général, c’est le contraire de la forme ; c’est l’absence de forme, le compromis. Vu que la compréhension ou le comprendre signifient toujours et partout le dévoilement ou l’accessibilité, la transparence ou la clarté (de l’étant), la demi-compréhension signifie donc toujours quelque chose comme un voilement ou une inaccessibilité, une non-transparence ou une non-clarté – en un mot, la non-vérité. Dans l’état « non-vrai » de la demi-intelligence, ne se trouvaient qu’à demi accessibles ou transparents non seulement les parents vis-à-vis du fils et le fils vis-à-vis des parents, mais du même coup, le fils aussi lui-même.
L’autoréalisation au sens où l’entend Ibsen, c’est-à-dire considérée comme la « tâche la plus haute » pour chacun d’entre nous, n’est quant à elle possible qu’à la lumière et sous la conduite de la possibilité d’être la plus haute de l’existence elle-même, laquelle – en tant que « mesure » ou «jugement – peut octroyer forme, mesure et direction à toutes les autres. Se réaliser soi-même, nous le voyons déjà ici, signifie donc tout autre chose que « vivre sa vie ». Car en vivant notre vie, nous ne nous réalisons précisément pas nous-mêmes, mais seulement quelque chose de ou dans notre existence, c’est-à-dire les possibilités d’être purement hédonistes, avec la mise hors circuit justement de la possibilité d’être proprement « humaine».
Le jeune Ibsen a quitté ses parents et sa famille pour ne pas demeurer avec eux dans l’état de non-vrai d’une demi-intelligence : cela indique à quel point il possédait précocement son soi – autrement dit, la grandeur, déjà à ce moment, de son pouvoird’être et de la « puissance de sa personnalité », qui donnaient direction à son existence. Pour un si jeune homme, cette direction ne pouvait guère se nommer que : là-bas, hors de la pesante étroitesse de la situation domestique, au loin, ou encore, dans une interprétation temporelle, la délivrance du présent et du passé, et la libération pour un futur propre. Car l’autre chemin qui permettait de sortir de la situation de compromis d’une demi-intelligence, le chemin du changement des autres, de leur instruction, de leur éducation et de leur conversion, ce chemin était naturellement encore barré à un homme si jeune. Dans la mesure où la voie vers le lointain, l’éloignement, maintenant comme pour la suite, n’était pour Ibsen que le détour en vue du retour dans la proximité des autres, précisément en vue de leur instruction, de leur éducation ou de leur conversion, la résolution du jeune Ibsen de se séparer de sa famille (comme plus tard de se séparer de sa patrie, de sa communauté et de son État) signifie en réalité l’anticipation de l’achèvement possible des possibilités d’être constituant son existence. Le sérieux de la manière de vivre, l’autoréalisation, ne s’arrêtent donc pas chez Ibsen, lalibération de la demi-intelligence avec sa famille. Avec son pays natal non plus, il ne pouvait pas rester « dans l’état d’une demi-intelligence». Ici encore, il ne se voulait que « transparent » à lui-même, «clair » ; ici encore, il ne se trouvait lui-même « en vérité » que par l’inversion résolue de l’à–demi et de l’étroitesse des « rapports » nationaux en la totalité et la largeur de « rapports culturels libres et libérateurs ». En 1884 encore –Ibsen est né en 1828 –, il écrit à son ami de jeunesse : « Quand il y a dix ans, j’abordais le fjord, après dix-neuf ans d’absence, je sentis que ma poitrine se nouait, littéralement, dans l’oppression et le malaise. » « Je n’étais plus moi-même sous tous ces yeux norvégiens, froids et sans compréhension » (je souligne). Et en 1888, à Georg Brandès : « J’ai commencé par me sentir Norvégien, puis j’ai grandi en Scandinavie et je suis maintenant comme un Germanique-en-général ». Nous pouvons ajouter: « arrivé à bonport », comme un Humain-en-général. « On ne vit pas pour rien pendant vingt-sept ans au-dehors, dans les grands rapports culturels libres et libérants », écrit-il, presque septuagénaire, dans un coup d’oeil rétrospectif adressé au même correspondant. « Ici à l’intérieur ou, pour le dire plus exactement, ici en haut, dans les fjords, je possède, il est vrai, le pays de ma naissance. Mais – mais – mais : où trouvé-je le pays qui soit ma patrie ? Ce qui m’attire le plus, c’est l’océan…»
Dans le lointain libérant des « grands rapports culturels », Ibsen s’est libéré lui-même et s’est étendu au large, il s’est réalisé dans une forme toujours « plus claire et plus forte ». Mais au-delà de cette forme encore, son esprit sans repos pousse vers le large, dans un large éloigné de toute culture, dans l’étendue « infinie » de la nature « qui est la patrie », celle de l’océan.
Ce qui vaut pour le rapport à sa propre famille et à son pays natal, vaut aussi pour le rapport à la société. Avec elle non plus, il ne pouvait pas vivre dans une demi intelligence; d’avec elle aussi, il acheva la séparation, la rupture, au profit de la totalité, de la forme claire de son soi. Ce n’est pas par haine envers la société, ce n’est pas comme un révolutionnaire né ou comme un ennemi de la société qu’Ibsen est devenu « critique de la société » – un rôle que l’on a trop mis à l’avant-plan en considération de ses drames ; il l’est devenu au contraire sur la base du sérieux de la manière de vivre, qui ne lui permettait pas de pactiser avec une société comparée au bateau sur lequel le bruit court qu’il transportait « un cadavre dans sa cargaison »[4]. Dans cette image poétique s’exprime le soupçon qu’à la manière d’un Jakob Burckhardt, d’un Nietzsche, d’une Gervinus, il avait conçu après 1870-1871, envers une société derrière la prospérité et l’activité de laquelle il percevait l’odeur de la pourriture, de la vie descendante[5]. Chez Ibsen, la critique sociale n’est pas une volonté de bouleversement, mais uneaffaire de voyance et une mise en demeure. Il avertit parce qu’il voit, parce que partout et en toutes choses, l’étant lui devient accessible « en vérité », transparent, de telle façon que toute dissimulation de la vérité, toute demi-mesure peut lui devenir choquante et objet de soupçons. Ce qu’il hait, ce n’est pas la société en général, mais la non-vérité de sa demi-mesure qui ne permettait pas à ses contemporains d’advenir à eux-mêmes en son sein, de se réaliser eux-mêmes.
De plus, ce qu’Ibsen avait sous les yeux, ce n’est pas seulement que son temps pouvait être « décrit comme une conclusion », mais aussi qu’une chose nouvelle voulait « naître » de son temps. « Je crois », dit-il en 1887 lors d’une fête organisée en sonhonneur à Stockholm, « que nous sommes à la veille d’un temps où le concept politique et le concept social cesseront d’exister dans leurs formes actuelles, et où l’un et l’autre croîtront en une unité qui porte en soi avant tout les conditions du bonheur de l’humanité ». Ici encore, Ibsen est un voyant. Parallèlement, il s’est toujours senti comme un « franc-tireur isolé », qui veut « se tenir à l’extérieur des avant-postes, et opérer de sa propre main ». Il savait que « la majorité, la masse, la foule, ne pourraient jamais le rattraper », qu’il ne pourrait jamais avoir la majorité pour lui. Comme « combattant spirituel en première ligne », il se trouvait dans une « avancée incessante » : « À l’endroit où je me tenais quand j’écrivais mes divers livres », écrit-il à cinquante-cinq ans, « il y a maintenant une foule bien compacte. Mais moi je n’y suis plus – je suis ailleurs, plus loin devant, du moins je l’espère.[6] » Mais « l’être à l’avant » de celui qui se tient isolé à l’avant-poste et le « en avant » de celui qui marche dans une progression perpétuelle ne sont, nous l’avons vu, que des anticipations de la possibilité d’être la plus haute ; ainsi donc, la catégorie propre de l’autoréalisation chez Ibsen, comme chez tout homme au sens plein du terme, ne peut être celle de l’éloignement au large, mais uniquement celle de l’ascension dans la hauteur. C’est seulement dans la progression en hauteur que l’homme peut atteindre le point le plus haut ; de même, il le manque seulement dans le fait de tomber, dans la chute. Le point le plus haut n’est cependant atteint que lorsque l’avant et le vers l’avant au-delà de la foule, du monde d’autrui, anticipent le retour vers le monde d’autrui et le monde des proches[7]. Ce qui vaut pour le rapport d’Ibsen à la société, vaut finalement encore pour son rapport à l’Etat. « L’État est la malédiction de l’individu ». « L’État a sa racine dans le temps ; il aura son sommet dans le temps. Des choses plus grandes que lui disparaîtront… » « Je n’ai aucun talent de citoyen. » « Pour moi, la liberté est la première et la plus haute condition de la vie. » « La Norvège est (en effet) un pays libre, (mais) peuplé de gens non libres. » « Le travail de libération ne devra-t-il donc être permis que dans le domaine de la politique ? N’y a-t-il donc pas, avant toute chose, des esprits qui ont besoin de libération ? » « Je ne serai jamais d’avis de considérer la liberté comme synonyme de liberté politique. Ce que vous nommez liberté, je l’appelle libertés ; et ce que j’appelle lutte pour la liberté, ce n’est tout de même rien d’autre que l’appropriation continuelle, vivante, de l’idée de liberté. Car celui qui possède la liberté autrement que comme une chose à désirer, il la possède morte et inanimée ; je vous l’assure en effet, leconcept de liberté a la particularité de s’éloigner constamment durant l’appropriation, et si donc quelqu’un s’arrête durant le combat et dit : maintenant je la tiens ! – eh bien, en faisant cela, il révèle qu’il l’a perdue. Mais justement, avoir cette espèce morte, une position fixe et ferme sur la liberté, c’est une caractéristique des rapports d’État ; et c’est bien ce que j’ai pensé, quand j’ai dit qu’il n’y a rien de bon » (lettre à GeorgBrandès). Et au même : « Et alors la merveilleuse envie de liberté – c’en est fini. Oui, moi au moins, je dois le dire – la seule chose que je préfère à la liberté, c’est le combat pour elle ; sa possession m’indiffère. »
Par ces déclarations sur la liberté, Ibsen rappelle Lessing et Kierkegaard. Mais elles nous révèlent aussi quelque chose de sa conception de l’histoire. Tout comme pour Hebbel mais en nette opposition avec Grillparzer, pour Ibsen, l’histoire n’est pas un passé clôturé reposant derrière nous ; c’est une présence qui exige une active coopération, un changement continu de formes, dont le poète dramatique est appelé à vivre et à mettre en forme, en résonance avec elles, la destruction et l’édification « dramatiques ». À propos de l’histoire aussi, Ibsen est comme Nietzsche, pour le dire avec les mots de Shelley, le « miroir d’une ombre gigantesque que le futur a jetée sur le présent ». Que des « choses plus grandes » que l’État disparaissent… Il vise tout d’abord la religion. Et dans la foulée, il ajoute : « Ni les concepts moraux, ni les formes artistiques n’ont une éternité devant eux. »
Les déclarations sur la liberté jettent à nouveau une lumière significative sur la conception ibsénienne de l’autoréalisation, conçue comme un élargissement incessant et interminable de moi-même dans l’incessant changement de toutes les formes qui constituent le monde, à partir desquelles seulement je me comprends bien moi-même, et avec le changement desquelles seulement la forme de mon moi se transforme à son tour. Par suite, l’autoréalisation signifie que l’homme écarte tout ce qui s’interpose entre lui et son monde, tout ce qui lui « truque » [« verstellt »] le monde ; en d’autres mots, l’homme se libère de tout « lest » étranger à soi, il perce tout « à-demi », il tranche tout lien non libre et il « bat monnaie du métal » qu’il porte en lui. C’est ainsi qu’Ibsen écrit un jour à Georg Brandès: « Ce qu’avant toute chose je voudrais vous souhaiter, c’est un authentique égoïsme pur-sang, qui puisse devenir pour vous le motif, durant unepériode, de n’attacher valeur et signification qu’à vous-même et à votre cause, et de considérer tout le reste comme non existant. Ne prenez pas ceci comme le signe d’une certaine brutalité de ma nature ! La meilleure façon dont vous puissiez être utile à voscontemporains n’est tout de même que de battre monnaie du métal que vous portez envous. Je n’ai jamais réellement eu un grand sens de la solidarité ; je n’ai véritablement retenu qu’un dogme traditionnel – et si l’on avait le courage de laisser cela complètement hors de considération, on se libérerait peut-être du lest qui pèse très lourdement sur la personnalité. D’une façon générale il est temps –, vu que l’histoire du monde m’apparaît comme un naufrage extraordinairement grand -, il s’agit de se sauver soi-même ! »
Avec l’exigence de se sauver soi-même, Ibsen se trouve parmi une série d’hommes quiva de Socrate à Kierkegaard, Nietzsche, Jaspers et Heidegger, et qui, dans le « naufrage extraordinairement grand » de notre temps, a une mission plus grande que jamais. Cela étant, ce serait une profonde erreur de croire qu’Ibsen ait été un individualiste isolationniste. « La défense de la vie individuelle » n’a rien à voir avec l’isolationnisme individualiste. La déclaration sur la nécessité de la libération des esprits témoigne déjà du contraire, de même que la limitation significative de l’« égoïsme pur-sang » « à une période », c’est-à-dire à la période durant laquelle on se tient seul à l’avant-poste et où l’on poursuit l’avancée. Par cette limitation de l’égoïsme pur-sang à une période, à une phase de transition dans l’autoréalisation, Ibsen se distingue de Nietzsche et de Stirner. Il savait que c’est « la chaleur du coeur qui doit exister avant tout, si une vie spirituelle vraie et forte doit se développer », et il priait expressément qu’on fût persuadé que cettechaleur ne lui faisait pas défaut. Qui ne parviendrait pas à le croire n’a jamais scruté jusqu’au fond aucun de ses drames. Chez Ibsen, l’autoréalisation s’est produite dans une autre proximité que celle du « sens de la solidarité », c’est-à-dire le sens de l’entourage actuel, dans lequel notre existence est jetée sans que nous y soyons pour rien ; elle s’est réalisée dans la proximité du regard aimant et de la communication spirituelle ; l’autoréalisation ne serait autrement pas possible « à la longue ». Et le médium de cette communication, de ce retour aux autres dans une rencontre libre avec eux, ce fut son écriture. […] « Par nature, un poète appartient à la catégorie des presbytes. Jamais je n’ai contemplé la patrie et la vie vivante de la patrie de si près, si fortement et si clairement, que de loin justement, et dans l’absence»[8]. Ici encore, le lointain, la distance, la coupure ne sont que le détour vers la liaison et la communication authentiques.
Nous avons traité jusqu’ici de l’autoréalisation d’Ibsen dans la lutte contre la famille, la patrie, la société et l’État. Nous envisageons maintenant son autoréalisation dans la lutteavec lui-même. Nous devons bien sûr reconnaître clairement qu’il ne s’agit ici que d’une distinction artificielle : la lutte avec le monde d’autrui signifie réellement aussi la lutteavec soi-même[9]! Nous nous heurtons de nouveau ici au concept de sérieux. Ibsen parle une fois du combat « que tout homme sérieux doit soutenir avec soi-même, pour mettreen accord la conduite de sa vie et de sa connaissance ». Et il parle ici de façon assezsignificative des « personnes et des destins personnels » tirés de l’un de ses drames, dela pièce Rosmersholm – en dehors de l’incitation au travail que représente cette lutte,dont traite la pièce (comme d’ailleurs toutes ses pièces). Cette déclaration datant de ses cinquante-neuf ans, nous pouvons la confronter à une autre, extraite d’une compositionqui date de ses vingt ans, et qui résonne d’une façon très semblable – c’est la preuvequ’Ibsen était très tôt au clair sur la route de l’autoréalisation, et qu’il l’a suivie de façontrès conséquente : « pour autant que l’homme puisse lui-même exercer une influence réelle sur son destin, il pourrait le faire bien plus encore s’il possédait assez de connaissance de soi pour toujours adapter son agir aux forces dont il dispose, et pourtoujours connaître suffisamment ses tendances de manière à ce qu’elles ne l’emportentpas sur lui » (De l’importance de la connaissance de soi). Dans la préface à la seconde édition de Catilina, son oeuvre de jeunesse écrite quand il avait vingt et un ans, il interprète ce qu’il appelle le « conflit individuel » à surmonter dans l’autoréalisation,comme la « contradiction entre la force et l’aspiration, entre la volonté et la possibilité», et il y voit « la tragédie en même temps que la comédie de l’humanité et de l’individu ». La plupart des choses dont traitera son oeuvre ultérieure, Ibsen croit les reconnaître déjà dans cette oeuvre des débuts, «dans des indices vagues » – preuve de laconséquence avec laquelle il a poursuivi et travaillé le problème fondamental de sa vie et surtout, de son travail d’écrivain. Ailleurs, il parle encore de la « contradiction entre le mot et l’acte, entre la volonté et le devoir, plus généralement entre la vie et lathéorie ». L’homme qui demeure dans cette contradiction, demeure, pour utiliser le langage d’Ibsen, dans une « demi-intelligence » avec lui-même. Ainsi, ce qui vaut pour l’éloignement et la proximité par rapport à la patrie, est valable aussi pour l’éloignementet la proximité par rapport au soi propre : c’est seulement dans la distance « du presbyte » par rapport à nous-mêmes, par « constitution et par caractère », que nousarrivons à l’authentique proximité avec nous-mêmes, à la liberté et à l’indépendanceproprement du «Soi ». Mais ici encore, le retour-vers-(soi-même) n’est possible que sur le chemin escarpé sur la hauteur, dans la transcendance au-delà de soi dans lacommunication ou la rencontre d’amour avec l’étant en totalité ; c’est uniquement en celles-ci qu’à notre tour nous pouvons devenir accessibles et transparents à nous-mêmes« en vérité ». Accessibilité et transparence sont donc tout autre chose que le« refoulement » d’une part et la « sublimation » d’autre part. L’autoréalisation consiste bien plus en ce que toutes les possibilités d’être de notre existence gagnent direction, mesure et forme grâce au pouvoir d’être d’une chose « la plus haute », d’un Agathôn ;en d’autres termes, en ce qu’elles contractent une ???????? ou une liaison « plus hautes ».
Ibsen et l’autoréalisation dans la forme artistique
Comme nous l’avons vu, on parcourt le chemin de l’autoréalisation en s’éloignant des autres et de son « fond » propre, puis en revenant aux autres et à soi-même en passant par la hauteur. Autrement dit : l’éloignement, le chemin qui va de l’étroit vers le large, ne peut ramener ensuite à la juste proximité que s’il est en même temps un chemin vers le haut, une ascension. L’ascension est même le chemin de sortie si, comme ce fut le caschez Ibsen, elle contient l’anticipation du retour-à [« Zurück-zu »]. La hauteur dont il est question ici, Ibsen l’appelle le sérieux, d’autres l’appellent la prudence (c’est la phronésis des Grecs depuis Héraclite), d’autres encore l’appellent l’«esprit». Il s’agit cependant de montrer ce que signifie l’« esprit » d’un point de vue anthropologique.
Nous ne nous contentons pas de parler de possibilité ontologique spirituelle, d’être spirituel, d’être « dans l’esprit » ou, selon un terme philosophique technique, de transcendance spirituelle[10]. Bien plus, nous tenons à comprendre la manière de la transcendance spirituelle à partir de la direction de sens anthropologique originelle de la hauteur, plus exactement de l’ascension dans la hauteur. Cette hauteur maintenant, cette transcendance par conséquent, vers laquelle le processus de transcendance se produisit chez Ibsen, ce n’était ni la religion, ni la philosophie, ni la science. Nous le savons,c’était l’art. […]
Il est du plus haut intérêt de voir quelle impression Rome et l’Italie en général ont produite sur l’artiste nordique. Ibsen est entré dans Rome quand il avait trente-six ans, et il a quitté la ville pour la première fois à quarante. Nous somme en 1864, l’année même où Hans von Marées est arrivée à Rome, lui aussi. Je ne trouve pas d’indication du fait qu’ils se soient rencontrés à Rome. Si différents qu’ils aient été, voire opposés, en tant qu’artiste et en tant qu’hommes, ils eurent tout de même deux choses encommun : ils ont réalisé à partir d’eux-mêmes, en un long travail, ce qu’ils sont devenus, et ils ont reconnu la mission de l’artiste en tout premier lieu dans le fait de montrer à ceux qui les entourent, la plénitude totale et inépuisable du « subsistant »[Bestehende][11]. Certes, Marées s’est infatigablement efforcé de montrer le « subsistant » dans ses configurations complètes ; Ibsen quant à lui, nous a montré le « subsistant » surtout dans ses formes incomplètes, voire manquées, c’est-à-dire comme il est « dans sa vérité ». C’est pourquoi on peut dire d’Ibsen ce que Goethe a dit de Molière: « Molière a corrigé les hommes en les dessinant dans leur vérité[12]. »
La force de son être d’artiste est attestée par le fait que Rome n’a jamais été un danger pour Ibsen ; ce ne fut qu’une époque – décisive, il est vrai – de son autoréalisation dansl’art. Alors que le gothique l’avait tout d’abord « interpellé » et que la cathédrale deMilan fut pour lui « la chose la plus subjugante » qu’il pût imaginer dans ce domaine,c’est surtout à Rome que « la beauté de la sculpture antique » s’est révélée à lui : « Çavient en un éclair mais un unique éclair qui jette de la lumière sur de grandes surfaces ».À partir de la sculpture antique, la compréhension de l’essence de la tragédie grecques’est ouverte à lui, c’est-à-dire « de la vie et de l’essence des Grecs » en général, et parlà, de « ce qui est véritablement l’impérissable de la beauté ». « Ah si je pouvais mettremaintenant cette connaissance en pratique, au moins dans mon domaine ! ». Ce« maintenant » ne s’est pas fait longtemps attendre. Cette fois l’« éclair » ne vint pas dela sculpture antique mais de l’architecture, et de l’architecture renaissante précisément.Un beau jour, presque six mois après cette déclaration sur la cathédrale de Milan, alorsque son travail « ne voulait pas avancer », il entra dans la Basilique Saint-Pierre : « Làm’est apparue en une fois une forme puissante et claire pour ce que j’avais à dire ». Letravail, en fait, qui ne voulait pas avancer, c’était « Brand ». « Brand », le Titannordique et la Basilique Saint-Pierre de Rome ! Pour comprendre ou mieux, pourpressentir ce qui s’est passé ici, nous devons revenir une fois encore à la cathédrale de Milan. Ce qui dégoûta profondément Goethe, qui rentrait d’Italie, dans cette « énormité », parce qu’ici «l’absurdité sans imagination qui l’inspira, avait aussi la force de dessiner un plan pour ainsi dire sans fin »[13], c’était justement « la chose la plus subjugante » pour Ibsen qui, du Nord, arrivait en Italie ; et après cet aveu, Ibsen ajoute : « L’homme qui a pu imaginer le plan d’une telle oeuvre aurait pu aussi, durant ses tempslibres, avoir l’idée de fabriquer une lune et de la lancer en l’air, dans l’espace céleste ».Tandis que Goethe ne voyait dans la grandeur que le non sens d’une « petitesse multipliée » à l’infini, Ibsen y voyait une puissance capable de lancer un corps céleste dans l’infini. […]
En plus de la forme claire et puissante de l’architecture et de la sculpture, une touteautre chose apparut aussi à Rome, une chose non romaine. Il l’écrit dans la même lettreà Björnson, dans les « environs merveilleux » de Rome il ne lut « rien d’autre que laBible – qui est forte et solide ». À la forme claire et puissante se joint ainsi le contenupuissant et solide. C’est précisément à Rome, dit-il, qu’Ibsen « expulsé » de lui-mêmel’« esthétique », qui l’avait tellement possédé autrefois, « en tant que chose isolée quipose l’exigence de valoir pour elle-même ». « L’esthétique en ce sens me semblemaintenant constituer une malédiction pour la poésie, autant que la théologie pour lareligion » (toujours dans la même lettre à son ami). Qu’il se soumette naturellement auxlois de la beauté, mais qu’il ne s’occupe pas de ses règlements traditionnels. C’est ainsique selon son point de vue, « personne plus que Michel-Ange n’a péché contre lestraditions de la beauté » ; « mais tout ce qu’il a crée est tout de même beau : parce quec’est plein de caractère ». Par contre, l’art de Raphaël ne l’a jamais enthousiasmé, car« ses formes datent d’avant la chute originelle ». L’homme du Sud « veut le beauformel : pour nous, même le formellement non beau peut être beau, fort de la vérité quiréside en lui » (à Georg Brandes). C’est pourquoi aussi, « le caractère de l’homme detous les jours n’est aucunement trivial d’un point de vue artistique ; en tant quereproduction artistique, il est aussi intéressant que n’importe quel autre ». […]Pour le jeune Ibsen déjà, la forme n’est jamais une chose que l’on ajoute de l’extérieur,aux hommes et aux objets ; c’est une chose qui tient à des intuitions, « dont la vérité estfondée dans l’essence de la chose même, et dont, par conséquent, on ne peut pasdiscutailler ». Pour Ibsen, la forme signifie presque littéralement ce que Goethe appellele style, même si le style, selon Goethe, réside « dans les fondements les plus profondsde notre connaissance, dans l’essence des choses, pour autant qu’il nous soit accordé dela reconnaître dans des formes visibles et saisissables[14] ». Contrairement autranscendantalisme esthétique soutenu récemment, et avec succès, par Jeanne Hersch(« l’être et la forme »), nous trouvons ici à l’oeuvre, chez Ibsen comme chez Goethe,ce que nous pouvons appeler un « réalisme esthétique », comme la seule foi ontologiquequi soit absolument appropriée à l’artiste.
Avec tout ceci nous avons depuis longtemps touché au thème de la réalité et de la véritéen art. Pour Ibsen qui l’a écrit un jour en évoquant Les Revenants, ce qui compte leplus, avant toute autre chose, dans ses drames, c’est de « provoquer chez le lecteurl’impression qu’il expérimente durant la lecture un fragment de réalité ». Et il estparticulièrement reconnaissant à un critique de Solness le Constructeur, d’avoir nonseulement « correctement interprété et éclairé » les figures dépeintes, mais « avoirprécisément fait ressortir leur caractéristique de personnes qui appartiennent à laréalité ». Dans cette pièce justement, cette détermination lui a particulièrement tenu àcoeur. On l’a déjà dit, en pensant aussi à Rosmersholm, il souligne qu’avant tout, lapièce « est naturellement un oeuvre [Dichtung] de personnes et de destins personnels ».Certes, à vingt-trois ans déjà, Ibsen écrit dans l’une de ses critiques théâtrales que « cen’est pas la réalité qui appartient, tant bien que mal, au domaine de l’art, mais bienplutôt l’illusion ». Mais il ajoute que si la réalité immédiate n’est pas autorisée auroyaume de l’art, « l’oeuvre d’art qui ne porte pas en soi la réalité », est égalementinjustifiée. Nous aurons à y revenir dans l’analyse de Solness le Constructeur. Et dansune autre critique théâtrale de la même année, Ibsen demande aux écrivains de « séparerdistinctement les exigences de la réalité et celles de l’art », mais bien sûr seulement« aussi longtemps, qu’ils n’ont pas assez de goût pour dégrossir les côtés rudes de laréalité, avant de saisir la réalité en vue de la reproduction poétique dans le cadreartistique ». L’art national, par exemple, n’est pas « servi par la copie des petitesses dela vie quotidienne », mais uniquement par le fait que l’écrivain sait « communiquer àson oeuvre ce ton fondamental qui résonne pour nous, de la montagne, à la vallée, desversants montagneux jusqu’aux rivages, mais surtout de l’intérieur de nous-mêmes ».Les gens, pour qui réalité et vérité sont synonymes, devraient considérer comme fausseet malsaine toute pièce qui n’est pas « dans le rapport de la photographie à la réalité ». Ildoit être clair ici que l’expression « illusion » ne peut pas être liée à la réalité artistiqueen tant que telle, mais seulement au processus de « médiation » de son caractère deréalité sur le spectateur, l’auditeur, le lecteur ! Nous n’avons pas le droit d’absolutiser laréalité soi-disant « objective », de façon à l’opposer à l’art comme illusion ou « belleapparence trompeuse », mais si nous parlons encore d’illusion, nous devons comprendreque la « réalité objective » est elle-même une sorte d’illusion, ou bien, comme Thurevon Uexküll l’a avancé récemment de manière si perspicace, qu’elle est « un mondedélirant parmi d’autres », développé « par la méthode physicaliste » comme par la «loiscénique, sous laquelle elle apparaît[15] ». Je renvoie aux considérations sur la réalitéartistique contenues dans le livre déjà cité de Jeanne Hersch L’être et la forme (1946), eten particulier, une fois encore, aux concepts fondamentaux de la poétique d’Emile Staiger.
Un pas plus loin, et nous voici au concept ibsénien du « symbolique » dans l’art. PourIbsen, abstraction faite d’un « profond sentiment du caractère sacré et de l’importancede l’art », ce qui distingue tout grand artiste, c’est « une aspiration enthousiaste, nonvers la réalité grossière, mais vers la vérité, vers ce rendu supérieur, symbolique, de lavie, la seule qui vaille réellement la lutte dans le monde de l’art et qui est pourtantreconnue par tellement peu de personnes seulement » (souligné par moi). En effet :« Toute personnalité remarquable est symbolique dans sa vie, symbolique dans ses acteset dans son rapport aux résultats de l’histoire. » En fait, « les manifestations trèssignificatives de la vie » devront « être potentialisées dans l’art », mais seul l’auteurmédiocre élève cette symbolique de la personnalité à la conscience. Et cela vaut aussipour l’« idée symbolique qui est à la base d’une oeuvre dramatique ». D’où l’exigencequ’« elle passe secrètement à travers l’oeuvre, comme la veine d’argent à travers laroche ». Jamais dans ses conversations et dans ses lettres, Ibsen n’aime à lever le secret de l’idée symbolique qui se trouve à la base des ses drames : il est obsédé par unecrainte presque féminine que cette idée soit dévoilée. La dissimulation et le voilementde l’idée rendent évidemment plus difficile une compréhension univoque de son oeuvre,et d’un autre point de vue, cela explique au fond que la discussion à propos de chacunde ses drames ne se termine jamais, qu’elle reste toujours ouverte ; de même, que laproblématique humaine de ses oeuvres n’est pas affectée par le changement des formessociales et artistiques qui s’est produit depuis, et qu’elle peut nous émouvoir,aujourd’hui encore comme il y a cinquante ans. Mais l’autre raison fondamentale dececi, c’est justement ce qu’Ibsen conçoit derrière l’expression « symbolique ». Comme nous l’avons vu, « symbolique » veut dire avoir du caractère (Michel-Ange), avoir une signification, être potentialisé, être vivant (au contraire de l’échafaudage sec) – tout autant que représentatif (personnalité symbolique). « Symbolique » veut dire en premierlieu la plénitude « réelle » de la vie humaine, en même temps que son atmosphèreextérieure et intérieure, abritant et figurant en soi selon son essence propre ; en un mot,« symbolique » signifie aussi bien vrai. Le «rendu symbolique supérieur de la vie » est donc synonyme du rendu de la vie dans sa vérité essentielle, dans la vérité de la forme artistique claire et puissante.
Jetons maintenant un coup d’oeil en arrière ! Ce qui lie l’autoréalisation d’Ibsen dans la conduite de la vie pratique à l’autoréalisation dans la forme artistique, en d’autres mots, ce qui est commune à l’homme-Ibsen et l’artiste-Ibsen, c’est la dépendance[Angewiesenheit] absolue de son existence à la forme « claire et puissante ». On a vu cette dépendance autant du point de vue de ce qu’il avait à dire (poétiquement) que de ce qu’il avait à faire (pratiquement). C’est seulement en cela qu’on peut comprendre comme anticipation de l’accomplissement de ses possibilités d’existence, et la décision de s’éloigner de sa famille, et la résolution de mettre en accord la vie et la théorie, lemot et l’acte, la volonté et le devoir – la résolution de toujours adapter ses comportements à ses forces et de maîtriser ses tendances. L’existence d’Ibsen s’est en effet « accomplie » dans l’autoréalisation et sa mise en ordre [Einordnung] dans la structure de sa personnalité en totalité [Gesamtpersönlichkeit], de son soi tout entier. Nous devons encore clarifier ce que nous appelons dépendance de l’existence parrapport à la forme, car cette expression de « forme » est si abstraite et tellementplurivoque ! D’abord, nous devons ne pas considérer ici la forme en opposition aucontenu. La forme est ici absolument une teneur ou un contenu également[16], et même uncontenu relatif à l’existence, une puissance d’être de l’existence, et même uneexceptionnelle parmi celle-ci : l’extrême ou la plus haute. Elle est cette puissance, oucette possibilité d’être qui, nous l’avons vu, confère à toutes les autres puissances d’être de l’existence à la fois leur rang dans l’entièreté de l’existence et leur signification pourla direction d’ensemble de cette même existence. Quand Ibsen oppose au non-sens et àla saleté, le sérieux de la conduite de la vie comme la tâche authentique de chacun denous, et quand il prend parti pour ce sérieux, nous voyons bien quelle force d’existenceil considère comme la plus haute, comme celle qui guide. Dès le début, ce sérieux,signifie en fait une forme décisive dans son existence : nous l’avons vu à sa résolutionde faire éclater les chaînes de l’environnement familial, et encore celles que luiimposaient ses « inclinations ». On a déjà plusieurs fois expliqué dans quelle mesureune telle résolution signifie que l’existence « dépend » de la forme. Cette dépendancepar rapport à la forme signifie que l’existence est menée par une puissance d’être, qui nesupporte aucun état d’à-moitié, aucune non-clarté, aucune non-vérité, aucune faiblesse.C’est la puissance ontologique de la véracité. Ce qui lie très profondément la véritéartistique, la véracité de l’artiste, et la vérité pratique, la véracité de l’homme dans laconduite de sa vie pratique – plus exactement, ce qui est à la base des deux choses –c’est l’impatience, et même l’intolérance face à toute demi-intelligence, ou à touteintelligence « non véritable », comme face à l’« insupportable ». C’est vrai aussi face àtoute non-clarté, toute non-accessibilité ou toute dissimulation de l’étant, qu’il s’agissed’une situation mondaine, d’un rapport interhumain, d’un rapport à soi-même ou encorede l’être-au-monde en général en tant qu’artistiquement non-transparent, nonaccessible,caché. L’homme réel et l’artiste réel, c’est donc seulement celui qui nesaurait supporter cette non-clarté mondaine et cette non-clarté artistique. Quant à laproductivité, elle est le corrélat existentiel de l’incapacité de supporter. La productivitédans n’importe quel domaine, n’est possible que comme autoréalisation, commeanticipation résolue d’un éclaircissement ou d’une clarté possibles, comme percée del’existence à travers la dissimulation de l’étant de façon à « l’amener à la lumière » dansquelque forme de vérité que ce soit, et à lui donner une forme dans cette lumière. Un teléclaircissement ou une telle productivité ne signifient pas seulement pour l’existence unélargissement de son monde, une prise de possession « plus large » du monde, maisselon la structure de l’être-au-monde, en même temps un élargissement et une élévationdu soi. Cette impatience et cette intolérance « productives » face à tout à-demi, toutenon-vérité ou non-clarté dont nous avons parlé, c’est en effet l’expression existentiellede ce que l’existence ne peut supporter que son monde soit trop étroit et trop sombre,trop non-clair ; autrement dit, que l’homme ne peut supporter l’existence de cette formeou, mieux, de cette non-forme. Existence pesante et productivité sont donc des traitsessentiels de l’autoréalisation qui s’impliquent réciproquement. Ce comportementproductif signifie une élévation de la capacité d’être du soi, et précisément sous laconduite de la plus haute force d’être possible pour l’existence, c’est-à-dire celle quidécide dans le sérieux. Dé-cider [Ent-scheiden] veut dire distinguer entre des régionsnon éclairées et éclairées de l’étant dans son entier, faire le pas hors de l’insupportablequ’on sait pesant et non-clair, du présent et du passé pesants, vers un futur possiblementclair et supportable. Les caractères d’être « supportable ou insupportable » ne sontnaturellement pas des caractéristiques de certaines situations en tant que telles, maisbien de la situation existentielle actuelle d’un soi actuel. Le caractère insupportable nesignifie ici rien d’autre que l’enchaînement ou la non-liberté du soi ; le caractèresupportable, rien d’autre que la liberté, comme ouverture du monde dans une « libredécision ». En cela, la forme ne représente pas non plus une contrainte, mais la nécessitéde la liberté.
Tout ceci trouve son point critique suprême dans l’autoréalisation dans la formeartistique, donc dans la productivité artistique. C’est uniquement à cause de cela que l’on pouvait parler chez Ibsen d’une anticipation de l’accomplissement des possibilitésd’être à travers tout le non-artistique. Si la productivité artistique est la forme la pluspure de la productivité, ce n’est pas seulement parce que les puissances d’être et du nonsenset de la saleté y sont non seulement condamnées mais bannies [verbannt] (ce quiest le cas naturellement aussi dans les sciences et la philosophie), mais parce que laforme, et elle seule, est ici proprement le contenu de produit, ce qui « constitue » toutela sphère d’être et dont l’intentionnalité « remplit totalement », par là même, le moded’existence en cause, à savoir le mode esthétique. De la même façon, dans l’artjustement, des régions non-claires de l’étant dans son entier « sont amenées àlumière » ; de même, la création artistique est une marche productive aventureuse,incertaine, pour sortir de la non-clarté insupportable de l’existence et entrer dans uneexistence supportable, éclairée. La forme spécifique d’éclairement de l’existence parl’art, c’est la forme artistique ou esthétique, la vision artistique et l’oeuvre d’art. Touteproduction d’une oeuvre d’art, toute création artistique, correspondent à la résolution del’existence de se rendre accessible ou d’éclairer l’étant dans la vérité de la forme« symbolique » essentielle. L’oeuvre d’art elle-même signifie cet accomplissement del’éclaircissement de l’étant en entier dans une forme artistique « nécessairement »libérante. Mais ce n’est pas seulement l’étant non-éclairé en général qui estinsupportable à l’existence comme artistique – il y a aussi tous les éclaircissements ourésolutions non-artistique de l’étant, les éclaircissement scientifiques, philosophiques etreligieux et avant tout, l’éclaircissement de l’étant dans le mode de la praxis, de la vie« pratique ». Cependant, pour l’existence artistique, tout cela ne représente aucunementun éclaircissement de l’étant. On ne peut naturellement pas concevoir ceci d’un seulpoint de vue psychologique ; on doit le comprendre anthropologiquement etontologiquement. En effet, cela ne tient pas ici à ce que cette intolérabilité « vient ounon à la conscience » de l’artiste concret lui-même, à tel moment ; il s’agit de quelquechose de plus que la conscience de l’artiste : il s’agit de l’existence comme artistique, dela forme d’existence artistique. Ibsen l’a justement souligné, la forme d’existenceartistique doit se laisser engager dans les projets du monde d’espèce non-artistique, enparticulier dans la « vie » de tous les jours, par conséquent en tant que régions nonéclairéesde l’étant. Cependant, contrairement à ce qui arrive si souvent, nous nepouvons pas pour autant comprendre le mode d’être artistique en contraste, ou enopposition avec n’importe quelle autre forme d’existence lui étant insupportable. L’artne signifie aucunement, comme est tenté de le croire le profane en matière artistique, lafuite ou le rétablissement d’un autre mode d’existence d’insupportable, que ce soit entant que création ou comme plaisir artistique. La « situation », dont l’artiste cherche à se« libérer » en général avec toute oeuvre particulière, qui « pèse sur lui », qui lui est« insupportable », n’est plus, on l’a déjà dit, une situation mondaine déterminée ; elleest bien plutôt la façon d’être insupportable de l’être opprimé[17] par l’étant dans sonentier en tant que totalité encore sombre, non-éclairée, non-ouverte – et précisémentnon-ouverte au sens de la forme artistique. Cette « hypersensibilité » si souvent remarquée, cette labilité[18] du génie artistique n’est qu’une seule face de la forme d’êtreartistique en général, précisément celle sur laquelle l’étant pèse le plus, celle qu’ilopprime le plus, celle pour qui, comme dit Goethe, « l’affaire presse ». Celle dont on nepeut libérer l’oppression et la congestion que dans la vision et la productivité artistiques,dans le projet du monde comme monde de l’art. C’est ce projet qui, pour l’artiste, selonles termes d’Ibsen, « seul mérite la lutte » est dont il se fait « un devoir sévère etexclusif ».
De quelle sorte maintenant, est le projet de monde en tant que monde de l’art ? Nouspouvons nous engager d’autant plus vite dans l’examen de cette question que noussommes convaincu, avec Goethe, que la « beauté » ne peut jamais s’exprimer sur ellemême; en d’autres mots, qu’elle ne peut jamais devenir le fondement d’énoncés àvaleur objectivement universelle. Nous remarquons seulement que ce monde aussi a sapropre vérité, qu’il exige sa propre véracité, et que, si cette vérité, comme dit Ibsen, doitêtre « fondée dans l’essence des choses elles-mêmes », cette essence est vue depuis leprojet de monde artistique. Cette vérité n’a absolument pas besoin d’être enconcordance avec l’essence des choses vue à la lumière de la vie quotidienne ou de lascience, d’autant qu’elle est par ailleurs appelée à approfondir encore la vérité de cetteperspective quotidienne et scientifique.
Ici, quand nous parlons de l’autoréalisation d’Ibsen dans la forme artistique, toute notrequestion doit être d’accéder à une idée plus proche de l’essence véritable de cetteréalisation. De quelle espèce est ce soi qui se réalise dans la forme artistique, de quelleespèce est son processus de devenir, et comment se rapporte-t-il au soi dans le sensexistentiel ou, comme dirait Ibsen, au soi de la conduite de la vie pratique ? Voilà lesquestions vers lesquelles nous devons maintenant nous tourner.
L’oeuvre tout entière, la vie littéraire d’Ibsen, montrent avec quelle intensité, duranttoute sa vie, il a lutté avec ces questions, comment il a toujours gardé une pleineconscience de leur sens et de leurs conséquences pour sa propre existence et pour cellede l’artiste en général. Nous sommes ici devant les questions vitales, véritables, d’Ibsenen tant qu’il est un des grands artistes. De la façon de souffrir et de porter cesproblèmes, dépendent non seulement la vie et la mort de l’artiste mais aussi la réussiteou l’échec de la mission artistique elle-même. Ibsen a trouvé quant à lui les expressionsles plus prégnantes pour cette souffrance et pour cette charge, quand il a reconnu, alorsqu’il avait septante ans, en un regard rétrospectif sur sa vie – lui d’habitude si réservé etsi retenu : « Ma vie a été comme une longue, longue Semaine Sainte ». […]
Texte français Michel Dupuis. Extraits de Le Problème de l’autoréalisation dans l’art, Éditions De Boeck Université/Bibliothèque de Pathoanalyse
[1] Voyez les vers célèbres d’Ibsen : « Vivre veut dire combattre en soi les fantômes des forces obscures ;composer, tenir le jour du jugement au-dessus de son propre moi. »
[2] Voyez Emile Staiger, Grundbegriffe der Poetik, Zürich, 1946. « Style dramatique : tension » (pp. 155
et sv.)
[3] Zwei Goethereden und ein Gespräch, Leipziz, 1932, p.41.
[4] Voyez la lettre rimée à Georg Brandès.
[5] Voyez L. Binswanger, « Le cas Ellen West » in Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie, Volumes LIII, LIV, LV.
[6] Le docteur Stockmann, l’« ennemi du peuple », exprime souvent littéralement les mêmes faits ; il exprime particulièrement clairement la position d’Ibsen dans lemonde. – Comparez avec la déclaration de Goethe à Eckermann (14 avril 1824) : « Ces braves gens m’ont très peu touché, ils m’ont tiré dessus alors que j’étais déjà à des lieues d’eux. »
[7] C’est uniquement cela qui distingue tous les « records » des schizophrènes de ceux du génie !
[8] Dès 1867, il avait écrit à son grand ami : « Non, prends ton temps, carissimo ! Parce que la distance élargit l’horizon, et ensuite parce qu’on sort aussi du même coup de l’horizon des braves gens. Je suis sûr que les gens de Weimar formaient à son époque le plus mauvais public de Goethe. » Un passage des annotations au Neveu de Rameau peut nous indiquer comment Goethe lui-même considérait le « public », et comment Ibsen aussi devait éprouver cela assez douloureusement dans sa propre chair : « Le goût des natures qui ne produisent pas est quand même malheureusement négatif, dénégatif, exclusif, et finalement il prend la force et la vie aux natures qui produisent. »
[9] 31 Voyez Heidegger : « L’étant existant ne se voit que si, d’un même coup, il se saisit dans la transparence de son être auprès du monde et de son être avec autrui, en tant que ceux-ci forment des moments constitutifs de son existence » (Sein und Zeit, p. 146 ; trad. Boehm de Waelhens, Gallimard, 1964).
[10] Seul celui qui ignore la doctrine heideggerienne de la transcendance comme être-au-monde pourra
estimer que cette expression est un pléonasme.
[11] Voyez Wölfflin, Klein Schriften : Hans V. Marées, pp. 75 et sv.
[14] La Chaux-de-Fonds, 1946.
[15] Voyez « Wirklichkeit als Geheimnis und Auftrag », Berne, 1945, p. 76.
[16] Voyez Nietzsche là-dessus : « On est un artiste à condition de percevoir comme contenu, comme « la
chose elle-même », ce que les non artistes appellent la « forme ». Ainsi on appartient certainement à un
monde inversé : car à présent le contenu d’une chose devient quelque chose de simplement formel – notre
vie y compris. ». L’ajout de « notre vie y compris » et sa pénible réalisation valent tout particulièrement pour la « vie » d’Ibsen.
[17] Voyez Hoffmannsthal : » Seul l’opprimé saisit ce qu’est l’esprit », Buch der Freunde 2ème éd., p. 44 et
là-dessus, L. Binswanger, Studia philosophica, Jahrbuch der Schweizerischen Philosophischen
Gesellschaft, vol. VIII, 1948.
[18] Nous faisons complètement abstraction ici de la labilité ou de la fragilité du Beau en tant que tel.
Voyez O. Becker, Von der Hinfälligkeit des Schönen und der Abenteuerlichkeit des Künstlers,
Husserl-Festschrift, 1929.

Rainer Maria Rilke
Les Cahiers de Malte Laurids Brigge
Extrait
Extrait de Les Cahiers de Malte Laurids Brigge
Traduit de l’allemand par Maurice Betz, 1926
« … Et voici que j’étais devant tes livres de têtu et que j’essayais de les imaginer, à la manière de ces étrangers qui ne respectent pas ton unité, de ces satisfaits qui se sont taillés une part dans toi. Car je ne connaissais pas encore la gloire, cette démolition publique d’un qui devient et dans le chantier duquel la foule fait irruption en déplaçant les pierres.
Jeune homme quelque part en qui monte je ne sais quoi qui te fait frémir, profite de ton obscurité. Et si te contredisent ceux qui font fi de toi, et si t’abandonnent tout à fait ceux avec qui tu fréquentais, et s’ils veulent t’extirper, à cause de ta chère pensée, qu’importe ce danger visible qui te concentre en toi-même auprès de la maligne hostilité, plus tard, de la gloire – qui te rend inoffensif en t’épandant.
Ne demande à personne de parler de toi, même pas avec dédain. Et si le temps passe et que tu t’aperçoives que ton nom circule parmi les hommes, n’en fais pas plus de cas que de tout ce que tu trouves dans leur bouche. Pense qu’il est devenu mauvais, et rejette-le. Prends-en un autre, n’importe lequel, pour que Dieu puisse t’appeler en pleine nuit. Et tiens-le secret à tous.
Ô toi le plus solitaire, à l’écart de tous, combien vite ils t’ont rejoint, en se servant de ta gloire! Eux qui si récemment encore étaient contre toi de fond en comble, voici qu’ils te traitent comme leur égal. Et ils portent tes mots avec eux dans les cages de leur présomption, et ils les montrent sur les places, et les excitent un peu, du haut de leur sécurité : tous tes fauves enchaînés.
Et je te lus seulement, lorsqu’ils s’échappèrent et m’attaquèrent dans mon désert, les désespérés. Désespéré comme tu finis par être, toi-même dont la route est mal dessinée sur les cartes. Comme une fêlure elle traverse le ciel, cette hyperbole sans espoir, qui ne s’incline qu’une seule fois vers nous et s’en éloigne de nouveau terrifiée. Que t’importait qu’une femme restât ou partît, que le vertige saisit quelqu’un et la folie quelqu’autre, que les morts fussent vivants et que les vivants pussent sembler morts; que t’importait tout cela ? Tout cela était si naturel pour toi; tu le franchissais, comme on traverse un vestibule, sans t’arrêter. Mais tu t’attardais et te baissais, là où notre devenir bout, se précipite et change de couleur : au dedans. En un tréfonds où personne n’avait jamais pénétré, une porte s’était ouverte devant toi, et voici que tu étais près des cornues, sous les reflets de la flamme. Là où tu n’emmenas jamais personne, méfiant, c’est là que tu t’assis et que tu discernas des différences. Et c’est là – parce que c’était la force de ton sang de révéler, et non pas de former ni de dire – que tu pris cette décision inouïe de grossir à toi seul ce fait tout menu (et que tu ne distinguais d’abord qu’au fond de tes éprouvettes), de telle sorte qu’il apparût à des milliers d’hommes, immense devant tous. Et ton théâtre fut. Tu ne consentis pas à attendre que cette vie, presque sans réalité dans l’espace, condensée par le poids des siècles en fines gouttelettes, fût décelée par les autres arts, qu’elle fût peu à peu rendue visible au petit nombre et que peu à peu ceux-là qui communieraient dans cette connaissance, finissent par désirer de se voir ensemble confirmer ces rumeurs augustes, dans la parabole de la scène ouverte sous leurs yeux. Non, tu ne voulus pas attendre si longtemps. Tu étais là, et ces choses à peine mesurables : un sentiment qui montait d’un demi degré, l’angle de réfraction d’une volonté aggravée d’un poids à peine sensible, cet angle que tu devais lire de tout près, le léger obscurcissement d’une goutte de désir et cette ombre d’un changement de couleur dans un atome de confiance – cela, il fallut que tu l’établisses et que tu le retinsses; car c’est en de tels phénomènes qu’était à présent la vie, notre vie, qui s’était glissée en nous, qui s’était retirée vers l’intérieur, si profondément qu’on ne pouvait plus se livrer sur elle qu’à des suppositions.
Tel que tu étais, révélateur, poète tragique et sans époque, tu devais d’un seul coup transposer ces mouvements capillaires en les gestes les plus évidents, en les objets les mieux présents. Et tu entamas alors cet acte de violence sans exemple : ton œuvre, vouée de plus en plus impatiemment, de plus en plus désespérément, à découvrir parmi les choses visibles les équivalents de tes visions intérieures. Il y avait là un lapin, un grenier, une salle où quelqu’un allait et venait; il y avait un bruit de vitres dans la chambre voisine, un incendie devant les fenêtres, il y avait le soleil. Il y avait une église et un vallon rocheux qui ressemblait à une église. Mais cela ne suffisait pas, les tours finirent par entrer et des montagnes entières; et les avalanches qui ensevelissent les paysages comblèrent la scène chargée de choses tangibles, pour l’amour de l’insaisissable. Et alors il arriva que tu fus à bout de ressources. Les deux extrémités que tu avais pliées jusqu’à les joindre, rebondirent et se séparèrent. Ta force démente s’échappa du jonc flexible, et ce fut comme si ton œuvre n’avait jamais été.
Qui, autrement, comprendrait qu’à la fin tu n’eusses plus voulu quitter la fenêtre, têtu comme tu l’as toujours été. Tu voulais voir les passants ; car la pensée t’étais venue que l’on pourrait peut-être un jour faire quelque chose d’eux, si l’on se décidait à commencer. »