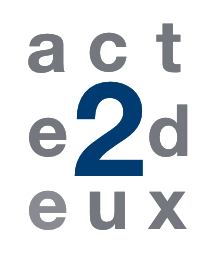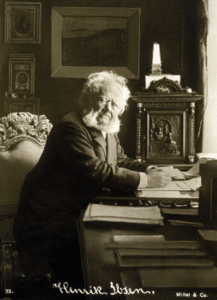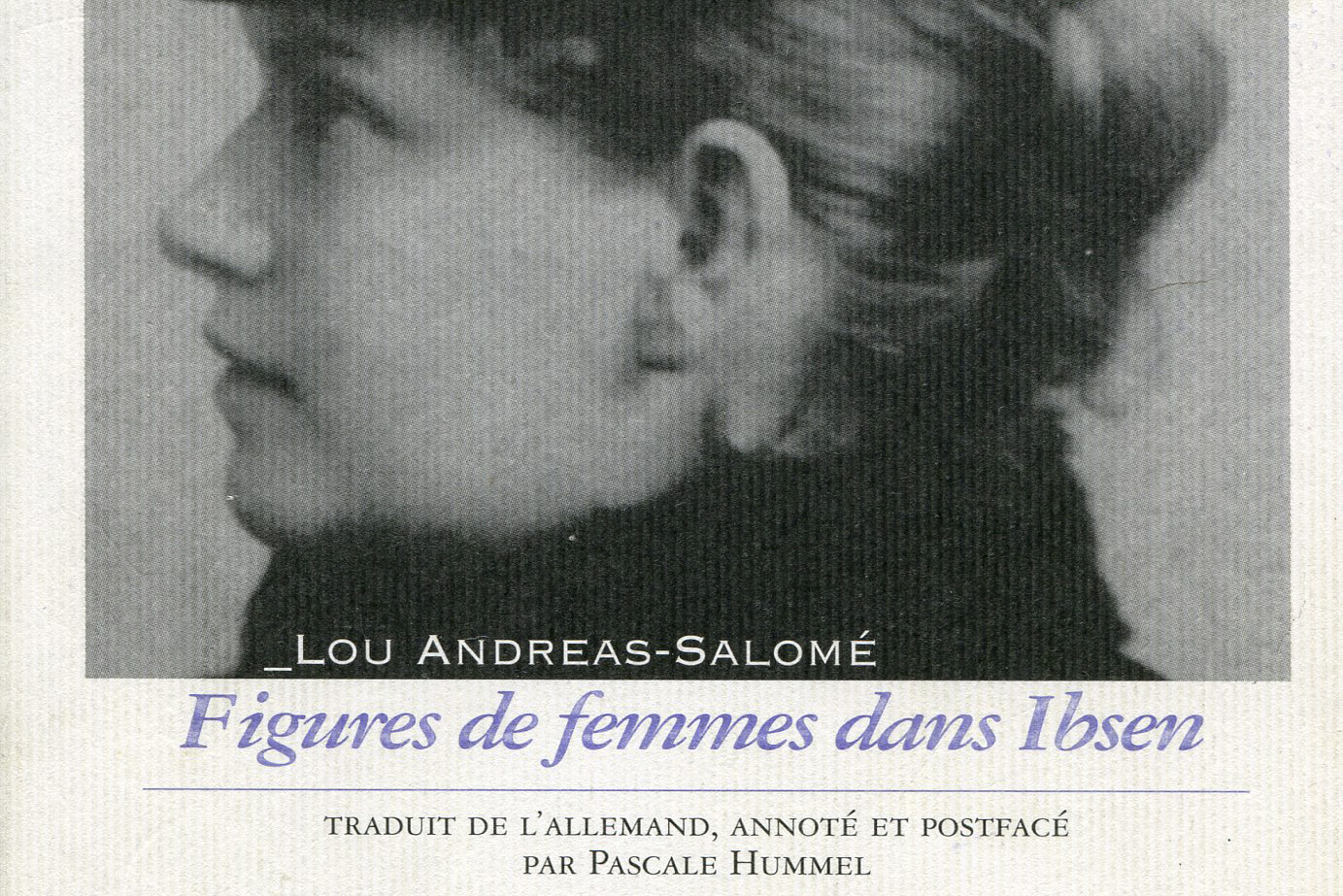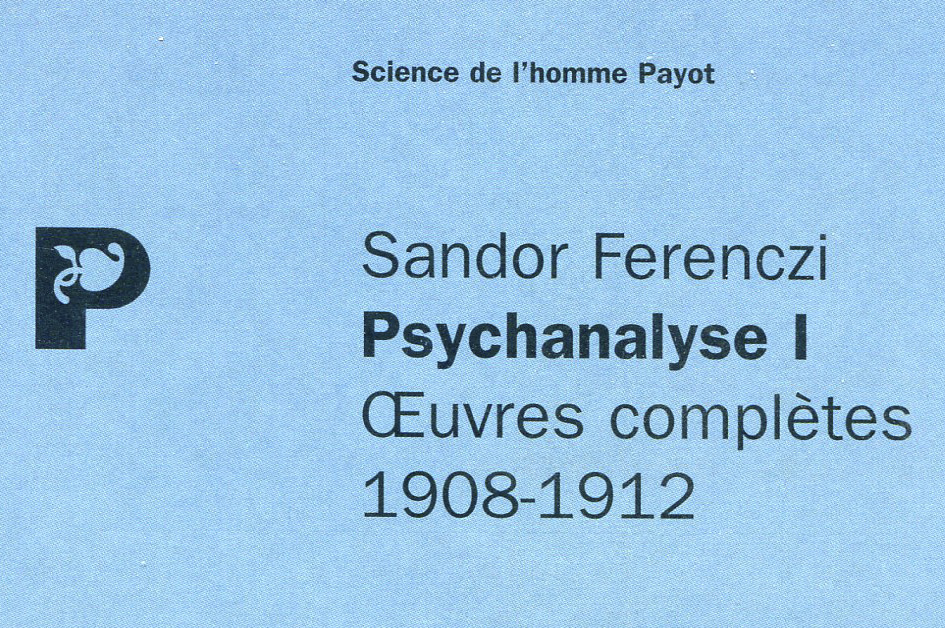Écrits / La Dame de la mer
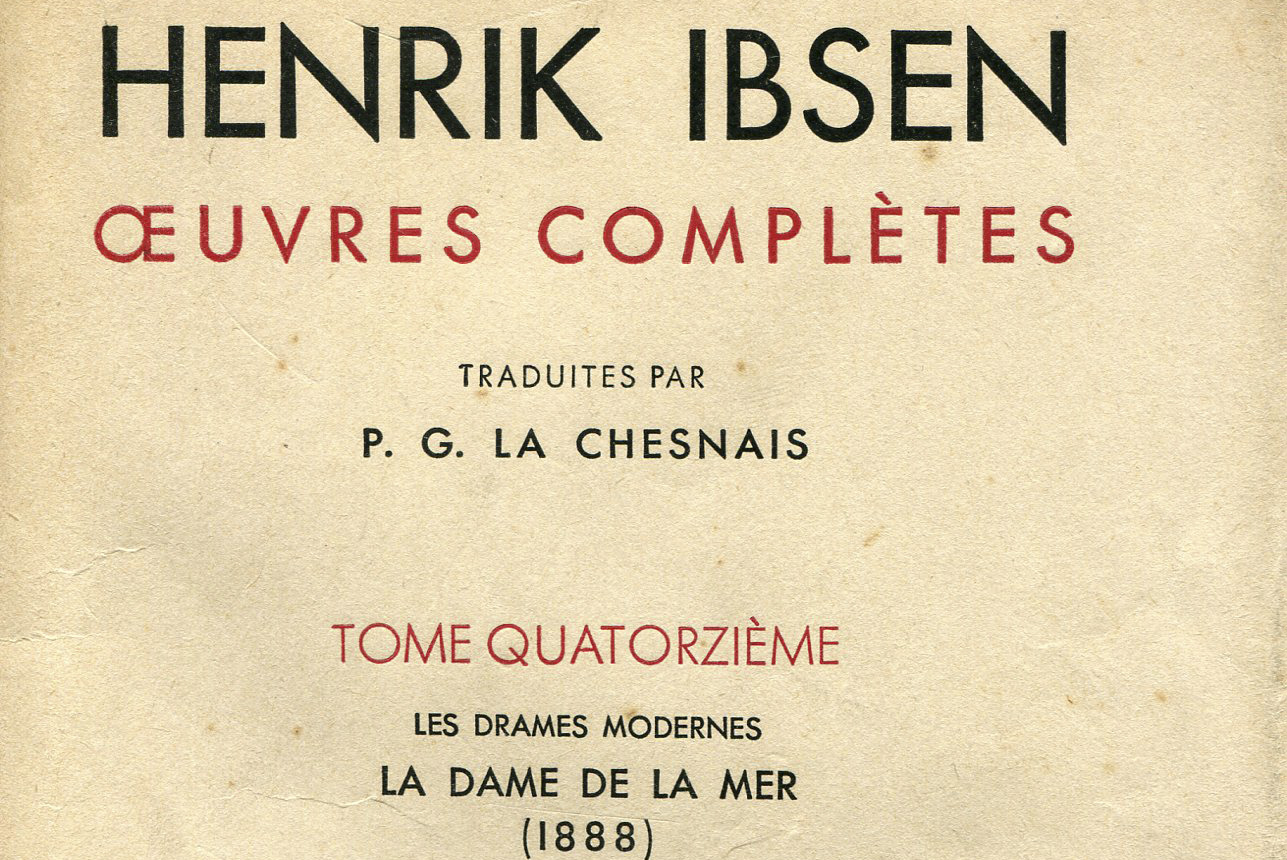
Henrik Ibsen
Œuvres complètes, Tome XIV, traduction de P.G. La Chesnais
Premier manuscrit / 5 juin 1888
Manuscrit sur trois doubles feuilles, daté en tête : 5-6-88, et comprenant deux parties qui commencent toutes deux au premier acte.
Ier acte. – Le petit point de relâche des vapeurs de touristes. On ne s’y arrête que lorsqu’il y a des voyageurs à débarquer ou à embarquer. Hauts fjelds escarpés tout autour. On ne voit pas la haute mer. Rien que le fjord sinueux. Hôtel des bains. Sanatorium plus haut. Quand la pièce commence, c’est le dernier voyage du vapeur en direction du nord pour l’année présente. Les navires passent toujours vers minuit. Ils glissent lentement, sans bruit, dans la baie, et en sortent de même.
Les personnages comprennent trois groupes. Il y a d’abord des types curieux parmi les habitants de l’endroit. L’avoué, marié pour la seconde fois avec la femme venue de la haute mer. Il a du premier mariage deux jeunes filles déjà grandes. Élégant, distingué, amer. Son passé taché par une affaire imprudente. Le développement de sa carrière, par suite, arrêté. Le barbouilleur d’enseignes déjeté, aux rêves d’artiste, heureux par ses illusions. Le vieux commis marié. Il a écrit en sa jeunesse une pièce qui a été jouée une fois. Il la retouche indéfiniment et vit dans l’illusion de la publier et de percer. Ne fait d’ailleurs pour cela aucune démarche. Se compte tout de même au nombre des littérateurs du pays. Sa femme et ses enfants croient aveuglément à «la pièce ». (Peut-être n’est-il pas commis, mais donne des leçons?) – Le tailleur Fresvik, mari radical de la sage-femme, qui manifeste son « émancipation » par des velléités ridicules d’inconduite, – liaisons avec d’autres femmes mariées; projets de divorce, etc.
Le second groupe est formé des estivants et des malades du sanatorium. Parmi ceux-ci est le jeune sculpteur malade, qui doit se fortifier pour supporter le prochain hiver. L’été suivant lui sont promis une bourse et un emploi et d’autres subsides, et alors il pourra s’en aller en Italie. Redoute la possibilité de mourir sans avoir vu le midi, ni rien créé de bon en art. – Son « protecteur » habite l’hôtel des bains. Exerce une tutelle sur le malade. C’est un homme à principes. Aucune aide, aucun subside cette année. La bourse est un engagement, « ensuite, nous verrons l’année prochaine jusqu’où nous pourrons aller ». Sa femme est bête, orgueilleuse et sans tact. Elle blesse le malade, tantôt exprès, tantôt par inadvertance. – Plusieurs personnages secondaires.
Le troisième groupe consiste en touristes qui arrivent et s’en vont, et qui interviennent épisodiquement dans l’action.
La vie, en apparence, est gaie, facile et pleine d’entrain là-haut, à l’ombre des fjelds et dans l’uniformité de l’isolement. Cependant, est exprimée l’idée que cette sorte de vie est une ombre de vie. Aucune vigueur d’action; aucune lutte pour l’affranchissement. Rien qu’aspirations et vœux. Ainsi vit-on là pendant le court été clair. Et ensuite… on entre dans les ténèbres. Alors s’éveille le vif désir de la grande vie du monde extérieur. Mais que gagne-t-on à cela? Suivant les situations, suivant le développement de l’esprit, croissent les exigences, les aspirations, les vœux. Lui ou elle, qui sont au faîte, recherchent les mystères de l’avenir et une part dans la vie de l’avenir et des relations avec les mondes lointains. Partout des bornes. D’où la mélancolie répandue comme un chant plaintif assourdi dans toute l’existence et la conduite des gens. Un clair jour d’été avec les grandes ténèbres ensuite,… voilà tout…
L’évolution humaine a-t-elle fait fausse route? Pourquoi nous sommes-nous trouvés appartenir à la terre sèche? Pourquoi pas à l’air? Pourquoi pas à la mer. Le désir d’avoir des ailes. Les rêves singuliers de savoir voler et de ne pas s’en étonner,… comment interpréter tout cela?…
Nous aurions dû nous rendre maîtres de la mer. Installer nos villes flottant sur la mer. Les déplacer vers le sud ou le nord suivant les saisons. Apprendre à réfréner tempêtes et orages. Une félicité viendra. Et nous,… qui n’en serons pas! Qui ne la vivrons pas!…
Puissance d’attraction de la mer. Aspiration à la mer. Gens apparentés à la mer. Liés à elle. Dépendants de la mer. Doivent y retourner. Une espèce de poisson constitue un chaînon primitif dans la série de l’évolution. Des rudiments en subsistent-ils dans l’esprit humain? Dans l’esprit de quelques humains?
Les images de la vie grouillante dans la mer et de « ce qui est à jamais perdu ».
La mer possède un pouvoir d’animation qui agit comme une volonté. La mer peut hypnotiser. La nature le peut, d’une façon générale. Le grand secret est la dépendance de l’homme à l’égard des « forces sans volonté ».
Elle est venue de la mer, où était le presbytère de son père. Elle y a grandi,… au bord de la pleine mer. Elle s’est secrètement fiancée avec le jeune second écervelé, – élève renvoyé de l’École navale – qui a passé l’hiver dans un port de refuge par suite d’une avarie survenue au navire. A dû rompre sur le désir de son père. Un peu aussi de bon gré. Ne pouvait pardonner ce qui était apparu au sujet de son passé. Elle était alors trop pleine de préjugés à cause de l’éducation reçue dans la maison paternelle. Ne s’est d’ailleurs jamais affranchie entièrement depuis des préjugés, bien qu’elle soit mieux au fait. Elle est à la limite, dans l’hésitation et le doute…
Le secret dans son mariage… qu’elle ose à peine reconnaître; auquel à peine elle ose penser. La force d’attraction de sa puissance d’imagination vers le précédent. Vers le disparu.
Au fond… dans sa représentation involontaire… c’est avec lui qu’elle vit sa vie de mariage.
Et – d’autre part – son mari et ses beaux-enfants vivent-ils tout à fait avec elle : ces trois-là n’ont-ils pas comme tout un monde de souvenirs entre eux? Il y a des jours de fête à célébrer, dont elle ne peut que deviner la portée. Des conversations tombent, – interrompues lorsqu’elle entre. Elle n’a pas connu celle qu’elle a remplacée, et par délicatesse on n’en parle pas quand elle est là. Il y a une franc-maçonnerie entre toutes les autres personnes de la maison. La gouvernante et les autres domestiques aussi. Jamais elle n’intervient dans ce que les autres savent être à eux. Elle reste en dehors.
Elle rencontre « le voyageur étranger ». C’est ainsi que l’appellent les autres baigneurs. Il a eu, autrefois, un vif penchant pour elle. C’était au temps où elle était fiancée avec le jeune marin. Il s’est surmené et doit prendre des bains de mer. La vie ne lui a pas donné ce qu’il avait espéré. Il est amer. Tranchant, sous une forme moqueuse.
Récit du sculpteur. Envoyé à la mer à douze ans. Naufrage avec le bateau il y a cinq ans. Avait alors dix-sept ans. C’est alors qu’il a eu sa maladie. Resta longtemps dans la mer froide. Pneumonie ensuite. N’en est pas encore tout à fait remis. Mais ce fut quand même un grand bonheur. Car c’est grâce à cela qu’il a pu devenir artiste. Pensez donc, modeler la délicieuse argile qui prend si délicatement forme entre les doigts !
Et que va-t-il modeler? Des dieux? Ou peut-être de vieux vikings?
Non, rien de ce genre. Dès qu’il pourra il essaiera de composer un grand groupe.
Et que représentera ce groupe?
Une scène qu’il a éprouvée lui-même.
Et qu’est-ce donc? Il finit par être obligé de la raconter.
Ce serait une jeune femme de marin couchée et dormant. Et elle rêve aussi. On peut le voir sur sa figure.
Rien de plus.
Ah! si, pourtant. Son mari s’est noyé. Mais il est rentré chez lui tout de même. Pendant la nuit. Et il est là, debout devant le lit, et la regarde.
Mais, grand Dieu,… il a dit que c’était une scène qu’il a éprouvée lui-même!
Hé! oui. Il avait bien éprouvé cela. Enfin, d’une certaine façon.
Éprouvé … ?
Eh bien ! oui,… il ne veut pas dire qu’il l’a positivement vu, bien entendu. Mais tout de même…
Et alors vient le récit – rapide et entrecoupé – qui provoque chez elle de terribles pressentiments et images.
Lou Andrea Salomé
Figures de femmes dans Ibsen
Ellida
 Figures de femmes dans Ibsen
Figures de femmes dans Ibsen
Traduit de l’allemand par Pascale Hummel, Édition Michel De Maule, Paris, 2007
Ellida : « Là – se trouve un pouvoir de transfiguration! »
Contagion, maladie, mort – voilà les noms servant à dénoter l’attraction, l’amour, le mariage dans Rosmersholm. Ce sont, en effet, les vieux antonymes de l’instinct et du dogme, de la liberté et de la dépendance, du monde dans la nature et du monde de la mansarde, qui se trouvent là derrière – sauf qu’ils trahissent leur profonde incompatibilité, non plus, comme jusque-là, par l’hostilité et la discorde, mais par la tragédie de leur concorde. Le contraste hostile se reflète, à vrai dire, encore plus durement dans la nécessité en laquelle l’abandon et la chute se conditionnent mutuellement que dans le combat fort meurtrissant que Nora ou madame Alving mènent pour leur émancipation.
Dans la mesure toutefois où Rebecca choisit l’abandon et avec lui la chute, l’incompatibilité apparente dans son amour et sa mort la pousse au mariage, en faisant apparaître immédiatement la véritable contradiction.
La surmonter et la résoudre – voilà en tout cas ce à quoi elle ne parvient plus, car sa force est précisément le prix de son amour. Elle atteste seulement le caractère inéluctable de sa solution et la préfigure, en accentuant fortement la contradiction existante – la contradiction venant de ce qu’elle est condamnée à souffrir et mourir de ce qui représente néanmoins pour tout son être la plénitude et l’élévation naturelle.
On pourrait donc concevoir que l’évolution de la langueur de Rébecca contenait en germe une crise, une guérison, une nouvelle santé et une naissance, exigeant seulement pour se faire jour un reste d’énergie juvénile. Ce n’est que pour la force qui se déployait déjà auparavant, pour la force épuisée et usée, qu’elle devient nécessairement une maladie mortelle.
Contagion, maladie, mort – la vie de Rébecca est tout entière contenue dans ces mots. Mais leur consonance est interrogative et attentive: où est la nouvelle vie, qui au malade, au mourant, apporte la guérison, où est le médecin qui connaît un remède dont il puisse affirmer: « Là – se trouve un pouvoir de transfiguration! »
La « Dame de la mer » tente d’apporter une réponse à cette question.
Elle vient de la mer. Autrement dit: son point de départ est le même que Rébecca. Elle vient de là où la plénitude domine encore dans l’atmosphère, la liberté dans la nature – de là où dans les âmes humaines il existe également encore une ondulation élémentaire, ascendante et descendante, non encore figée et bridée par des coutumes et des préceptes immuables, qui freinent les libres élans, comme les habitants des fjords se trouvent enfermés par leurs montagnes et leurs rochers.
Comme Rébecca, Ellida se trouve loin, malgré tout, du point où le roulis spontané de la mer apprend à se briser contre et à s’adapter à une direction étrangère, contre tous les rochers et les obstacles qui avec raideur dominent la jeunesse de Nora et de madame Alving – mais également toutes les hauteurs idéales qui permettent de sortir de l’étroitesse de la vallée et conduisent aux sommets de la vie.
Même si Ellida grandit ainsi, sauvagement et sans guide, dans le phare solitaire sur le rivage et, en raison de son nom peu chrétien, surnommée d’une manière assez significative la « païenne », sur un point, son existence se distingue substantiellement du manque de discipline qui entoura l’éducation de Rébecca; il manque toutes les influences positivement néfastes qui, si tôt et si brutalement, éveillèrent les violents instincts de l’être de Rébecca en leur procurant une expérience précoce et pernicieuse. C’est une innocence plus intime qui plane, encore intacte, au-dessus d’Ellida que cette non-culpabilité sauvage d’une vie naturelle, libre et sans frein, telle que la vécut Rébecca. Ellida est encore ingénue et inexpérimentée: elle attend encore tout son devenir, toute sa maturité, de la vie – mais Rébecca a déjà accompli son devenir, a déjà mûri, et, à vrai dire, dans une direction bien précise et unique, qui entrave nécessairement la suite de son épanouissement intérieur. Elle paraît ainsi plus avancée qu’Ellida dans son développement, et en même temps toutefois en retard sur elle dans sa capacité de développement – un peu comme un noble animal sauvage dans sa plénitude paraît à la fois supérieur et inférieur à un enfant mineur.
Cette différence entre elles est significative justement en ce qu’elle manifeste déjà clairement et distinctement en quoi Ellida est appelée à rectifier la protagoniste précédente: par l’approfondissement de son épanouissement personnel, par les possibilités multiples de son devenir. Elle préfigure déjà la raison pour laquelle les limites de Rébecca ne deviendront pas nécessairement aussi celles d’Ellida, et pourquoi là où la force expérimentée et aguerrie ne peut plus changer, mais seulement se briser contre une connaissance tragique, il existe encore des crises et des guérisons pour la croissance et la volonté d’Ellida.
Cette corrélation entre son inaptitude à changer et son statut de mineure fait certes apparaître, dès le début, Ellida comme encore plus désarmée à l’égard de la vie. Elle ne possède en rien la force confiante de Rébecca, ni la hardiesse téméraire par laquelle cette dernière confie la barque de sa vie aux vagues et aux tempêtes, en vue de conduire au bonheur. Elle se contente de se tenir impatiemment sur le rivage et de se projeter en rêve par-delà le mouvement des flots, sur lesquels planent le danger et la beauté, et dont la profondeur cache autant d’émerveillement que d’horreur.
Là où Rébecca n’est que provocation et obstination, Ellida n’est qu’attente et rêverie. Mais ses rêves restent bien plus inconsistants que les espérances précises de Rébecca: les vagues qui agitent la barque en haute mer éveillent des désirs et des craintes bien plus précis que la vaste surface luisante de la mer, qu’on contemple oisivement depuis le rivage – sans offrir nulle part au regard un appui, à la pensée un point d’arrêt, uniquement un espace d’autant plus incommensurable pour chaque vision de son imagination vagabonde.
Cette forte éclosion de la vie imaginaire aux dépens de la force pratique encore en sommeil est le deuxième trait qui différencie significativement Ellida de Rébecca. Il entre làdedans un élément de morbidité, ou, du moins, une disposition maladive, qui ne peut être surmontée que par la pleine maturité de la volonté. Mais en même temps, il y a là un élan vers l’intériorisation et l’approfondissement de la volonté, qui la met à l’abri du bon plaisir brusque et brutal de Rébecca – une paix de l’âme, où même les élans doux et subtils gagnent voix au chapitre et considération, avant qu’une pulsion ne devienne action. Si la volonté d’Ellida s’épanouit effectivement en une saine et consciente énergie, elle peut atteindre en cela une maturité bien plus noble et distinguée que cela n’eût été possible naguère à Rébecca. Cette dernière emprunte le chemin inverse; elle a pour point de départ une saine capacité d’action, dont le développement est précipité, et qui se trouve ensuite maladivement paralysée par une vie affective trop tardivement éveillée.
Cette différence dans leurs natures – Rébecca pleine de vitalité entreprenante et de maturité précoce, Ellida immature et surtout fantasque – se reflète significativement dans la forme et le sort de son amour. Tandis que la passion de Rebecca se déploie comme une fatalité, en asservissant et en commandant – la passivité impatiente d’Ellida est gagnée par l’amour comme par une nécessité, une poussée démoniaque de la volonté, excluant toute liberté de choix. Et tandis que Rébecca aspire à tout scruter et pénétrer avec discernement, à s’immiscer dans toute chose sans retenue, pour se l’approprier souverainement, Ellida succombe à l’attrait de l’inconnu et de l’insaisissable. De tous les individus qui dans le cours de sa vie l’approchent, le pouvoir de la dominer n’est donné qu’à celui dont elle ne sait et ne veut rien apprendre de précis – celui justement qui, d’une manière bien typique, reste pour elle anonyme -jusqu’à la fin l’étranger. C’est le pouvoir de l’inconnu qui explique son amour pour lui. C’est l’amour de la jeune créature immature à l’égard de la vie inconnue, qui à la fois dissimule profondément et se tient mystérieusement devant elle; c’est l’hésitation de la volonté désemparée devant cette obscurité encore privée de lumière, en même temps que le désir pressant de l’imagination de s’y précipiter; c’est l’aspiration à en être enlacée – la crainte d’être engloutie par elle; c’est à la fois le bonheur et l’horreur, l’attrait et la menace. Elle l’aime comme un symbole devenu chair, comme la vie elle-même dans sa liberté et sa violence cachées comme le regard vers l’infini, l’illimité et l’incertain. Elle semble ainsi épuiser sa singularité lorsqu’elle le compare à l’élément qui agit entièrement et complètement sur elle en symbole de la vie:
« L’homme est comme la mer! », dit-elle de lui. C’est pourquoi, du fait précisément de l’absence de toute conviction plus personnelle justifiant son ascendant sur elle, l’illimité augmente, le caractère indubitable de ce pouvoir même. Cette valeur symbolique de sa figure dès le tout début, cette identification de l’homme étranger et de la vie étrangère est profondément ancrée dans sa nature et situe le problème du lien qui l’unit à lui au-delà de l’anecdote d’une simple passion amoureuse. Il ne s’agit pas d’un sentiment isolé, d’une passion, mais d’un problème moral, d’un épanouissement de la volonté. Ce qui en Ellida aspire ardemment à la vie par des élans en partie seulement conscients et compris se trouve résumé et personnifié, à travers l’imagination qui la domine, dans l’emprise démoniaque de l’étranger. Cela apparaît tout particulièrement lorsqu’on compare ce symbole flottant, ce mirage, à la passion de Rébecca pour Rosmer, qui s’enracine tout entier dans le réel et le sensible. On comprend alors pourquoi cela ne pouvait aboutir pour Rébecca qu’à un affaiblissement et une destruction de son amour: car l’affaiblissement et la mort de la complète force de son être surtout, sa pleine dissolution, tandis qu’Ellida, en raison de son évolution et de son expérience, a surmonté l’emprise de l’inconnu. Il existe bien une différence, comme entre le rêve et la vie, entre le symbole et la personne.
L’apparition effective de l’étranger s’accorde fort délicatement et vivement en Ellida à sa conception symbolico-imaginaire. Chez chacun en particulier – même dans le plus petit trait, il chatoie en deux teintes, au gré de la lumière, alternativement froide et onirique, qui l’éclaire; il chatoie comme les flots mêmes de la mer, selon qu’il est éclairé par la lumière du jour ou de la lune.
À en juger par son apparence, il est sans le moindre doute l’aventurier expérimenté, habile et hardi, qui se débrouilla aussi radicalement dans toutes les circonstances de la vie que sur les flots de la mer, et pour lequel la liberté effrénée et tumultueuse est le seul élément où il peut respirer. Or pour Ellida il surgit en quelque sorte des ondes sur un rivage solitaire. Son passé lui reste lointain et étranger, comme s’il reposait dans les profondeurs de la mer; rien ne l’éclaire sur sa personnalité. Et, on le comprend aisément, il ne jette aucune lumière sur cette obscurité, lors des conversations que leur procure leur brève relation intime; il ne lui parle même pas de ses navigations en mer, mais seulement de la mer elle-même et de ses vagues, du calme de la mer et du danger de la tempête, des nuits claires et du soleil de midi, dehors sur les récifs solitaires, où les phoques et les dauphins somnolent paresseusement. Il lui parle de ce qu’ils connaissent et aiment tous les deux: la réalité et l’expérience qu’il tira au milieu du ressac, et elle depuis le rivage lui parle de ce qu’elle apprend de la nostalgie et du symbole. Toute sa physionomie personnelle disparaît peu à peu derrière ces descriptions, si complètement qu’Ellida en use comme si lui et elle-même aussi étaient liés et apparentés à toutes les créatures marines.
Et de même que sa façon de parler étaie sa conception imaginaire de l’homme, il en va de même de sa façon d’agir; il agit avec détermination et force, comme au moment de l’assassinat du capitaine ou des épousailles aventureuses avec la mer – à la fois silencieusement, familièrement et brusquement; on pense aux mouvements rapides et silencieux des poissons sous la surface de l’eau, qu’on ne peut suivre que très imparfaitement; quant à ses actes également, rien ne trahit les mobiles qui le guident, cela reste incompréhensible et impénétrable. Ce sont des traits qui caractérisent aussi nettement son allure d’aventurier qu’ils s’accordent étrangement à la vie spirituelle morbide d’Ellida.
La violence qu’il exerce sur elle croît avec l’horreur qu’il lui inspire. Lorsqu’il s’unit à elle pour toujours par ces épousailles marines, comme par un acte magique, et fuit ensuite le lieu du meurtre qu’il a commis, qu’il replonge pour ainsi dire dans les flots dont il est sorti – alors Ellida pousse presque un soupir de soulagement. Elle se décide à revenir par écrit sur ses engagements. Mais lui ne prête nullement attention à ce geste: il la, considère avant et après comme sa propriété. Toute sa révocation et libération reste un acte aussi vain que si un enfant était un caillou dans la mer, pour retenir le flot qui s’approche, pour le dérober. Il est la proie qui s’est trouvée une fois saisie par cet emportement durable et captivant de la passion, qui sans autre façon s’empare de ce qu’elle convoite, et lui donne aussi peu en retour que la mer.
Quelque chose de ce sang tumultueux mais froid de la mer semble caractériser sa fidélité, un attachement par simple nécessité naturelle, sans le moindre engagement envers les mouvements de l’âme de l’autre. Cette froideur, malgré la fidélité longuement préservée, explique également la manière étrange dont à la fin de la pièce il renonce à Ellida. Dès qu’il comprend clairement qu’une force plus grande la lui a retirée, il ne profère ni plaintes ni menaces: « Vivez bien, madame Wangel! À partir de maintenant, vous n’êtes plus rien d’autre dans ma vie qu’un naufrage surmonté. »
Pour une proie définitivement arrachée à la mer, aucune tempête ne se lève, ses flots continuent de rouler paisiblement. Mais lorsque l’homme que la perte d’Ellida jette visiblement dans une telle inquiétude, est menacé par Wangel de la perte de sa liberté, de prison et de châtiment, par une brusque décision, il attrape immédiatement le revolver pour se suicider.
À nulle autre occasion, il n’agit aussi froidement et calmement, mais jamais en meme temps la lueur fantastique ne scintille aussi brillamment, qu’au moment de cette toute dernière entrée en scène. Son renoncement soudain à Ellida fait penser au brusque reflux d’une force mauvaise, d’un spectre fantomatique, face à une formule magique proférée contre lui. Ses paroles accentuent encore le trait: « je le vois bien: voilà quelque chose qui dépasse ma volonté. »
Cette impression s’accorde merveilleusement à l’ambiance générale qui entoure la scène du dénouement, semblable au minuit estival, où elle se déroule: ce n’est ni l’éclat de la lune ni celui des étoiles qui flotte magiquement là-dessus, mais le banal éclat du soleil – c’est un crépuscule au milieu de la nuit qui seul contribue à tout ramener à une clarté étrange, douteuse et féerique. De la vie de l’âme, tendue à l’extrême, de tout un chacun, les paroles et les actes jaillissent comme des formules magiques et sont ressentis avec une puissance magique. En chacun, à vrai dire, ils découlent d’un long et nécessaire développement, qui les prédispose calmement et progressivement, jusqu’au bout, tout le symbolique et le fantastique tire son aliment exclusivement de l’enchaînement rigoureux des paramètres et des problèmes psychologiques – loin de les atténuer, de vouloir les remplacer, ou simplement de les contrecarrer. Cela ne vaut pas moins pour Ellida elle-même que cela ne valait pour l’idée qu’elle se faisait de l’étranger – pas moins pour sa soudaine métamorphose à elle que pour son soudain renoncement à lui. Car dans la mesure où l’étranger symbolise uniquement pour Ellida son seul appétit de vie, encore incompris, il lui faut seulement la pleine maturité, enfin atteinte, de sa volonté pour briser son emprise et le laisser retomber dans le néant. Or cette même circonstance exige que jusqu’à l’instant décisif lui soit accordé un pouvoir sur elle, qui même de loin se révèle efficace. Car comme, en l’occurrence, sa personnalité est moins déterminante que sa portée symbolique et son rattachement à l’évolution spirituelle d’Ellida, de même il n’existe pour ainsi dire entre eux aucune séparation spatiale, aucune distance – à toute heure, l’étranger peut fondre sur elle avec sa violence démoniaque. Non certes parce qu’il négligea jadis le fait qu’elle retira sa parole et se détacha de lui, mais seulement parce qu’elle était encore incapable autrefois de se détacher de lui intérieurement et d’opposer sa volonté à la sienne propre, majeure et pleinement mûrie.
L’évolution d’Ellida se trouve ainsi revêtir la forme d’un conflit amoureux, qui pourrait s’intituler: « Le retour de l’étranger » ou « La vengeance de l’étranger ». Cela ne rappelle-t-il pas combien aussi l’expression correspondante « La vengeance » ou « le retour de Beate » se rapprochait de « Rosmersholm ». Ne s’agit-il pas, dans les deux cas, d’un surgissement fantomatique de la vigueur hors des flots, par-delà la séparation et la mort? Ce qui est réellement en jeu dans ce passage, ce sont les nombreuses et subtiles corrélations d’une pièce à l’autre. D’une manière hautement caractéristique, il a juste été procédé à un échange de personnes. En l’occurrence, ce n’est pas l’ombre de Beate, l’esprit d’amour désespéré et de sacrifice qui agit par vengeance après avoir dû céder à la force brutale – mais la violence élémentaire elle-même, qui chasse sa proie et, tel un fantôme, tend la main pour empêcher qu’elle ne se dérobe de sa propre force, librement conquise. Pour cette raison aussi, le dénouement sera différent: Beate réussit à entraîner avec elle dans la mort la brutalité triomphante, car, malgré sa faiblesse sans défense, elle lui est supérieure par la transfiguration spirituelle et la sublimation de son être – voilà les fantômes vengeurs qui affaiblissent et anéantissent Rébecca. Face à cela, l’étranger doit céder devant le mot d’ordre de la transfiguration complète d’Ellida, parce qu’avec sa force naturelle brute, il n’a pu agir que sur l’incertaine pulsion de vie d’une volonté encore immature.
La diversité de ces solutions tient à ce que l’être de Rebecca évoque l’étranger, et qu’un trait de Beate conduit à Ellida: la délicatesse de l’âme, qui contient en elle tous les germes d’une spiritualisation approfondie. Ce seul trait, à vrai dire – car Beate s’enracine par là dans le socle de la tradition -, se sent exclusivement chez lui dans l’étroitesse du monde de la mansarde. Or Ellida appartient à la vaste patrie de la liberté, et, par là seulement, elle peut aspirer à un meilleur épanouissement. C’est pourquoi, ce sont également des raisons opposées qui aux deux apportent la souffrance et la maladie: Beate meurt du fait que par la force sauvage de Rébecca son être limité se trouve ruiné et la vie spirituelle d’Ellida troublée, aussitôt qu’elle est enfermée dans le confinement d’un monde trop étroit.
C’est donc son mariage qui préfigure le combat intérieur et ramène pour elle l’étranger. Elle pensait lui échapper définitivement, du fait justement que dans sa solitude elle s’agrippa à la main du docteur Wangel et, qu’en tant que son épouse, elle le suivit dans la vie de famille. Or c’est le contraire qui se produisit. Plus elle soustrayait effectivement l’isolement de cette vie au passé, plus ce dernier avait d’attrait pour son imagination. Les circonstances où elle doit maintenant se sentir chez elle éveillent en elle mélancolie et angoisse, comme la nature qui l’entoure ici: partout des rochers élevés et des montagnes – et partout de solides barrières et frontières immobiles. De même que l’eau de la mer ne s’infiltre que paresseusement dans les fjords, sans sa fraîcheur écumante, sans l’alternance de sa puissante marée montante et descendante, de même elle aussi aspire à une plus grande amplitude de vie, au rivage solitaire, devant lequel s’étendent les lointains inconnus, où s’était tenu l’étranger, et où elle s’était unie à lui pour toujours. Si elle accueillit autrefois, par un effroi spontané, l’emprise démoniaque de l’étranger comme une terrible contrainte, elle ne pense plus désormais qu’à la liberté débridée à laquelle il voulut l’arracher. Si autrefois il en alla pour elle comme si un magicien étranger la séduisait contre sa volonté – pour ainsi dire aveugle et les bras largement étendus – à se jeter dans la mer, désormais c’est comme s’il avait voulu en ouvrir toutes les profondeurs et les splendeurs. L’inconnu de la vie, dont elle se voit exclue à jamais, s’étend derrière elle incompris et attirant, comme la mer elle-même, dont le bruissement et le murmure enveloppent toutes ses pensées et ses rêves. Cela la rend sourde à toutes les voix de la réalité autour d’elle, et, d’une manière encore maladivement unilatérale, l’imagination et l’attente passive augmentent en elle.
Et ce changement de son état d’esprit ne peut se réaliser du fait que Wangel, comme à une enfant gâtée, lui passe affectueusement tous ses états d’âme et ses humeurs. Par la manière différente dont lui, aussi bien que l’étranger, la traite comme une enfant privée d’autonomie et de maturité, elle n’en ressent que deux fois plus intensément le contraste entre 1époux et l’amant, car l’un contrôlait sa volonté inexercée en lui imposant la sienne – tout en l’attirant irrésistiblement au dehors, sous l’emprise démoniaque de son autorité, sur la haute mer, dans l’infini bouillonnant de la vie. L’autre, au contraire, l’entoure de sollicitude et d’indulgence, écarte tout ce qui pourrait fortement l’influencer, lui retire toute tâche, tout devoir et toute responsabilité – tout en l’enchaînant ainsi à l’étroitesse étouffante de son existence, où tout mouvement véritablement libre se révèle impossible. Il ne l’en condamne que doublement à l’intranquillité stérile de l’homme libre en captivité et ainsi, sans le vouloir, porte une responsabilité partagée dans la façon dont elle s’éloigne de lui. Car à l’origine, son cœur se tourne vers lui, même l’étranger lui revient: « je l’avais oublié », reconnaît-il. Ce qui le ramène de nouveau ne tient nullement au changement de son inclination à elle, dit-elle cependant à Wangel lors de la même conversation: « je n’aime personne d’autre que toi. »
Or, par-delà toute inclination, c’est la pression et l’aspiration d’une nature que personne n’éclaire sur la vie, et à laquelle personne n’y assigne sa place et sa mission. Wangel n’aurait pu qu’apaiser son aspiration à l’inconnu, s’il lui avait véritablement fait connaître le petit échantillon de vie, le champ d’action plus étroit, et lui avait ouvert l’esprit sur tout ce qu’il y a là à aimer, à créer. Ellida elle-même est instinctivement passée à côté, car plus tard elle reproche à Wangel de ne pas l’avoir préparée plus fermement à ce qu’était son monde à lui: «Je suis tellement sans racines dans ta maison, Wangel. Les enfants ne m’appartiennent plus. Leur cœur ne m’appartient pas, veux-je dire. veux-je dire. Lorsque je suis en voyage, je n’ai aucune clé à remettre, aucune instruction à transmettre, ni sur ceci ni sur cela. J’étais tellement en dehors de tout cela depuis le tout début. »
Et de même que les êtres qui l’entourent ne peuvent ébranler sa passivité, de même elle n’éprouve aucune jalousie envers la morte qui, en tant qu’épouse de Wangel, lui resta fidèle, à elle et aux enfants. Dès la première scène, au moment de l’entrée d’Ellida, nous assistons aux préparatifs d’une cérémonie secrète, destinée à la mère défunte, des offrandes de fleurs faites à sa mémoire. Ellida, sincère et affable, comme elle l’est en toutes circonstances, reconnaît d’autant plus son droit à ces souvenirs chéris qu’elle aussi vit en quelque sorte dans le passé. Un parallèle s’établit automatiquement entre cette petite scène des fleurs et l’opulente décoration fleurie que Rébecca introduit dans toutes les pièces de Rosmersholm, afin que, sous l’effet de leur doux parfum, Rosmer apprenne à oublier la morte qui ne supportait pas les joies et les fleurs. Comme l’attitude d’Ellida s’affranchit délicatement de cet égoïsme passionné, lorsqu’au grand bouquet de fleurs des enfants elle ajoute affectueusement le sien propre: « Ne devrais-je pas aussi y être pour – fêter l’anniversaire de maman? » Le caractère plus passif et plus doux qui s’exprime dans la bonhomie comme dans l’indifférence alimente précisément la contradiction apparente selon laquelle Ellida, qui est la plus influençable, se soustrait bien plus longtemps à l’influence de son entourage que Rébecca. De toute la force de sa volonté, Rébecca se rend maîtresse, dès le départ, de tous les êtres et objets de Rosmersholm, du vivant comme du mort; elle le fait avec une énergie si funeste qu’à la fin elle ne peut plus s’en détacher, qu’ensuite elle ne peut plus soustraire sa volonté à cette sphère de vie. La contagion par la manière d’être et de penser de Rosmershohn est à ce point totale, parce que l’agent de contagion se transmet en un seul contact fort et intime.
Le fait qu’à leur contact réciproque Ellida et Wangel ne perdent pas leur identité propre dans les mêmes proportions permet ensuite à leur relation de s’épanouir bien plus sainement; cela a finalement pour effet que l’alliance intime d’Ellida avec Wangel évolue en un comportement volontaire et autonome, en un acte de la plus haute et consciente liberté – au lieu du dessaisissement de Rébecca par elle-même, qui ne put s’unir à l’aimé que dans la mort. Au lieu de l’énergie brute et de la fragilité maladive, qui en Rébecca et en Rosmer sont si funestement entrelacées, chez Wangel comme chez Ellida prédomine une délicatesse, qui cherche à faire une place aux besoins d’autrui en fonction de sa propre intelligence. Au lieu d’un attrait irrésistible pour la contradiction, s’exerce peu à peu – fort lentement, mais par-delà tout malentendu et toute aliénation – une discrète et efficace contagion, du fait de cette parenté secrète des âmes. Cela est mystérieusement perceptible dès le départ en Ellida, dans la mesure où elle recherche sans cesse la compagnie de son époux. Le premier mot que nous entendons sur ses lèvres ne se rapporte pas à la nostalgie de la mer et du lointain – mais, d’une manière particulièrement insistante, au retour de Wangel, comme si elle ne pouvait supporter son absence une seule heure: « C’est toi, Wangel? Dieu soit loué, je te revois! » Son inclination passionnée pour l’étranger la pousse vers Wangel; elle se love fortement dans ses bras: « Ah, mon bien-aimé, mon cher – sauve-moi de cet homme! » Elle a le sentiment qu’elle trouvera protection auprès de lui, « la paix et le salut, si je pouvais m’attacher à toi étroitement – et tenter de braver toutes les forces séduisantes et effrayantes. » Mais elle ajoute encore: « Cela non plus, je ne le peux pas. Non, non -je ne le peux pas! » Envers l’inconnu, elle ressent le besoin d’aimer – mais le désir d’aimer est réservé à l’époux. La faiblesse de sa volonté, qui n’a pas encore conquis son autonomie, la lie à l’inconnu, mais ce qui la lie à son époux, c’est le pressentiment intime de sa nature que c’est lui qui l’amènera à elle-même: « Aide-moi! Sauve-moi, Wangel! »
Et toute la figure de Wangel est tracée de manière à pouvoir être saisie dans tous ses traits à partir de son lien avec Ellida. À l’instar des autres protagonistes de la pièce, son profil spirituel revêt deux formes: l’une qui paraît regarder en arrière vers Rosmersholm, et une autre, dont le regard est orienté vers l’avant, vers une nouvelle vie plus heureuse. De même que par un certain trait fondamental de sa nature Ellida fait penser à Beate, Rebecca à l’étranger, de même Wangel rappelle Rosmer et le surpasse à la fois.
Tout comme dans l’existence de Rosmer, dans la sienne aussi la piété joue un rôle bien trop grand. Lui non plus ne parvient pas à se détacher d’une morte, bien qu’il lui ait trouvé quelqu’un pour lui succéder – en fait, il n’a même pas la force d’interdire aux enfants leurs cachotteries, qui découlent apparemment de la vénération envers leur première mère. Et de même que Rosmer se trouve enchaîné et influencé, dans son existence et son action extérieures, par la piété envers tout ce qui est mort, tradition et coutume, de même Wangel est fortement attaché à l’usage et ne sait pas se libérer pour une forme de vie énergique et autonome. « Ce n’est pas un trait convenant à un papa! », lance Bolette à son sujet, et lui de lui-même. La piété provoque donc encore en lui un affaiblissement de la volonté. Étant donné les terribles circonstances qui requièrent une force redoublée, il se montre fréquemment incapable de se ressaisir. Lorsqu’il s’attache Ellida, cela est l’effet moins d’un nouvel appétit de vie et d’un nouvel amour que parce que, pour lui plaire, il espère échapper aux souffrances et à la solitude de l’ancien amour; et lorsque son mariage avec Ellida se défait, il noie occasionnellement son chagrin dans la boisson.
Or, même ces traits le différencient notablement de Rosmer. Surtout, il n’est spirituellement prisonnier ni de son origine ni de sa propre faiblesse, mais il les reconnaît de mauvaise grâce; son discernement lui trace donc très consciemment le chemin vers des voies plus libres. Il n’est pas, comme Rosmer, soumis impuissamment à l’influence de l’aimée; il se sent responsable de la tâche de veiller sur elle, et s’adresse le reproche de l’avoir fait uniquement par gâterie déraisonnable et égoïste: « J’aurais dû être pour elle comme un père – et en même temps comme un mentor! J’aurais dû faire de mon mieux, pour développer et éclairer sa vie intellectuelle. »
Et sa piété envers l’épouse défunte n’est pas fondée, comme dans le cas de Rosmer, sur l’obligation impérieuse de traverser la vie avec « un cadavre sur le dos » – non, elle est un reste de profondeur du sentiment, une loyauté ardemment préservée, destinée à garantir aussi comme authentique la permanence de ses dispositions envers la vivante. C’est cette loyauté qu’il témoigne également plus tard à Ellida, dans des proportions si rares, avec une abnégation si persévérante. Et cela montre déjà en quoi, d’une part, il semble le plus proche de Rosmer, en quoi, d’autre part, il lui semble surtout supérieur, à savoir le désintéressement de sa nature. En lui aussi, c’est là le trait dominant, mais il dérive d’une autre source; ce n’est pas, comme en Rosmer, une faiblesse, l’absence d’un moi propre, l’incapacité d’en développer ou d’en conserver un, ce n’est pas un engloutissement passif dans les autres. En lui, c’est une force – la force de l’amour, de se couler dans la sensibilité des autres, de leur venir en aide; il s’agit de compréhension et d’intelligence. Ce n’est que parce que sa capacité d’aimer s’enracine dans une telle force positive qu’elle reste véritablement désintéressée, tandis qu’en Rosmer le désintéressement apparent de la faiblesse de la volonté, au moment décisif, se retourne en un accès d’égoïsme, si bien qu’il cause la mort de Rebecca, afin de se ressaisir dans sa propre vie et sa propre action. Wangel agit à cet effet d’une manière violemment contradictoire, lorsqu’à la fin de la pièce il congédie Ellida. Tout son espoir et son désir reculent toujours davantage devant le profond besoin de secourir et de guérir.
La différence entre eux trouve un reflet fort subtil dans leur profession. Rosmer est un prédicateur, c’est-à-dire un représentant de la tradition, à laquelle se conforme sa volonté, et dont il ne peut plus se libérer sans se perdre lui-même et sombrer dans un dilemme intérieur. Wangel, en revanche, est médecin; il doit manifester de la compréhension, de l’indulgence pour tout; il doit pouvoir accompagner le malade dans toutes ses souffrances, mais, pour accomplir sa mission, il doit éviter de se laisser contaminer par elles, de leur succomber. Il doit aspirer du moins à une santé inébranlable et savoir reconnaître ce qui en cela lui manque encore.
Or il est caractéristique qu’une maladie soit nécessaire à l’éveil de la noblesse et de la grandeur de sa nature – si bien que, sans une telle sommation à son devoir de guérir et de secourir, il succombe à l’influence de la vie quotidienne et du monde de la mansarde. Même pour Ellida, il n’éprouve d’abord qu’une inclination superficielle, et ce n’est que lorsqu’elle tombe malade qu’il devient un médecin de l’âme, plein d’abnégation et de compréhension; c’est seulement lorsqu’elle souffre que son amour à lui atteint une profondeur désintéressée et une abnégation joyeuse. On pourrait dire: ce n’est qu’à travers ses délires que tout son être lui devient véritablement transparent, qu’il gagne une attention au véritable son, douloureusement passionné, de sa voix. Guider et aimer correctement la malade dès le début, lui montrer le chemin, par lequel elle aurait pu échapper aux dangers de son évolution – de cela il ne fut pas capable. Pour y parvenir, il n’aurait pas seulement dû être pour elle le médecin loyal, mais déjà auparavant un mentor et, dans l’acception la plus noble du terme, un guide spirituel, qui, nullement prisonnier du respect de la tradition, sait interpréter les mystères de la vie intérieure, et qui bannit toute l’horreur et l’attrait énigmatique de l’incertain, de l’illimité, du fait qu’il apprend à reconnaître dans leur profonde signification les devoirs limités et précis de la véritable vie.
Wangel justement n’est pas encore parvenu lui-même au terme de son évolution; il est encore en quête, encore en devenir, et en attente de parachèvement. Ce qui fonde précisément son grand amour pour Ellida, c’est qu’à travers les hallucinations morbides qui l’éloignent de lui, il perçoit dans son être à elle ce qui lui manque pour réaliser son propre accomplissement. Même si c’est un monde de mansarde dans lequel il vit, la volonté, le désir de liberté est déjà puissant en lui. « C’est un ressac – et aussi une marée montante et descendante – dans ses pensées comme dans ses sentiments », dit-il du type humain dont se rapproche Ellida, exprimant par là ce qui l’attire vers elle d’une façon si irrésistible:
« Tu es apparentée à la mer. Et l’horrible, d’autre part, t’est apparenté. Tu es pour moi l’horreur, Ellida. Ce qui attire, c’est là ce qui est le plus puissant en toi. »
Et l’on comprend aisément que ce besoin réciproque de plénitude a pour effet de muer son attitude envers Ellida en une complète fusion existentielle, une « véritable union », dès qu’il parvient à l’amener à la conscience de soi – à la même honnête connaissance de soi que lui-même possède.
Sur la base de l’apparence et du donné, de la surface de la vie, Wangel accède graduellement à l’intériorité et à la profondeur de cette dernière et, ce faisant, acquiert également la force de la transformer d’une manière neuve et libre. Ellida, restée à distance de tout ce qui limite salutairement et détourne vers l’extérieur, souffre d’une profondeur de l’intériorité qui la rend juste encore capable de vivre sa vie en imagination. Au cours de sa maladie spirituelle, les chimères du sentiment et de la représentation se muent en un renversement positif de l’intérieur et de l’extérieur. Tout son passé gagne dans les visions de son imagination vérité et vie, et à chaque instant fait éclater le présent et la réalité. « Tu penses et tu sens par images, et par représentations visuelles, lui dit Wangel[1].»
Ce qu’elle voit substantiellement dans ses pensées est bien réel, cela existe pour elle; ce qu’elle ne peut se représenter avec exactitude à l’instant, cela est subitement comme perdu pour elle, comme évanoui. Si cela lui arrive avec Wangel, alors elle ne le retrouve et ne se retrouve même plus elle-même comme sa femme, et cela lui est « si effroyablement pénible! »
De même, il suffit que l’étranger surgisse plein de vie devant son regard spirituel, pour qu’elle succombe à sa présence comme à un état de fait, et comprenne l’« horreur ». Il ne lui apparaît pas à la manière d’un aimé prenant vie dans le souvenir – même jusqu’à l’hallucination, parce que la nostalgie a évoqué l’absent en vain; non, c’est précisément la réalité inquiétante de sa présence qui lui est si pénible, et dès qu’elle est en mesure de se représenter distinctement son absence, elle se calme.
Ce n’est pas vraiment son sentiment, son désir, qu’il excite, mais sa volonté, que le fait de penser à lui paralyse et submerge – comme s’il s’abattait sur elle avec l’insaisissable emprise d’un fantôme et l’épousait une nouvelle fois. C’est pourquoi aussi, elle ne le voit devant elle qu’en imagination, en quelque sorte sans que son œil le perçoive, sans qu’elle veuille le voir – il se tient même « quelque peu de biais. Il ne me regarde jamais. Il est juste là. »
Cette manière de regarder, par analogie avec les images vivantes du rêve, est extraordinairement véridique: elle repose sur un certain flou et une absence générale de netteté, joints à la plus grande clarté et précision dans certains détails. L’apparence de l’étranger, par exemple, s’est déjà estompée en fait dans le souvenir d’Ellida, si bien qu’elle ne le reconnaît même pas, lorsqu’il entre dans le jardin de Wangel – en revanche, elle voit toujours encore clairement devant elle, en imagination, la perle blanche et bleue de son épingle, cet « œil mort de poisson », qui pour elle symbolise tout et exprime l’horreur contenue dans sa vision. Dès que le flou général cesse, dès que l’étranger se présente en personne devant Ellida et Wangel, l’effet produit par le fantasme onirique devient plus incertain. Aussi il salue Wangel comme un heureux tournant vers une amélioration, à savoir le fait que l’étranger en personne est de retour.
« Une nouvelle image de la réalité est maintenant venue à ta rencontre. Et cela relègue dans l’ombre l’ancienne – si bien que tu ne peux plus la voir. Et elle relègue aussi dans l’ombre tes visions morbides. Il est donc bon que la réalité soit arrivée. »
Son retour est donc précisément une condition de sa guérison et de son détachement intérieur à son égard. La deuxième condition ensuite est, à vrai dire, le retour de son époux dans son cœur et ses pensées. À la différence de l’étranger, il est présent à ses côtés en personne, mais tenu à distance de sa vie intérieure par l’image symbolique, vue en rêve, de l’inconnu. Elle n’a pas le moindre regard pour le profond attrait de Wangel à son égard, qui le rapproche d’elle par un amour toujours plus puissant, jusqu’à ce que cet amour réussisse finalement à l’arracher brutalement à l’étrange. Elle se tourne, en effet, instinctivement vers son époux, mais seulement comme le malade tout accablé de ses souffrances se tourne vers son médecin, susceptible de lui procurer un soulagement. Elle ne sait pas encore que son unique pouvoir de guérison réside dans son amour. Elle sait juste que son amour devait traverser, consolider et mûrir, une évolution, juste qu’il n’est pas, comme elle, un individu achevé, mais en devenir, qui se rapproche d’elle pas à pas – cela lui pèse, à elle, de le comprendre. Car dans son imagination se gravent seulement des instantanés uniques et déterminants, qui ensuite évoluent intérieurement d’une manière toujours plus funeste et âpre, reçoivent un éclairage toujours plus fantasmatique – pour prêter attention discrètement à un lent épanouissement, elle est bien trop maladivement engourdie.
Aussi sa conduite envers Wangel reste toujours seulement telle qu’elle avait été initialement, amorcée par des fiançailles couronnant une brève période de familiarisation et par une inclination que favorisèrent des deux côtés des paramètres qui n’avaient rien à voir avec l’amour. Elle se souvient seulement qu’elle s’est toujours sentie seule et incomprise dans la maison de Wangel, car elle ne prêta jamais attention aux efforts délicats pour mieux la comprendre, dont témoignent ses paroles: « je commence à te comprendre – peu à peu. C’est là le fruit des années et de la vie à deux. »
Parce que le regard lui fit entièrement défaut pour voir ce qui se passe autour d’elle, elle croit aussi ne pouvoir nullement exiger de Wangel un grand sacrifice lorsqu’elle le supplie enfin de lui rendre sa liberté, d’« annuler le marché » d’autrefois. Et Wangel, dans sa bonté désintéressée, se dit que, d’une certaine façon, il lui doit ce sacrifice – quand bien même elle ne serait pas en mesure de l’honorer dans toute sa grandeur. Car il échoua à se prémunir contre les changements d’humeur d’Ellida, à lui garantir à temps le socle d’une vie saine et libre, sur lequel elle aurait pu prendre racine et se greffer sur son univers. Or, tandis qu’intérieurement elle se détache de lui toujours plus énergiquement, il ne veut pas se sentir responsable de ce que dans l’élan vers la liberté rêvée elle dépérit lentement. Il sait que sa passion pour l’inconnu n’est rien d’autre qu’une aspiration à la liberté.
« Ton désir et ton besoin de mer – ton attrait pour lui – cet étranger, lui dit-il plus tard, ce fut là en toi l’expression d’une exigence naissante et croissante de liberté. Rien d’autre. »
Or ce n’est que parce qu’elle se croit totalement incomprise de lui, totalement étrangère en son for intérieur, qu’elle ressent son mariage comme une servitude, une captivité. Car seuls la compréhension et l’amour fondent la différence entre un lien, qui unit étroitement deux êtres, et une entrave, qui les soude l’un à l’autre. Or en un seul instant, le lien peut devenir une entrave, ou l’entrave une alliance volontaire.
Ellida découvre cela en s’étonnant d’elle-même, lorsqu’elle voit que Wangel lui rend sa liberté uniquement par amour, lui laisse la liberté de suivre l’étranger. Doucement et en tremblant, cela prend forme sur ses lèvres: « je te serais devenue si proche – si intimement proche! »
Comme Wangel lutte pour lui rendre sa liberté, et la place devant le choix personnel de la préserver de la folie, il est en fait persuadé de la perdre. Son sacrifice est sincère. Mais sans le vouloir, il arrache de ses yeux les bandeaux de ses délires. À partir du moment où elle mesure dans cet acte la grandeur et la force de son amour, elle n’est plus non plus pour lui une étrangère. À partir de cet instant précis, elle doit se sentir proche de lui et entourée d’une patrie, au lieu de la prison jusqu’ici. Mais comme elle n’était même pas prisonnière, le désir de se libérer ne peut tenir plus longtemps. La liberté cesse de l’attirer, parce qu’elle n’attire plus depuis le lointain; Ellida se trouve en liberté.
Il est aisé de mésinterpréter ses paroles: « J’eus la possibilité d’y jeter un œil – d’y entrer – si seulement je l’avais moi-même voulu. J’aurais pu en faire le choix maintenant. C’est pourquoi, je pouvais aussi bien me résigner. »
Ces paroles n’entendent pas faire d’une humeur enjouée le socle de sa transformation. Elles signifient seulement: je n’ai plus besoin de la liberté, parce que j’ai reconnu que je suis libre. Or elle n’entend plus par là le libre choix, que Wangel lui a concédé. Car lorsque, la veille, elle le conquiert pour elle-même, avec l’idée que sa perte ne lui coûtait pas trop, alors elle pensait encore suivre l’étranger. Or maintenant, elle n’emploie même pas la liberté qui lui fut concédée en vue d’un choix, mais elle reconnaît qu’elle n’a plus du tout le choix, parce que son congédiement fut un acte d’amour. Avec la même énergie transformante, par laquelle l’idée de ses fiançailles avec Wangel a agi sur elle, son renoncement désormais ne produit plus aucun effet sur elle – comme une révélation: elle voit qu’il s’inflige volontairement et héroïquement la plaie la plus profonde par le désir tout-puissant de lui apporter la guérison, de guérir ses plaies. Comme au sortir de rêves angoissants, elle voit alors pour la première fois son époux tel qu’il est en réalité. Et après une longue séparation, il célèbre par là son retour dans son cœur, tandis que l’étranger se trouve précisément éloigné de son cœur par la réalité qui en elle modifie son image à lui.
Toutefois, l’acte d’amour par lequel Ellida accède à la prise de conscience de sa liberté auprès de Wangel ne livre pas encore toute l’explication de sa guérison et de son rétablissement – seulement la condition d’un heureux déroulement de la crise, qui favorise un regain de santé. Certes, la folie engendrée par sa captivité l’abandonna, mais la véritable cause qui la suscita n’est pas éradiquée. Car elle ne venait pas de la véritable captivité d’Ellida, mais exclusivement du déchaînement maladivement accru de sa vie imaginaire, que la liberté ne pouvait que trouver dans l’absence de limites et de certitudes. La cause se trouvait dans le regard lointain, hypnotiquement ensorcelé, vers l’illimité, encore accentué par l’indulgence et la gâterie de Wangel, par l’absence complète d’obligations et de devoirs distrayants. Au fond, Ellida pâtit donc, exactement comme Rebecca, d’un mauvais usage de la liberté, d’un débridement de l’être, qui en elle devait fatalement conduire aussi la vie imaginaire à la folie, à la dégénérescence mentale, qu’en Rebecca ils conduisirent la vie des instincts à des actes destructeurs, à l’avachissement de la volonté. Une petite scène qui se produisit la veille montre clairement la façon dont Ellida elle-même prend conscience progressivement que sa plus grande souffrance tenait à un isolement dans lequel elle s’était perdue par ses pensées et ses rêveries stériles. Lorsqu’elle est surprise par un fougueux témoignage d’amour de sa plus jeune belle-fille Hilde, et que la sœur de cette dernière, Bolette, lui adresse le reproche de ne jamais lui avoir manifesté affection et compréhension pour cet amour timide et secret, elle se montre alors stupéfaite et demande dubitativement- « Oh! Y aurait-il encore là pour moi une tâche à accomplir? »
De la réponse à cette question, elle pressent une délivrance pour elle-même; le cours morbide de ses pensées se trouve soudain entravé et traversé par une toute nouvelle vision des choses. Elle devine que la pulsion démoniaque, qui attire vers l’incertain et l’illimité, pourrait se révéler impuissante pour une volonté qui se tient fermement à l’intérieur des limites qu’elle s’est imposées à elle-même, dans les frontières naturelles de son action et de son amour. Car sa patrie se trouve seulement là où se déploie sa capacité d’action, où elle s’ouvre et agit en direction de l’extérieur; là seulement se rejoignent à cet effet, en un mouvement volontaire d’autolimitation, la contrainte et la liberté, elles deviennent une, et tiennent à distance de lui l’arbitraire sans but, comme un lointain volontiers évité et inhabité.
Il est tout à fait caractéristique qu’Ellida, immédiatement après le retour auprès de son époux, au milieu de son nouveau bonheur, aspire à une obligation, à un devoir qui met en elle son espoir. Au moment de la plus grande excitation de toutes les énergies de l’âme, elle tourne, elle toujours jusqu’ici si maladivement engourdie en elle-même, ses pensées vers les autres. Lorsque Wangel s’écrie: « Oh, dire que maintenant nous pouvons vivre tous les deux l’un pour l’autre, Ellida! ajoute-t-elle rapidement, et pour nos deux enfants – qui ne m’appartiennent pas – mais que je vais encore conquérir pour moi! »
Elle comprend maintenant que ce n’est pas le caractère illimité de la rêverie et du désir solitaires où elle peut véritablement se sentir chez elle, mais l’étroitesse qui seule offre assez d’espace pour contenir toute la richesse des relations humaines, de la puissance de création et de l’amour humains – cette étroitesse, dont il est dit:
« Un foyer, c’est où il y a de la place pour cinq,
Alors qu’entre ennemis deux seraient à l’étroit.
Un foyer, c’est où ta pensée se déploie en toute liberté
où ta voix frappant à la porte des cœurs
Recueille toujours en retour des accents similaires.[2] »
La deuxième parole salutaire que Wangel adresse à Ellida porte donc en elle l’émancipation de sa volonté – un avertissement non seulement pour sa liberté, mais aussi pour son propre sentiment de responsabilité: « Maintenant tu peux choisir en toute liberté. Et en toute responsabilité, Ellida. »
Elle porte alors la main à son front et regarde devant elle, en direction de Wangel: « En toute liberté et – responsabilité! En toute responsabilité aussi? Là – se trouve un pouvoir de transfiguration! »
Cette aspiration de tout son être à la réalité, à laquelle il désire s’attacher, dont il veut se laisser emplir – cette conversion de son rêve de liberté en une joie créatrice positive, voilà le premier signe de la véritable guérison d’Ellida. Elle se trouve elle-même, et elle trouve sa santé, seulement lorsque sa profonde intériorité gagne une ouverture vers l’extérieur, pour se déployer en capacité d’action. Et là se réalise l’idée fondamentale qui traverse les cinq drames – l’idée que tout attachement, toute limitation et toute obligation avachissent et affaiblissent l’énergie, lorsqu’elles entravent le libre épanouissement – mais que tout appétit de liberté conduit aussi à la langueur et à l’affliction, s’il en reste au stade de la simple négation, sans gagner un nouveau champ d’obligation ni aucun sens spontané de la responsabilité. « Spontanément – et de sa propre responsabilité! », voilà l’idée qu’introduit l’émancipation spontanée d’une Nora et réalise la limitation spontanée d’une Ellida. Ce n’est que parce que nous allons au bout de l’idée avec Ellida que nous saisissons parfaitement ce qui, dans l’évolution de Nora, était encore voué à rester incomplet. Nora ne peut se laisser retenir par le renvoi aux obligations qui lui incombent, parce qu’en vue de cette liberté elle n’a pas encore atteint le degré d’évolution où de telles obligations pourraient devenir l’expression de sa propre volonté, spontanément enchaînée, de s’exprimer. À l’instant où elle nous quitte, elle ne se trouve qu’au début de son évolution, elle ne fait que commencer son ascension vers le sommet, qui s’étend encore devant elle dans un vague crépuscule. Comment devant ses yeux se présenteront de là-haut le monde et la vie, comment alors son petit monde et sa vie personnelle apparaîtront à son jugement mûri – tout cela, elle ne le sait pas encore. Nora conclut ainsi par une question muette, et seule Ellida nous fournit une réponse à la question de savoir pourquoi si l’une pensait devoir éviter patrie et obligations – l’autre, en revanche, se retrouve au foyer à honorer ses obligations.
Nul hasard donc si les figures de ces deux femmes présentent des traits apparentés, même si leurs aspirations paraissent contraires. Si l’on compare Nora et Ellida, il saute aux yeux immédiatement qu’elles sont toutes les deux pour ainsi dire en phase de croissance, autrement dit, qu’elles n’ont pas fini de grandir, n’ont pas encore atteint leur taille naturelle, Nora, parce que dans l’étroitesse et le confinement de son environnement elle ne parvint jamais à une véritable liberté de mouvement, à un comportement autonome – Ellida, parce qu’elle n’a rien trouvé dans l’étendue illimitée de la surface marine qui lui eût permis de se redresser et de mesurer sa propre grandeur. L’une, parce qu’on lui avait fermé artificiellement toute perspective lointaine sur le monde et la vie, avec le jouet d’une maison de poupée, l’autre, parce que sous son regard rêveur le monde et la réalité devaient finalement se fondre dans l’imprécision de lointains illimités et d’un mirage brumeux.
Dans les deux cas, la catastrophe fait irruption dans leur vie en raison de ce manque d’éducation et de maturation, et si l’on examine les situations où elles se trouvent au moment décisif, à la fin des pièces, on remarque alors une similitude dans les conflits mêmes, car, dans les deux cas, il s’agit d’un conflit entre le devoir conjugal et la liberté personnelle. D’un point de vue extérieur, en effet, la situation d’Ellida comporte visiblement une motivation nettement plus déterminante pour la séparation de Nora avec les siens, tandis que les conditions de vie de Nora, en revanche, contiennent un élément susceptible de faciliter à Ellida le retour dans son foyer. Cela vaut pour l’attitude des deux, aussi bien à l’égard de leurs époux que de leurs enfants. La dame de la mer n’a plus d’enfant en propre, et les deux brus seront bientôt trop âgées pour la protection dont elles bénéficient. À l’inverse, la sëparation de Nora d’avec ses petits est rendue possible surtout par la circonstance hasardeuse que son ancienne gouvernante personnelle est de leur côté, et ce hasard heureux ne laisse entrevoir qu’une protection de courte durée, seulement pour les années à venir, aussi longtemps seulement que les soins d’une gouvernante sont requis. La propre éducation négligée de Nora n’éveille-t-elle pas le reproche qu’elle ne fut guidée par aucune mère, mais seulement par une gouvernante? Et ce reproche n’est-il pas appelé à se répéter dans ses enfants? En fait, elle ne veut pas s’émanciper par amour de la liberté; elle veut seulement atteindre sa propre autonomie, pour devenir responsable, pour pouvoir assumer des obligations; elle trouve sacrilège d’être épouse, voire mère, avant d’être devenue un être humain au sens plein du terme, d’avoir des enfants, avant même de s’appartenir elle-même. Or est-il possible de jamais défaire cet outrage? Peut-elle effacer les enfants, des existences naguère créées, comme elle peut effacer l’existence de son mariage? Nora ne répond plus à de telles questions, parce qu’elle ne connaît encore aucune réponse; elle part justement pour en chercher une.
On trouve quelque chose d’équivalent dans sa relation à Helmer, à condition de l’envisager uniquement de l’extérieur. Car le reproche d’Ellida envers Wangel est apparemment plus fondé. Il l’arracha, en effet, aux conditions antérieures de son bonheur, la sépara de sa patrie marine, malgré la conscience que sa transplantation dans les conditions modestes de la campagne lui serait fatalement préjudiciable. Il sent que cette erreur ne peut être réparée que par une pleine évolution spontanée sous sa direction et sa conduite, et, malgré cela, il l’abandonne pendant tout ce temps à elle-même. Helmer, en revanche, accepte Nora telle qu’il la trouve; il s’efforce de remplacer le plus exactement possible pour elle la chambre de jeu de la maison paternelle; de son élan vers la libération et l’élévation intérieures il n’a pas la moindre idée, car le comportement enfantin et puéril de Nora le dissimule complètement à ses yeux. À vrai dire, il reste à son sujet dans le flou, pour la seule raison que tout son amour est égoïste et borné – un amour sans compréhension ni abnégation, mais toujours est-il que cette absence de discernement éclaire sa façon d’agir.
Mais ces difficultés, que rend manifestes une analyse extérieure des deux situations mentionnées, n’en trahissent que plus vivement la façon dont les problèmes spirituels sont fondamentalement abordés et approfondis pour eux-mêmes. La question est toujours: est-il vraiment possible qu’Ellida reste auprès de son époux, la condition principale et essentielle est-elle remplie pour cela – alors les devoirs qu’elle trouve à son arrivée ont beau encore être si peu contraignants, alors il suffit de très peu pour s’étendre à une sphère féconde de l’amour, où elle puisse être active, alors le plus petit détail devient si contraignant et sacré dans cet amour qu’aucune force ne peut plus retirer sa main de la charrue. Et à l’inverse, il manque la seule chose vraiment importante, la « seule chose vitale », car tout le reste ne sert à rien – par-delà toute obligation et tout amour, par-delà mari et enfants, Nora va de l’avant, impitoyablement, sans tourner son regard vers la droite ni vers la gauche, n’ayant en vue que son seul but.
C’est pourquoi, se trouvent écartés tous les motifs secondaires, susceptibles d’atténuer cette puissante motivation unitaire, dans la mesure où ils émanent d’appuis extérieurs. Quel est le seul élément vital devant fonder le « mariage véritable »? C’est la vérité et la liberté. Dans le cas de Nora, cela signifie la liberté de s’épanouir de la condition de poupée à celle d’être humain au sens plein, à travers sa vie en commun avec Helmer. Et pour lui, cela signifierait la nécessité d’authentifier son amour pour elle, de lui reconnaître une vérité au moment de l’épreuve et du danger. Ces deux aspects font réellement leur entrée dans le mariage d’Ellida avec Wangel: elle retourne auprès de lui, parce qu’il lui apporte la preuve qu’avec lui elle n’est pas prisonnière, mais libre – par l’offrande d’un amour véritable, d’un amour qui agit si altruistement et grandiosement que sa vérité l’emporte et convainc immédiatement.
Aussi les attentes de Nora se réalisent dans la vie d’Ellida: grâce à l’action de Wangel, de «miraculeux » le rêve de Nora est devenu réalité.
Ce rêve contenait, dès le départ, le but atteint ici; le début et la fin se rejoignent sans faille. Le pouvoir d’émancipation contenu en lui, qui précipita Nora dans une vie individuelle autonome, en défaisant son foyer et son mariage, s’exprime dans la réalisation de l’aspiration au merveilleux, telle une force unifiante et liante, qui fonde le foyer et le mariage d’EIlida sur de nouvelles bases et s’oppose comme une solide barrière à son besoin d’autonomie et d’indépendance.
Car en Nora l’aspiration à s’épanouir jaillit seulement de la vérité de son amour: elle veut seulement conquérir entièrement son propre moi, pour en faire l’offrande. De la récente plénitude de sa santé intérieure et de sa force de caractèrejaillit la richesse qu’elle souhaite pour elle-même, la liberté qu’elle conquiert pour elle-même, en unjoyeux amour pour l’autre – devient le rêve nostalgique du miracle d’un mariage véritable. En Ellida, c’est seulement l’agitation et la fièvre dévorante d’un état maladif qui la poussent hors du cercle des siens – vers une liberté bien incertaine, inconsis. tante. Les deux conceptions différentes de l’idéal de liberté ne peuvent trouver une expression plus pertinente que dans le nom que les deux lui donnent. Dans l’appellation « le merveilleux », employée par Nora, transparaît une admiration naïve d’enfant, un ciel et une promesse, le terme « horrible » employé par Ellida implique le regard craintif vers un lointain vide, qui à la fois attire et rebute, un chaos et un changement houleux. Ce que Nora porte en elle comme l’idéal positif de toute sa vie morale et sentimentale, cela vit en Ellida seulement sous une forme effrayante et fantomatique, comme le fruit d’une vie de l’imagination survoltée.
Dans la mesure où l’émancipation de Nora représente un idéal, et non seulement un simple caprice personnel, la barrière qu’il lui fallut briser, la chaîne qu’il lui fallut arracher pour cela, apparaît comme une contrainte indigne. Pour cette raison, la valeur de la solide restriction et limitation admise de la libre aspiration augmente dans les mêmes proportions, lorsque le désir de liberté d’Ellida s’exprime sous une forme morbide et injustifiée. Le « monde de la mansarde », avec son ordre et son étroitesse immuables, pouvait encore signifier pour Nora une prison, ou une chambre vide de poupée; pour Ellida, il signifie une éducation pour la vie et un foyer. Rebecca se trouvait déjà inéluctablement reléguée dans le monde qui apprivoise la sauvagerie et anoblit la grossièreté, mais elle n’apprit à le connaître que par opposition à la liberté, que par son influence contagieuse, éreintante. Seule Ellida fait l’expérience du miracle du grand amour, au point que le monde de la mansarde s’étend en largeur et en hauteur, que tombent toutes les cloisons qui barrent l’accès au puissant appel d’air de la liberté dehors et à l’éclat transparent du soleil de la vérité. Seule Ellida se trouve dans un monde qui ne veut plus être que refuge protecteur, abri, un lieu de concorde et de réconciliation.
Lorsque Nora nourrissait son rêve de merveilleux, ses pensées alors tournoyaient encore, si inatteignables, au-dessus de la terre basse et sombre, comme un rêve de célébration resplendissante de Noêl planant au-dessus des sapins enneigés dans la forêt. Or pour Ellida le miracle est devenu vérité et nature, réalité florissante et féconde; tout autour de la mansarde chante et fleurit l’été, il grimpe jusqu’à ses fenêtres, Pousse par-dessus son toit et enrobe ses murs de son vert secret ombrageux. Et le visage d’Ellida est transfiguré par les épousailles de Nora – des épousailles certaines de la réalisation du miracle – de la plénitude miraculeuse de la nature – et l’envisageant avec confiance.
« Ne trouvez-vous pas », demande Hilde à l’omniscient Ballested, « que vous et Papa avez vraiment l’air fiancés? » Et il répond: « C’est la saison estivale, jeune demoiselle! »
L’été de l’amour, qui se cache dans un foyer, autour duquel bruit librement le riche courant de la vie ».
[1] « Ce fait situe encore, d’un point de vue artistique, La Dame de la mer au-dessus des autres drames d’Ibsen, qui, comme ces derniers, ne représentent pour ainsi dire que le dernier acte d’un drame, tirent le bilan d’une longue évolution. La folie d’Ellida exorcise le passé dans une tout autre plénitude existentielle, bien plus irrésisitiblement et immédiatement, en plein sous l’éclat transparent du soleil, que cela ne réussit aux remords de Rebecca ou aux réflexions de madame Alving. Ces dernières ne font que raconter, mais Ellida insuffle pour ainsi dire ses souvenirs à la pièce. » (Note de Lou Andreas-Salomé)
[2] Ibsen, La Comédie de l’amour.
Sylviane Agacinski
Drame des sexes
L'appel de la mer : Ellida
 Extrait de Drame des sexes
Extrait de Drame des sexes
La Librairie du XXI siècle, Seuil, 2008, p55-59
La Dame de la mer (1888) [1] est une pièce à part. C’est la seule œuvre dans laquelle Ibsen ose traiter directement de la folie du désir, même si c’est pour mieux en programmer la guérison. Je ne peux m’empêcher d’y voir le pendant de Brand, comme si, à la démesure de la spiritualité et au conflit du ciel et de la terre, répondaient ici la démesure du désir sauvage et un conflit de la mer et de la terre. Cette fois, pourtant, la raison l’emportera sur le désir impossible. Mais l’appel de la mer, aussi intraitable que l’était celui du ciel pour Brand, vient ici de la nature et non de l’Au-Delà, et il donne à cette pièce une dimension poétique païenne et non chrétienne.
Ellida, la « Dame de la mer», est la proie d’une «vertigineuse nostalgie[2]» de la mer, nostalgie associée à la passion qui la lia jadis à un marin étranger. Ce lien l’enlève à l’amour solide mais prosaïque de son mari, le docteur Wangel, et la plonge dans l’angoisse lorsque le marin revient la chercher.
Ellida éprouve d’autant plus la fascination de l’océan, du grand large, qu’elle se sent à l’étroit dans une vie passive. Alors qu’elle subit avec angoisse l’attraction de la mer et celle du marin, son mari croit d’abord pouvoir la protéger lui-même de l’étranger. Dans un premier temps, il ne songe même pas qu’Ellida puisse décider elle-même de sa vie. Elle est sa femme, elle lui appartient, et c’est à lui de chasser l’étranger qui prétend aimer Ellida et être aimé d’elle : « Ma femme n’a aucun choix à faire, déclare-t-il au marin. C’est à moi de choisir et de la protéger. » Ellida connaît sa condition d’épouse: «Tu peux me retenir – tu en as le pouvoir et les moyens […] mais mon âme, – mes pensées, – mes envies et mes désirs, – ceux-là, tu ne pourras pas les enfermer»[3]. Wangel lui laissera finalement choisir sa voie elle-même. C’est au moment précis où elle peut exercer sa liberté que se produit en elle une métamorphose. Le marin n’est plus un rêve, il n’est plus l’image pure d’un ailleurs, le fantasme de l’illimité et de l’ouvert, mais une possibilité réelle : elle peut partir avec lui si elle le veut. Ce n’est qu’au cinquième acte qu’elle cesse d’être captive de son rêve: «J’ai pu choisir, c’est pourquoi j’ai pu y renoncer. »
Faut-il croire cependant, avec Wangel, que la nostalgie de la mer n’était rien d’autre qu’un «désir naissant de liberté»? Qui pourrait jurer qu’Ellida est définitivement « guérie » de cette fascination, et que cette attraction elle-même était essentiellement morbide ? La liberté de choix est une chose belle et essentielle, mais le mystère de l’océan, sa profondeur, la puissance de son flux et de son reflux, et l’attrait qu’il exerce sur la sensibilité d’Ellida, ne peuvent valoir uniquement comme le symbole d’autre chose. De fait, Wangel connaît la passion de sa femme pour la mer : lorsqu’elle le rejoint, il l’accueille par un « Tiens, voilà, la sirène ! » (acte I).
Comment ne pas reconnaître que la Dame de la mer est fascinée par la chose même: la mer, l’océan lui-même? Le désir que le marin lui a jadis inspiré prenait d’ailleurs sa source dans leur passion commune de la mer, des marées, des oiseaux, des dauphins et des phoques. La mer, où les deux amants du large avaient jeté leurs anneaux réunis pour célébrer leur union, est d’abord une réalité élémentaire. Elle est ce monde mouvant, vivant, immense, d’où toute vie est originaire. Il y a, dans la nostalgie de la mer, la trace d’une profonde mélancolie des hommes arrachés jadis à l’élément liquide pour vivre sur la terre ferme. On peut aussi penser au liquide maternel d’où sort tout être humain, mais la nostalgie de la vie intra-utérine n’exclut pas celle d’un élément beaucoup plus vaste et plus ancien. On sait que la mer avait sur Ibsen lui-même un fort pouvoir d’attraction. L’angoisse d’Ellida peut alors se comprendre comme l’effet d’un déchirement entre un désir de liberté conduisant à être soi, désir d’autodétermination, donc d’autolimitation, d’autonomie, et un désir du large, de l’infini d’un monde marin où s’abolissent les limites terrestres, les fjords étroits et les contraintes sociales. Cette nostalgie a sa puissance et sa vérité propre, en même temps qu’une valeur allégorique.
La nostalgie entre en scène, au tout début de la pièce, à travers une légende : un peintre cherche un modèle pour la sirène « à moitié morte» qu’il veut représenter dans un paysage. Pourquoi « à moitié morte ? » lui demande-t-on : parce qu’elle s’est égarée dans le fjord et n’a pu retrouver le chemin de la mer, alors « elle agonise dans l’eau saumâtre»[4]. Le désespoir mortel de cette sirène ressemble à un sentiment d’exil, mais de nature païenne. Il y a une forme chrétienne du sentiment de l’exil, une nostalgie de l’infini face à tout ce qui est borné et fini. Mais la mélancolie chrétienne, tournée vers le ciel, comme celle de Brand, ou celle, métaphysique, de l’âme exilée dans un corps dans les textes de Platon, rejette l’animalité de l’homme, alors que, avec son corps à demi bestial et marin, la sirène est un être vivant et sensuel. Elle appartient au monde de la nature et de cet océan, en lequel Michelet voyait « la grande femelle du globe[5]».
La nostalgie de la mer s’associe à l’attraction sexuelle d’EIlida pour le marin, comme si son goût pour l’océan (elle adore s’y baigner) et son désir de l’étranger révélaient un même désir de se perdre. Ou plutôt, la perte a déjà eu lieu – Ellida se sent appartenir à la mer comme à l’étranger, l’une et l’autre exerçant sur elle la même attraction : « Cet homme est comme la mer. » Il s’agit donc de l’amour, du désir tel qu’il a de tout temps été vécu et décrit : captation, exil, aliénation. Ellida est emportée ailleurs par son désir, au large, elle ne s’appartient plus, elle est à un autre, et pourtant elle demande à son mari de la sauver de cet amour sauvage qui menace son individualité.
La puissance du désir sexuel est toujours féminine chez Ibsen. Lorsque Rebecca West, dans Rosmersholm, avoue à Rosmer qu’elle avait éprouvé pour lui un violent désir, c’est l’image de la mer qui s’impose à elle : « Cela s’est abattu sur moi comme une tempête sur la mer. Une de ces tempêtes que nous connaissons en hiver, là-haut, dans le nord. Ça se jette sur vous et vous emporte, tu comprends, – vous emporte jusqu’au bout du monde. Rien ne sert d’y résister[6]. »
Ellida est prise elle aussi dans la tempête d’un désir auquel elle ne peut s’opposer (alors que sa volonté la porte vers la terre ferme et vers son mari), un désir dont la nature sexuelle se laisse facilement percevoir puisqu’elle avoue à Wangel être « face à l’effroyable», c’est-à-dire à «ce qui fait peur et qui attire, qui attire surtout»[7].
Cette inquiétante fascination erotique est présentée comme une maladie, et le docteur Wangel se montrera « un bon médecin ».
Ce qui est redoutable, dans la force de l’attraction sexuelle, dans l’hypnose où elle plonge, c’est la menace qu’elle fait peser sur le sujet, sur la maîtrise et la disposition de soi. Dans sa forme passionnelle, le désir est l’expérience d’un transport hors de soi. Il se situe à l’opposé absolu de la liberté de choix, de la liberté de décision. Le drame de la Dame de la mer est là, dans le conflit entre le désir de liberté de qui aspire à être soi-même, et la liberté du désir, qui, à l’opposé, est le mouvement vertigineux de qui ne s’appartient plus. Cette liberté du désir qui tourne le sujet ailleurs, vers l’autre, vers le mystère et l’étranger, prend la forme d’une nécessité qui emporte tout. Elle a la force impersonnelle d’un instinct ou d’un destin. Le désir sexuel est source d’angoisse dans la mesure où son flot compromet la stabilité du sujet volontaire et construit.
Brand allait jusqu’au bout de sa logique, jusqu’à sa chute. Ellida cède aux lois d’une vie plus sage – comme si Ibsen faisait reculer son personnage devant la puissance de l’attrait erotique où il risque de s’abîmer.
Monique Borie
Le Fantôme ou le théâtre qui doute
Ibsen ou les multiples visages des revenants

Scène des Revenants. Edvard Munch, 1906
L’Étranger comme avatar du fantôme
Extrait de Le Fantôme ou le théâtre qui doute, de Monique Borie. Actes Sud, 1997, p 179-190.
L’impossible clôture d’un espace humain toujours menacé par les puissances d’un dehors, véritable espace d’une altérité menaçante, constitue aussi, dans cette fin du XIXè siècle, l’un des pivots de la dramaturgie ibsénienne. L’intrus, l’étranger, là non plus n’est pas davantage que chez Maeterlinck un fantôme, au sens d’un mort qui revient pour dialoguer avec les vivants. Toutefois, il n’en incarne pas moins la menace d’étranges puissances – ces puissances qui font retour, venues d’un ailleurs du temps et de l’espace, dont les territoires s’apparentent à ceux de la mort. S’agissant d’Ibsen, l’on pourrait reprendre l’idée du « troisième personnage », avec cette différence qu’il a le plus souvent, chez Ibsen, le visage du passé. Depuis Les Piliers de la société jusqu’à Quand nous nous réveillerons d’entre les morts, toutes sortes de « revenants », vrais-faux fantômes, feront à leur manière de la maison humaine un espace qu’un troisième personnage peut toujours venir hanter.
Dans Les Piliers de la société, à Mlle Bernick rêvant de fuir « loin de tout cela sur l’océan sauvage », Rôrlund répond par l’affirmation de la nécessité de « fermer sa porte à un visiteur aussi dangereux ». Il est mieux d’être ici « tournant le dos à tout ce qui pourrait nous perturber ». La présence menaçante, inquiétante et fascinante à la fois, de ce dehors qui perturbe, de cette altérité d’un espace sauvage d’où peut venir le « visiteur dangereux » est une des clés de l’univers d’Ibsen. Tel le fantôme qui revient de la mort, l’étranger, le marin revenu du voyage en mer incarnent cette figure du passé que l’on croyait mort et qui resurgit. Ainsi, dans cette même pièce, Les Piliers de la société, le retour d’Amérique, retour par mer de celui qui ne parvient pas à disparaître une fois pour toutes, associe le thème de l’étranger, de l’océan et du passé qui revient. De façon analogue dans La Dame de la mer, l’Etranger qui apparaît, celui que l’on croyait noyé et qui selon Lyngstrand « doit être revenu pour se venger de sa femme infidèle », est bien un équivalent dramatique du fantôme vengeur. Cet Etranger qu’Ellida reconnaît à ses yeux lorsqu’il fait irruption dans la réalité, a été précédé de son fantôme dont la force de présence n’avait rien à lui envier. Grand est le poids de chair en effet de cet homme mort en mer, noyé, qu’Ellida a trahi et qui l’obsède. « Parfois c’est comme s’il se dressait soudain devant moi, en chair et en os. Ou plutôt pas tout à fait devant. Il ne me regarde jamais. Il est là, tout simplement. » Avec toute la puissance silencieuse du fantôme incarné, il est là dans ce fantôme du dedans qu’elle voit avec son esprit. La force de possession par le fantôme de l’homme cru mort, sa force de présence sont telles que l’enfant qui n’est pas de lui à ses yeux. Ces pouvoirs du fantôme, Ellida les formule à travers le sentiment qu’il était revenu quand elle attendait l’enfant. Sa force de présence en effet n’est pas seulement psychique car tout se passe comme s’il s’était emparé physiquement d’elle « en chair et en os ».
Il y a plus : une parenté étrange s’établit entre le fantôme et celle qu’il obsède. Ellida en effet appartient elle aussi au « peuple de la mer », elle aussi se sent et se dit une étrangère. Elle est celle qu’on appelle « la Dame de la mer », pas seulement parce que sa seule joie est de plonger dans la mer mais parce que cette passion pour la mer, son rapport intime avec les oiseaux de mer font d’elle un être de partout et de nulle part, tels ces marins pareils à des oiseaux migrateurs (comme le capitaine Horster de Un ennemi du Peuple). Aussi y a-t-il en elle ce même mélange de pouvoir de fascination et de pouvoir de terreur que celui qui la liait à cet homme. L’attirance qu’elle éprouvait pour lui était mêlée de peur, « une peur si effroyable comme seule la mer peut en inspirer ». « Cet homme est comme la mer », tel est le secret de l’attraction qu’il exerce. Mais elle aussi terrifie et attire. Elle est cet « effroyable » qui fascine, ce même effroyable qu’elle porte en elle, auquel elle se sent appartenir : « L’effroyable c’est l’attirance qui est au fond de mon âme », avoue-t-elle. Il s’agit d’une attirance liée à la mort mais ressentie en même temps comme la vraie vie. Les puissances de la mer sont là comme puissances de mort mais aussi comme figures du sans-nom, du sans-borne, cristallisant ce « désir de l’impossible » que Wangel lui-même reconnaît douloureusement en elle et qui « précipitera (son) âme dans les ténèbres de la nuit ». Seule la force de l’amour de Wangel, capable de lui rendre sa liberté, la délivrera finalement de ce pouvoir de fascination et de terreur de la mer et de l’Etranger revenu de la mer. (…)
Françoise Decant
L’écriture chez Henrik Ibsen, un savant nouage
La Dame de la mer ou le désir de l'impossible
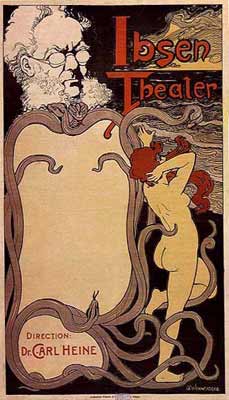 Extrait de L’Écriture chez Henrik Ibsen
Extrait de L’Écriture chez Henrik Ibsen
Éditions Érès, 2007, p131-140
Ferenczi s’était beaucoup intéressé à la Dame de la mer, et il était allé jusqu’à faire un rapprochement entre l’intrigue de la pièce et la dynamique d’une analyse mettant le mari, le docteur Wangel, en place de psychanalyste. « On pourrait comparer La Dame de la mer au traitement psychanalytique d’une représentation obsessionnelle », écrit-il à Freud le 17 juillet 1908[1].
Il parle d’un cas de monomanie pour désigner l’obsession qui ravage Ellida, l’héroïne, à savoir un attachement démesuré à la mer. Ellida, « la fille du gardien du phare » surnommée la « Dame de la mer », tant elle aime se baigner, est donc mariée au Dr Wangel, veuf et père de deux jeunes filles, qui l’entoure d’une bienveillante sollicitude. Malgré cela, Ellida n’est pas heureuse. Quelque chose l’attire ailleurs… Mais elle ne sait pas quoi, ni pourquoi…
L’histoire
Le Dr Wangel, inquiet de l’état de santé de sa femme, confie ses craintes à son ami : « Elle est un peu nerveuse depuis quelques années, je n’arrive pas à comprendre ce qu’elle a. On dirait que sa seule vie, c’est de se plonger dans la mer, voyez-vous. » Puis Wangel invite sa femme à lui parler, profitant d’un moment où ils sont seuls : « Nous ne pouvons pas continuer ainsi », lui dit-il, estimant qu’il doit savoir pourquoi elle ne veut pas vivre avec lui « comme sa femme ». Ellida accepte alors de mettre des mots sur ce qui l’oppresse. « Nuit et jour, hiver comme été, elle me submerge, cette vertigineuse nostalgie de la mer ». Wangel, qui a du mal à saisir ce que dit sa femme, lui propose de déménager et de s’installer au bord de la mer, n’importe où, prêt à sacrifier sa clientèle de médecin. Mais Ellida refuse. Elle préfère lui dire « les choses comme elles sont », ou plutôt, précise-t-elle, « comme elles me semblent être ».
Elle va commencer par lui rappeler qu’elle avait aimé un autre homme autrefois, un marin, avec lequel elle avait été fiancée, et qu’elle pense toujours à cet homme, qui avait exercé un singulier pouvoir sur elle. Wangel, que Ferenczi[2] n’a pas hésité à installer en place de psychanalyste, lui propose alors : « Mais il ne faut plus y penser. Jamais » et il ajoute : « Nous essaierons une autre cure pour toi ».
Si la cure de paroles avec l’aveu concernant cet amour de jeunesse a échoué, Ellida rejette la cure maritime et l’air vivifiant de la mer, car ce qu’elle veut, c’est continuer à dire, à parler de ce qui l’envahit. Courageusement, son mari accepte à nouveau de l’écouter. Ce n’est plus d’un amour de jeunesse dont elle entend parler alors, mais de l’effroyable, et avec cet effroyable va être introduit celui qui se nomme désormais dans le texte d’Ibsen « l’Étranger ».
« L’Étranger »
Cet étranger inspire à Ellida une peur si effroyable comme seule la mer peut en inspirer, précise-t-elle. Lorsque Ellida cherche à décrire cet homme, ce marin avec l’épingle de cravate et la perle qui ressemble à un œil de poisson mort qui la regarde, Wangel réalise que sa femme est bien malade. « Tu es plus malade que je ne le pensais », lui dit-il. Ellida le supplie alors de l’aider, car, dit-elle, « Je me sens cernée de toutes parts ».
Le soir même, l’Étranger fait son apparition : s’adressant à, elle, il lui dit, comme s’il l’avait quittée la veille: « Bonsoir Ellida !… Me voilà ! … je viens te chercher. » Mais Ellida est terrorisée: « Les yeux, les yeux… Ne me regardez pas ainsi ! »
Elle demande alors à son mari de la sauver, de la débarrasser de ce qu’elle nomme « cette chose horrible, effroyable » : «sauve-moi de mo-imême », le supplie-t-elle. Wangel, avec une incroyable perspicacité, lui dit : « Ellida, je le pressens, il y a autre chose. » Ellida parle de l’attirance : «Cet homme est comme la mer». Pragmatique, Wangel, une fois l’Etranger parti, pense que cette irruption de la réalité va peut-être faire du bien à sa femme et balayer ce qu’il appelle « ses imaginations morbides », bref la guérir. Mais il se trompe. Ellida est toujours autant torturée par l’angoisse. L’Étranger n’a-t-il pas dit qu’il reviendrait la chercher demain ? Wangel, comme mari, mais aussi comme médecin, affirme dans un premier temps que son devoir est de la protéger, envers et contre tout, même si sa femme s’y oppose. Dans un deuxième temps, il va la laisser choisir.
Ferenczi : le noyau volcanique
Ferenczi résume la fin de la pièce en ces termes : « Le mari comprend que quatre murs peuvent retenir le corps d’un être certes, mais non ses sentiments. Il rend donc à sa femme le droit de disposer d’elle-même, et la laisse libre[3] de choisir entre lui et l’aventurier. Et dès qu’elle est libre de choisir, c’est à nouveau son mari qu’elle choisit. Cette décision librement prise met fin à tout jamais à la pensée torturante de n’aimer son mari que par intérêt[4]. » Par la suite, Ferenczi, qui rapproche la pièce du déroulement d’une analyse, évoque dans un premier temps l’importance de la levée du refoulement : «Le souci ou la pensée inconsciente qui a valu tant de tourments inutiles au malade ne pouvait le troubler que tant qu’il restait dans l’inconscient, à l’abri de la lumière démystifiante de la conscience. »
Mais on sent bien qu’il a perçu que les choses n’étaient pas si simples… Il parle de certains conflits non résolus, puis il évoque tour à tour des maux réels, l’indestructibilité de certains symptômes névrotiques, et il termine son article par la question du deuil qui peut « aussi » prendre deux formes : « Le deuil physiologique et le deuil pathologique ». Mais Ferenczi ne dit pas explicitement à quoi se rapporte cet « aussi». Serait-ce aux deux formes de refoulement qu’il pensait sans vraiment les nommer ?
En effet, on voit bien que la levée du refoulement ne résout pas tout. Ellida est toujours aussi angoissée malgré la révélation faite à son mari de cet amour de jeunesse qui l’obsède. Le noyau central de l’angoisse, lié au refoulement originaire et la jouissance qui s’y rattache est resté intact. Ce noyau central, Ferenczi le compare à un « noyau volcanique », et les termes qu’il utilise alors se rapportent bien à la force de la pulsion ainsi qu’à l’excès de jouissance pulsionnelle qui va être rejeté par le sujet lors du refoulement originaire. Après avoir évoqué le caractère « indestructible » des symptômes nèvrotiques, Ferenczi écrit : « Le complexe dissimulé dans l’inconscient, tel un noyau volcanique, se remplit sans cesse d’énergie, et lorsque 1a tension atteint un certain niveau, de nouvelles éruptions se produisent[5]. » Nous sommes bien dans le pulsionnel…
Mais revenons à La dame de la mer, pièce dont le titre avait été annoncé quelque trente ans plus tôt sous forme d’une hallucination, dans le poème lyrique d’Ibsen, Peer Gynt[6], lorsque Peer, le héros, croit voir figurée « une dame de la mer» sur le fronton de la cabane où se trouve Solvejg, l’objet incestueux, au moment où l’angoisse l’envahit.
Le nouage du sexuel au réel de la mort.
Dans ce très beau texte d’une saisissante sensualité, Ibsen va nouer le sexuel au réel de la mort, et ce nœud, c’est un marin qui va s’en faire le représentant.
La mer, l’une des figures de la mère empruntée au symbolisme, est cet étrange objet de fascination mortifère.
Ellida ne comprend pas plus que son mari, le Dr Wangel, pourquoi elle est attirée par la mer, mais, grâce à lui, qui l’invite à dire, elle, va tenter de mettre des mots sur ce qui ne cesse de l’envahir : « Nuit et jour, hiver comme été, elle me submerge, cette vertigineuse nostalgie de la iner ». Lorsqu’elle écarte l’idée d’aller vivre au bord de la mer, car, dit-elle, « Je le sens, même là-bas, je ne pourrai m’en débarrasser », son mari lui demande, étonné : «De quoi parles-tu ? » Ellida lui fait cette réponse « De l’effroyable, de ce pouvoir incompréhensible sur mon esprit. »
Wangel ne comprend pas. Que veut-t-elle dire ? Les paroles de sa femme résonnent de façon tellement énigmatique ! Mais comment pourrait-il en être autrement au moment même où Ellida tisse quelque chose entre l’effroyable, son attirance pour la mer, et la peur de cet homme qu’elle a aimé… Ellida dit alors: « Une peur si effroyable comme seule la mer peut en inspirer… » Et lorsque Wangel dit comprendre pourquoi sa femme se refusait à lui et ne voulait pas vivre avec lui « comme sa femme », n’est-ce pas parce qu’il a repéré le caractère sexuel de cette attirance pour la mer ?
Mais Ellida est terrorisée : la jouissance pulsionnelle qui fait retour se présente sous la forme d’un œil… qui la regarde. Ellida se sent cernée de partout et fait appel à son mari pour qu’il l’aide. Mais pourquoi ne s’est-elle pas confiée plus tôt ? Ellida : « Si je m’étais confiée à toi, alors il aurait fallu que je te confie aussi le – ». Ellida marque une pause traduite dans le texte par ce tiret : l’indicible.
L’indicible : « Le désir de l’impossible »
L’irruption en chair et en os de l’Étranger ne va pas empêcher Wangel de continuer à pousser sa femme à dire… Un dialogue s’engage. Mais d’abord, que sait-elle de lui, de cet Etranger ? Rien.
Ellida : C’est vrai, c’est cela l’effroyable.
Wangel : Oui, c’est effroyable.
Ellida : Et c’est pourquoi je dois m’y précipiter.
Wangel : Parce que c’est effroyable
Ellida : Oui, pour cela.
Wangel (s’approchant) : Écoute-moi Ellida, – qu’entends-tu par effroyable?
Ellida (réfléchissant) : L’effroyable – c’est ce qui fait peur et qui attire.
Ébranlé, Wangel se ressaisit et fait valoir son devoir de la protéger.
Ellida : « Me protéger ? Contre quoi ? Je ne suis menacée par aucune violence, par aucune puissance extérieure. L’effroyable, c’est plus profond, Wangel ! L’effroyable – c’est l’attirance qui est au fond de mon âme. Que peux-tu faire contre elle ? »
Et lorsque l’Étranger revient pour la deuxième fois chercher Ellida, et que son mari tente de la retenir, elle lui dit : « Tu peux me retenir, mais mon âme, mes pensées, – mes envies et mes désirs – eux, tu ne pourras pas les enfermer. Ils continueront à s’envoler vers l’inconnu. »
Et là où les critiques ont vu un discours en faveur de l’émancipation féminine, Ibsen, dans une formule concise, épingle le réel du côté de l’impossible.
Wangel : « Ce désir du sans fin, du sans bornes, ce désir de l’impossible, il précipitera ton âme dans les ténèbres de la nuit. »
L’histoire se déroule en Norvège, dans « le pays où le monde passe pour aller contempler le soleil de minuit ». Nous sommes en 1888. Si Freud a déjà rencontré Charcot et Breuer, il a à peine commencé d’écrire. La psychanalyse en est à ses balbutiements. D’ailleurs, c’est du théâtre, rien que du théâtre… Où pourtant chaque mot compte… Freud, qui s’est intéressé à Rosmersholm, semble être passé à côté de texte dont il avait pourtant entendu parler par ses disciples, Ferenczi et Jung.
Jung : le nœud n’est pas dénoué mais tranché…
Car Jung aimait aussi beaucoup ce texte d’Ibsen. Dans une longue lettre datée du 10 octobre 1907[7], il entend entretenir Freud d’un « esthétiquement beau » copiant exactement La dame de la mer d’Ibsen lui écrit-il. « La construction du drame, la façon dont le nœud est agencé sont identiques à Ibsen, mais la péripétie et le dénouement ne mènent pas à la libération de la libido, mais au crépuscule de l’autoérotiseme, où le vieux dragon s’empare à nouveau de toute la libido qui lui appartient ». Et il ajoute « le nœud n’est pas dénoué, mai tranché ». Puis il évoque le cas de sa patiente pour revenir finalement à un autre nœud, qui est le nœud du transfert…
Le transfert qu’elle fait sur lui, s’il a pour conséquence de modifier l’humeur de cette jeune femme déprimée, amène également « l’irruption d’une violente excitation sexuelle »… Tout de suite après, Jung dit vouloir passer à « autre chose » et fait appel à Freud : « J’aimerais vous demander votre conseil expérimenté dans « une autre affaire. » Et il expose l’affaire : «Une dame guérie d’une névrose obsessionnelle fait de moi l’objet de ses fantasmes sexuels excessifs. Elle reconnaît mon rôle dans ses fantasmes comme maladif et aimerait par conséquent se détacher de moi et refouler ses fantasmes. » Jung est perplexe : « Que faut-il faire ? Faut-il poursuivre le traitement, qui procure à la patiente, elle l’avoue elle-même, un plaisir voluptueux, ou faut-il la repousser ? » Et il termine par cette question : « Ce cas vous est certainement familier jusqu’au dégoût; que faites-vous dans de tels cas ? »
Le retour de la libido grâce aux fantasmes sur la personne de l’analyste via le transfert ne nous paraît pas aussi éloigné que cela de ce qu’Ibsen amène dans son texte par le biais du travail d’écriture.
Le tissage du fantasme
En incitant sa femme à, dire, sous prétexte de vouloir la libérer de ses symptômes, et en particulier de cette angoisse qui ne la quitte pas, Wangel ne l’invite-t-il pas à tisser le fantasme qui va lui permettre de tenir quelque peu à distance ce réel oppressant qui la cerne de toutes parts ? Mais d’abord, cet effroyable, cet incompréhensible, qui revient du dehors, lourd d’angoisse, mais qui la fascine, ne s’est-t-il pas constitué à partir d’un rejet ? Or, si c’est la signification phallique qui est rejetée en raison de son lien à l’angoisse de la castration maternelle, n’est-il pas logique que ce qui revient hanter le sujet sous la forme d’un désir qui insiste, soit accompagné d’angoisse ?
Ce marin, l’Étranger, comme le nomme si bien Ibsen, n’incarne-t-il pas parfaitement l’une de ces « doublures errantes qui réclament leur dû », pour reprendre l’expression de Gérard Pommier[8] ?
Lorsqu’il vient chercher Ellida, faisant fi du temps qui s’est écoulé et du mari, montrant que rien ne peut l’arrêter dans sa détermination, il lui dit tout simplement : « Me voilà, suis-moi!» Son apparition brutale, aussi violente que les flots tumultueux qui étaient censés l’avoir englouti, signe le retour du déchaînement de la jouissance pulsionnelle.
En le voyant, Ellida est prise d’effroi : « Les yeux, les yeux… ne me regardez pas ainsi ! »
Mais l’apparition du marin n’est pas seulement liée au retour du pulsionnel. En lisant attentivement le texte, on s’aperçoit qu’il est aussi question des yeux de ce marin avec la naissance d’un enfant qu’Ellida a attendu mais qui est par la suite décédé. Elle avoue à son mari que cet enfant avait les yeux du marin, aménageant ainsi à ce marin une place de père.
C’est un bien savant nouage que nous propose Ibsen. Il s’y connaissait en nœuds… marins ou pas ! Le marin est à, la fois le Réel c’est-à-dire «l’Etranger, l’Hôte qui est en nous », pour reprendre la citation de Cocteau, et un père fabriqué de toutes pièces par Ellida, tissé dans les mailles du fantasme. Que ce père se présente sous les traits d’un père aussi attirant sexuellement que violent n’a rien d’étonnant, puisque sa présence est en rapport avec l’angoisse de la castration maternelle.
Ubiquité de ce personnage envoûtant, qui, parce qu’il est le rappel de l’amour maternel et de son énigmatique désir, traîne au- dessus de lui, non seulement « les puissances de la mer » mais aussi la présence « des ailes noires et silencieuses » de la mort. Et ce, jusqu’au moment où Ellida peut lui dire, parce que le père primitif a cédé 1a place au père mort : « Pour moi, vous êtes mort. Un mort sorti de la mer qui retourne. »
Mais pour ce faire, une série d’actes a été nécessaire, au moins trois actes.
Les actes du sujet
Le premier – afin qu’Ellida puisse subjectiver ce réel effroyable- lui a demandé l’effort de sortir de cette place d’objet qu’elle pointe lorsqu’elle reproche à son mari de l’avoir achetée comme une marchandise. Si elle accepte l’idée qu’elle a bien voulu se vendre, elle veut maintenant qu’il lui rende sa liberté. Beaucoup de choses ont été écrites concernant cette histoire de liberté, liberté féminine, liberté dans le couple, la Liberté avec un grand L, mais il nous semble que seule la nécessité du passage d’une place objectivante (par le désir de l’Autre) à une place subjectivée en rapport avec le tissage du fantasme peut permettre de comprendre pourquoi tout à coup après tant d’années de mariage, Ellida fait ce grief à son mari.
Le deuxième acte, c’est le mari qui va le poser, à la fin de la pièce. Alors que dans un premier temps, il n’avait pas voulu rendre la liberté à sa femme, tentant ainsi de s’opposer à ses pulsions destructrices, et voulant la protéger malgré elle, dans un deuxième temps, il change de position et accepte de rendre la liberté à sa femme, qui, surprise, lui demande : « C’est vrai, tu peux, – tu peux faire ça[9] ! »En acceptant de la perdre, le Dr Wangel fait barrage au désir incestueux d’Ellida et la sauve du gouffre dans lequel elle était prête à se précipiter. Il fait coupure.
Le troisième acte, qui relève de la symbolisation, concerne le fait qu’Ellida, se saisissant de la liberté que son mari lui octroie, va pouvoir en « toute responsabilité » opérer un changement au niveau des différentes instances paternelles, faisant passer ce père primitif inventé, au rang de père mort, de père symbolique, et ce, par le biais d’un meurtre : « En toute liberté et en toute responsabilité », dit-elle à son mari, en ajoutant : « Il y a là comme une transformation. »
S’adressant à l’Étranger, elle lui dit alors d’une voix assurée : « Je ne vous suivrai pas. Pour moi, vous êtes un mort sorti de la mer et qui y retourne. Je n’éprouve plus d’effroi devant vous. Ni d’attirance. » Et considérant que son mari avait été un bon médecin, elle lui adresse ces paroles : « Tu as osé employer le bon remède : le seul qui pouvait me guérir. »
À l’inverse, dans Hedda Gabler, Tesman, le mari, entièrement occupé à la tâche qui le tient, va, sans en mesurer les effets ravageurs, livrer sa femme à la jouissance du juge Brack, la livrant du même coup à, la mort : « Vous viendrez rendre visite à ma femme ! », demande Tesman au juge, sachant combien lui, sera désormais occupé par son travail.
Le juge Brack : « Tous les soirs, si vous voulez, Mme Tesman ! Nous nous amuserons bien tous les deux ! » Et avant de mettre fin à ses jours, Hedda répond au juge : « Oui, c’est bien ce que vous espérez, Monsieur le juge ? seul coq du poulailler[10]…»Le père de la horde n’est pas loin…
[1] S. Freud-S. Ferenczi, Correspondance, t. 1, p. 18.
[2] S. Ferenczi, « Suggestion et psychanalyse », Œuvres complètes, t. 1, p. 236-237.
[3] Nous verrons plus loin ce qu’évoque pour nous cette histoire de liberté…
[4] S. Ferenczi, op. cit.
[5] S. Ferenczi, op. cit.
[6] H. Ibsen, Peer Gynt, op.cit., Acte V, scène V, p. 173.
[7] S. Freud-C. Gjung, Correspondance, t. 1, p. 145.
[8] G. Pommier, Qu’est-ce que le « Réel » ?, Toulouse, érès, 2004, p. 15.
[9] Voici ce qu’écrit jean- Richard Freymann dans son livre Les Parures de l’oralité (Arcanesérès, 1994) : « Peut-il me perdre ? est la formulation élaborée qui assoit les fantasmes d’exclusion dans une reconnaissance implicite de cette place du désir au-delà de la demande. » (Chapitre « Zurücksetzung et Urteil ou du fantasme à la séparation », p. 25.)
[10] H. Ibsen, Hedda Gabler, op. cit., p. 265.
Sandor Ferenczi
Psychanalyse 1 / Œuvres complètes 1908-1922
Suggestion et psychanalyse
Psychanalyse I Œuvres complètes, Tome 1: 1908-1912. Traduction de J. Dupont, Éditions Payot, 1968
(…) Il n’est pas rare de retrouver dans nos analyses le drame qui se joue de façon si émouvante dans la pièce d’Ibsen, La Dame de la Mer. L’héroïne est la femme d’un médecin qui, bien qu’elle ait tout pour être heureuse, est la victime d’obsessions graves. La mer, rien que la mer remplit tout son univers affectif. Toute la tendresse de son entourage, de sa famille, glisse sur elle sans l’atteindre. Son mari affligé mobilise tout l’arsenal de la science pour rétablir l’équilibre affectif de sa femme : la réassurance, la diversion, les distractions de toutes sortes, rien n’y fait. Finalement, au moyen d’un interrogatoire psychanalytique en règle, il découvre que le mal imaginaire de sa femme provient d’un chagrin réel. Le souvenir d’un marin, un aventurier, à qui elle s’était promise lorsqu’elle était jeune fille, troublait sa quiétude. Elle était continuellement tourmentée par l’idée qu’elle n’aimait pas vraiment son mari, qu’elle l’avait épousé par intérêt, et que son cœur appartenait toujours au marin. À la fin du drame le marin revient effectivement et réclame son dû. Le mari veut d’abord retenir sa femme de force, mais bien vite il comprend que quatre murs peuvent retenir le corps d’un être certes, Mais non ses sentiments. Il rend donc à sa femme le droit de disposer d’elle-même et la laisse libre de choisir entre lui et l’aventurier. Et dès l’instant où elle est libre de choisir, c’est à nouveau son mari qu’elle choisit ; cette décision librement prise met fin à tout jamais à la pensée torturante de n’aimer son mari que par intérêt.
Ce que le poète peut se permettre – faire revivre des personnages selon son bon plaisir – n’est guère possible pour le psychanalyste. Mais la fantaisie délivrée de ses liens par l’analyse peut évoquer les souvenirs du passé avec une force extraordinaire ; il apparaît alors souvent, comme chez La Dame de la Mer, que le souci ou la pensée inconsciente qui a valu tant de tourments inutiles au malade ne pouvait le troubler que tant qu’il restait dans l’inconscient, à l’abri de la lumière démystifiante de la conscience.
Et si l’analyse découvre que l’idée ou l’angoisse refoulées, compromettant l’équilibre psychique de l’individu, conservent leur actualité, abritent encore des conflits, la nécessité demeure de les dévoiler et de les exposer clairement à nous-même et à notre patient.
Les maux réels, souvent, ont aussi un remède ; mais à la condition de connaître ces maux. Si La Dame de la Mer, confrontée à la liberté de choisir, sentait toujours qu’elle n’aime pas son mari, alors, qu’elle divorce. Elle pourra toujours ensuite réfléchir si elle doit suivre cet aventurier ou bien ne suivre ni son mari, brave homme qu’elle n’aime pas, ni l’homme séduisant mais sans foi, et, rompant avec les deux, se fixer des buts nouveaux, qui pourraient lui offrir quelque compensation.
Et ce serait là un exemple de la troisième éventualité, où le problème reste insoluble même après analyse. On pourrait penser que dans ce cas il vaut quand même mieux combattre une obsession absurde, comme l’amour monomaniaque de la mer, que la cruelle réalité. Mais il n’en est rien. La caractéristique majeure des symptômes névrotiques est l’impossibilité de leur trouver une solution, et par conséquent, leur indestructibilité. Le complexe dissimulé dans l’inconscient tel un noyau volcanique, se remplit sans cesse d’énergie, et lorsque la tension atteint un certain niveau, de nouvelles éruptions se produisent. Seul ce qui a été pleinement vécu et compris peut perdre de sa force, de son intensité affective. La compréhension complète est suivie par un « étalement associatif » de la tension affective. Il faut savoir que le deuil aussi a deux formes ; le deuil physiologique et le deuil pathologique. Dans la première forme, la paralysie psychique initiale est bientôt suivie par une résignation philosophique ; les soucis et les devoirs de l’avenir permettent à l’instinct de conservation de reprendre ses droits. Lorsque que des années, des décades se passent sans que le sentiment de deuil s’apaise, nous pouvons être certaine que l’endeuillé ne pleure pu seulement la personne et le souvenir dont il a conscience, mais que, du fond de l’inconscient, d’autres motifs de dépression viennent profiter du deuil actuel pour se manifester.
L’analyse transforme le deuil pathologique en deuil physiologique et le rend ainsi accessible à l’érosion du temps et de la vie, tel un cristal qui reste intact tant qu’il est enfoui dans les profondeurs de la terre, mais s’altère sous l’effet de la pluie, du gel, de la neige et du soleil dès qu’il est amené à la surface (…).
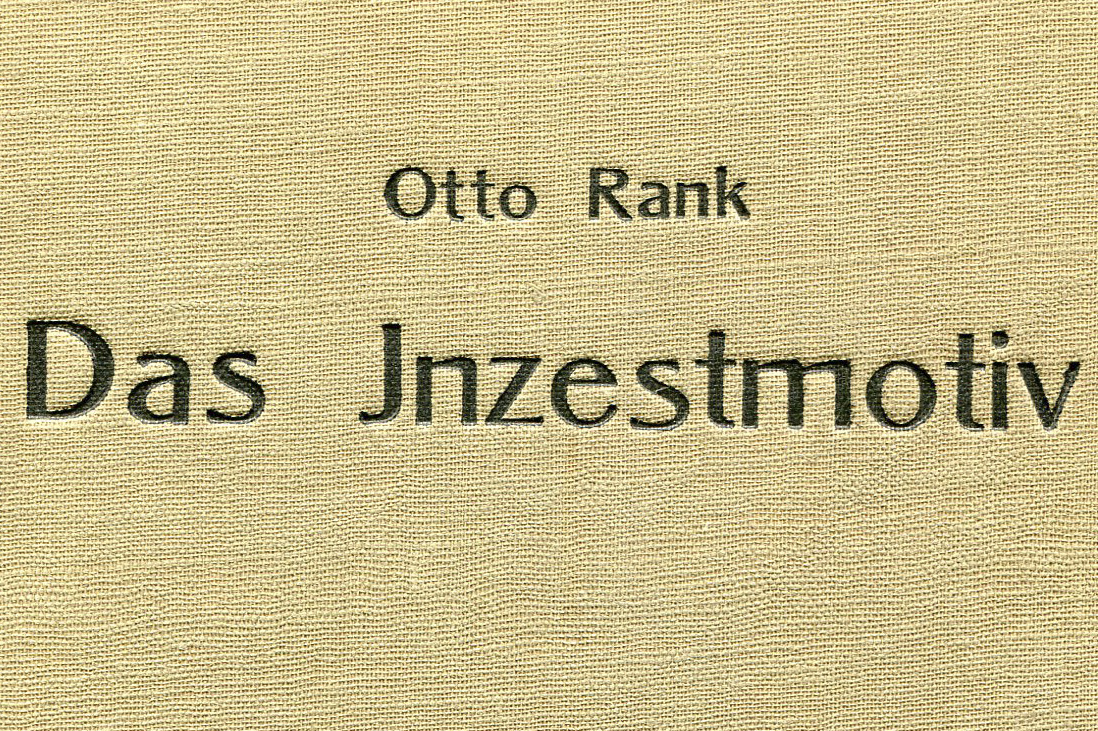
Otto Rank
Le Motif de l’inceste
Le motif de l'époux de retour chez lui
 Das Motiv des Heimkehrenden Gatten [Le Motif de l’époux de retour chez lui]
Das Motiv des Heimkehrenden Gatten [Le Motif de l’époux de retour chez lui]
Tiré de Das Inzest Motiv in Dichtung und Sage [Le Motif de l’inceste dans la fiction et dans les mythes], Leipzig und Wien, Franz Deutilke, 1912
(…) Ce motif de l’époux de retour chez lui est présent, spécialement dans les chansons populaires, dans la littérature du monde entier mais apparaît le plus souvent détaché de sa racine dans le roman familial incestueux, bien qu’il s’origine dans la constellation incestueuse infantile et ne peut être compris qu’à partir de celle-ci. Que ce motif du retour de l’époux, qui est aussi à la base du mythe d’Agamemenon et de celui d’Ulysse, soit mis en forme par le fils et représente le fantasme de celui-ci quant à l’élimination de l’encombrant père et à l’appropriation sans entrave de la mère, ne se démontre pas seulement par le fait qu’il sera assassiné ou qu’ultérieurement il cèdera volontairement, dans un affaiblissement sentimental, sa femme et son rival, mais aussi par le fantasme typique du garçon de l’absence ou du départ du père, lequel sera tenu pour mort (c’est-à-dire qu’on lui souhaite la mort), comme dans Phèdre.
(Traduction d’Elizabeth Müller, Psychanalyse n°18)
Note de bas de page :
«Du point de vue de la femme, ce fantasme du retour de l’époux chez lui est traité dans la pièce d’Ibsen « La Dame de la mer », où l’Étranger est tenu pour mort et se présente devant la seconde femme de Wangel pour la récupérer. La signification inconsciente de cette emprise de l’étranger sur la femme, qui se refuse même à son époux, devrait bien être celle d’une fixation infantile au père, qui en tant que gardien de phare se fond avec l’homme de la mer en une même personne. Wangel dit carrément : « Je suis beaucoup beaucoup plus âgé qu’elle. J’aurais dû être un père pour elle. » La relation au père a également été traitée par Ibsen dans Rosmersholm. »
(Traduction de Claude Baqué)
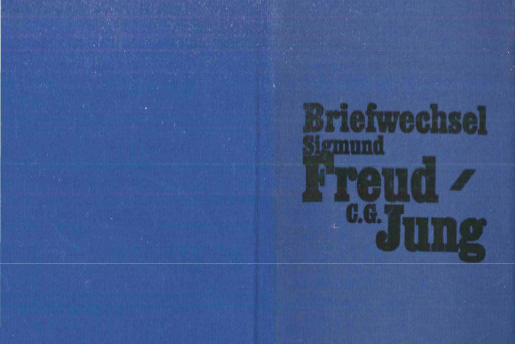
Carl Gustav Jung
Sigmund Freud – C.G. Jung / Correspondance 1906 – 1914
Lettre à Freud du 10 octobre 1907
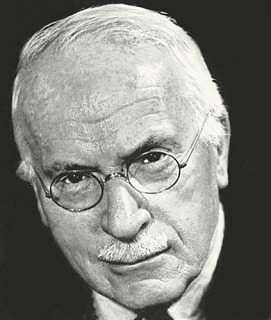 Correspondance Tome 1, Gallimard,1975, p145-148
Correspondance Tome 1, Gallimard,1975, p145-148
Burghölzli-Zurich, 10. X. 07.
Très honoré Monsieur le Professeur!
Recevez les plus chaleureux remerciements pour l’excellente photographie et la splendide médaille. Tous deux me font extraordinairement plaisir. Je vais immédiatement vous envoyer également mon portrait, bien qu’un tel acte me semble presque ridicule.
Hier et aujourd’hui j’ai à nouveau été terriblement fâché à cause de Weygandt[1], qui a publié un article plus qu’idiot dans la Monatsschrift de Ziehen. C’est l’une des pires choses qu’on ait jamais déblatérées. Et méchante ! Je connais Weygandt personnellement, c’est un hystérique par excellence et bourré de complexes du haut jusqu’en bas, de sorte qu’il ne sort pas une parole naturelle de son gosier; il est aussi beaucoup plus sot qu’Aschaffenburg. Je n’aurais jamais pensé que les savants allemands puissent produire autant de basse méchanceté. Derrière ce triste avers, je jouis actuellement d’un magnifique revers grâce au traitement d’une jeune femme atteinte de dementia praecox. Chaque cas bien analysable est, n’est-ce pas, quelque chose d’esthétiquement beau, mais ce cas en particulier, car il copie exactement la Femme de la mer d’Ibsen[2]. La construction du drame, la façon dont le nœud est agencé sont identiques à Ibsen, mais la péripétie et le dénouement ne mènent pas à la libération de la libido, mais au crépuscule de l’auto-érotisme, où le vieux dragon s’empare à nouveau de toute la libido qui lui appartient. Le noeud n’est pas dénoué, mais tranché.
La patiente aime de loin un jeune homme riche, X., apparemment sans être aimée en retour. Sur des conseils elle se fiance à un homme, A., convenable et bien éduqué, mais insignifiant. Elle apprend, peu après ses fiançailles, d’un ami de X., que X. s’est lourdement ressenti de ses fiançailles. Sur ce, violente irruption de la passion. Profonde dépression; ce n’est que sur les conseils insistants de ses parents qu’elle se marie. Elle refuse le coït à son mari pendant les trois quarts d’une année. L’homme est touchant de patience, la mère la presse, finalement elle cède et permet, rarement, un coït absolument frigide. Conception. La dépression se relâche lentement un peu. Naissance d’une fille, qui est saluée avec une joie exaltée et aimée d’un amour surnaturel. La dépression est comme effacée. De temps en temps joie déchaînée, elle loue de manière enflée le bonheur de son mariage. Coït frigide comme auparavant. Peu de temps après les couches, elle est prise d’accès d’orgasmes avec onanisme pulsionnel et accompagné de la représentation de son ancien bien-aimé. L’enfant n’est habillée que de bleu. Elle ressemble tout à fait à son mari, mais a quelque chose de particulier en elle, – les yeux – ce ne sont ni les siens, ni ceux de son mari, ce sont de « merveilleux yeux bruns », les yeux de son ancien bien-aimé. Après une seconde grossesse, elle met au monde un garçon, qu’elle déteste dès le début, bien qu’elle ait désiré la grossesse. Jusque-là Ibsen. Puis vient l’antique fatalité. Au bout de deux ans, la fillette meurt. La patiente tombe dans une crise dans laquelle elle blasphème : « Pourquoi Dieu prend-il mon enfant, pourquoi prend-il seulement les beaux enfants et pas les infirmes? On dit qu’il prend les enfants au ciel, ce n’est pas vrai, et si même c’était vrai, on ne sait quand même pas ce qu’il fait avec eux là-bas! » (C’est ainsi qu’est qualifié l’amour pour l’enfant!) Dès lors agitée, colérique, bat son mari, menace de «jeter le garçonnet contre le premier mur venu ». Poussées de suicide, etc. Internement. Ici, au début, profondément déprimée, puis plus gaie avec transfert sur moi, parce que j’ai les yeux bruns et une haute stature. Au moment où l’analyse touche à la sexualité refoulée pendant son mariage, soudaine irruption d’une violente excitation sexuelle, qui se calme après quelques heures. Les rêves sont intéressants dans la mesure où ils montrent que son inconscient ne veut en fait pas seulement tuer le garçon, mais aussi la fillette bien-aimée (en tant qu’enfants du mari?); la fillette semble n’être qu’une figure symbolique du bien-aimé. Il me semble que nous sommes dans ce cas décidément devant une causalité psychogène.
Particulièrement intéressante du point du vue théorique est la circonstance que le moment où apparaît la maladie est celui où réussit le refoulement du bien-aimé gênant, après la première naissance; à ce moment-là, l’orgasme sexuel s’est émancipé, mais sans gêner durablement la personnalité dans son adaptation au mariage.
J’aimerais vous demander votre conseil expérimenté dans une autre affaire. Une dame guérie d’une névrose obsessionnelle fait de moi l’objet de ses fantasmes sexuels excessifs, qu’elle reconnaît, et qui lui pèsent sérieusement. Elle reconnaît mon rôle dans ses fantasmes comme maladif et aimerait par conséquent se détacher de moi et refouler ces fantasmes. Que faut-il faire? Faut-il poursuivre le traitement, qui procure à la patiente, elle l’avoue, un plaisir voluptueux, ou faut-il la repousser? Ce cas vous est certainement familier jusqu’au dégoût; que faites-vous dans de tels cas?
(…)
Avec mes meilleures salutations et mes plus cordiaux remerciements,
Votre entièrement dévoué
Jung

Jacques Robichez
Le Symbolisme au théâtre
Initiation de Lugné-Poe à Ibsen / La Dame de la mer

Portrait de Lugné-Poe par Vuillard, 1891
Extrait d’un chapitre de Le Symbolisme au théâtre, de Jacques Robichez, L’Arche, 1957, p151-157
(…) Pour quelles raisons le choix des Escholiers s’était-il porté sur La Dame de la Mer[2] ? Chronologiquement, la pièce précède immédiatement Hedda Gabler[3]. Les deux drames avaient été joués à Londres au printemps de 1891 à quelques jours d’intervalle[4]. Dans l’œuvre du poète, La Dame de la Mer, écrite sous le charme de souvenirs de jeunesse[5], correspond à un apaisement et à une détente[6]. L’étrange passion de l’héroine pour la mer, c’est un peu Ibsen lui-même qui l’a éprouvée. Il y a transposé ses propres souvenirs d’enfant et de jeune homme, certaines émotions d’Italie, ses nostalgies d’exilé à Dresde et à Munich. C’est une pièce de « conciliation »[7] où le dramaturge se fait moins agressif. Sa parfaite clarté, son dénouement heureux, pouvaient disposer favorablement les critiques qui n’étaient pas encore acquis à l’art ibsénien. Et surtout La Dame de la Mer prêtait peut-être plus qu’un autre drame à une interprétation poétique, tranchant sur celles du Théâtre Libre et du Vaudeville. Au reste l’un des Escholiers, Thadée Natanson, préparait une traduction de la pièce[8] et cette raison fut sans doute déterminante. C’est le 11 mars 1892 qu’elle fut lue aux Escholiers[9] puis reçue par le Comité. Toutefois, Natanson faisant attendre sa traduction, la représentation fut reportée après les vacances à la première quinzaine d’octobre[10]. Cependant vers le début du mois de septembre, il semble évident que Natanson ne sera pas prêt et Georges Bourdon, qui envisage d’avoir recours à la traduction de Chenevière et Johansen, écrit à Lugné-Poé :
« Ecris-moi donc longuement sur Ibsen. Si nous voulons passer dans sept semaines, vous avez tout juste le temps de répéter. Faut-il faire décidément notre deuil de Thadée ? Si nous prenons la traduction Savine, au moins serait-il courtois d’en avertir les auteurs… »[11]
Ainsi, jusqu’à quelques semaines de la représentation, sans doute enhardis par l’exemple d’Antoine, les Escholiers n’avaient pris contact ni avec Prozor, ni avec Desjardins, ni avec Savine, ni avec Chennevière et Johansen. Dans Le Sot du Tremplin, Lugné place à tort à cette date le début de ses relations avec Prozor[12]. Il est certain qu’il ne le vit pas alors et qu’il ne lui écrivit pas personnellement pour solliciter l’autorisation d’Ibsen[13]. Quoi qu’il en soit, par Prozor ou par Desjardins, cette autorisation semble avoir été accordée[14] et la pièce fut jouée au Théàtre Moderne le 16 décembre 1892[15].
Cette soirée du 16 décembre est plus importante que toutes les représentations ibséniennes qui l’ont précédée, parce que, pour la première fois, apparait dans l’interprétation un parti-pris symboliste. On verra que la notion de Symbolisme dramatique, encore vague jusqu’au moment où sont joués les premiers drames de Maeterlinck, se précise singulièrement au cours des deux ou trois années qui précèdent la fondation de L’Œuvre. A propos d’Ibsen, quand les critiques parlent de Symbolisme, ils l’entendent en deux sens différents.
Ou bien ils veulent dire que tous ses personnages sont des êtres complexes, mystérieux, se prêtant à l’analyse en profondeur et lui offrant successivement de nouvelles, de plus en plus secrètes révélations. Interprétation qui, pour quelques-uns des héros d’Ibsen, peut aisément se justifier, mais qui pour beaucoup d’autres est indéfendable. Dans La Dame de la Mer, Ballested, Arnholm, Bolette ne sont que de braves gens dessinés simplement et sans arrière-pensée. Il n’en va pas tout à fait de même de Wangel, d’Ellida, de l’Etranger. En eux, il est vrai, deux spectateurs différents ne distingueront pas les mêmes éléments psychologiques. Plus ou moins d’intuition, de perspicacité permettra d’apercevoir le conflit qui les oppose tout au fond d’eux-mêmes : Servitude et Liberté, Devoir et Aventure, Fjord et Grand Large, ou limitera le drame à l’anecdote banale d’une femme tentée par l’adultère et sauvée par la générosité de son mari.
Ou bien la critique prétend faire du théâtre d’Ibsen un théâtre d’allégories : parce que l’une des premières pièces d’Ibsen jouées à Paris était Le Canard Sauvage, parce que les critiques s’évertuaient à découvrir ce que « signifiait» ce canard, on a été tout naturellement porté à voir derrière chaque personnage d’Ibsen une notion d’ordre moral ou philosophique, derrière chacune de ses intrigues la confrontation d’un certain nombre de concepts, habillés tant bien que mal en images, derrière chaque indication scénique, aussi banale qu’elle fût, un sens caché. On a voulu que la pluie des Revenants et le soleil voulussent dire quelque chose et l’on a nommé symboliste ce théâtre à double sens[16], ce théâtre à clef, malgré les protestations unanimes des scandinaves, malgré les affirmations réitérées de l’auteur lui-même.
Presque toutes les querelles de la critique, à propos d’Ibsen, reposent donc sur une équivoque que ne justifiait guère son théâtre et que ne laissaient pas prévoir les premières réactions de 1890, Les Revenants, Le Canard Sauvage, Hedda Gabler, La Dame de la Mer étaient autant de drames où l’intrigue, l’analyse des caractères se suffisaient à elles-mêmes sans référence à une réalité mystérieuse. Cependant, pour La Dame de la Mer, il était tentant de projeter l’anecdote sur un plan plus général et moins immédiatement perceptible. L’héroïne elle-même proclamait qu’entre elle, l’Etranger et la mer existait une communauté secrète, une analogie poétique[17], dont on chercherait vainement l’équivalent dans Hedda Gabler ou dans Les Revenants.
Lugné-Poe mit résolument l’accent sur cet aspect de la pièce[18]. Il appliqua à Ibsen ce jeu nouveau, solennel et monotone qu’il avait expérimenté dans L’Intruse et Les Aveugles, ce jeu que la critique réclamait et approuvait au Théâtre d’Art et dont elle allait se lasser au Théâtre de L’Œuvre. Un Danois, Jens Petersen, suivait les répétitions et guidait le jeune metteur en scène[19]. Il s’efforçait de ramener l’interprétation vers la normale, à l’image des représentations danoises et norvégiennes[20]. Ce fut en vain. Cette Ellida qui avait réellement vécu, qu’Ibsen avait personnellement connue dans sa famille, qui s’appelait Magdalene Thoresen[21] devint, sur la scène française, sous les traits de l’interprète de Maeterlinck, Georgette Camée, l’étrange créature aux longs voiles, le fantôme blanc qu’évoque la lithographie de Maurice Denis[22], et de son mari l’homme lucide et tendre, cordial et bon vivant, le médecin professionnellement intéressé par un cas de névrose, Lugné-Poe fit l’être incompréhensible, lointain et fasciné que Jules Lemaitre devait surnommer plus tard le « clergyman somnambule ».
Une pareille interprétation explique en partie les réactions de la critique. Sarcey avoue, une fois de plus, n’avoir rien compris à la pièce[23].
« Oserai-je dire, écrit de son côté Henry Fouquier, que tout ceci reste trop obscur et que décidément il nous est bien difficile d’entrer dans l’état d’âme du Nord? »[24].
On sait qu’un pareil aveu ne se rencontre pas souvent sous la plume de Jules Lemaitre. Il souligne[25] ce qui, dans la pièce, demeure étranger à la sensibilité française : la conversation de Wangel et d’Ellida « ressemble à celle d’une stalactite et d’une stalagmite dans la blanche crevasse d’un fjord ». Mais il n’est pas déconcerté pour autant. Il reprend son idée favorite : Ibsen a le don de « rafraîchir les vieilles choses ». Que dans le mariage la femme ait le droit de librement disposer d’elle-même, que la seule fidélité soit une fidélité non acceptée mais voulue, voilà bien pour Lemaitre des idées auxquelles George Sand a rendu les Français familiers[26]. Mais chez Ibsen « la plupart des personnages sont haussés jusqu’au symbole » et les acteurs ont eu raison d’adopter un ton de « simplicité et de gravité ».
Au contraire, Jean Jullien écrivait : « Les interprètes ont eu tort de vouloir créer une atmosphère de mystère autour des personnages par leurs gestes hiératiques et le lyrisme de certaines intonations ; c’est de l’allégorie, oui ; mais de l’allégorie vivante. Jouez-la donc en vivants »[27]. Mais Sartey, Lemaître, Jullien, s’accordaient à féliciter chaleureusement les Escholiers[28]. C’était la plus glorieuse soirée du Cercle et le plus grand succès qu’Ibsen eùt encore remporté à Paris. Au souper qui suivit la représentation, le Comité rédigea un télégramme à l’adresse d’Ibsen :
« Les Escholiers réunis après le triomphe de La Dame de la Mer envoient à Ibsen l’hommage de leur admiration respectueuse »[29]
Quelques semaines plus tard, le Mercure de France[30], L’Ermitage[31], L’Art Social[32], L’Académie française[33] consacrent ce triomphe et, selon le mot de Jacques des Gachons, applaudissent chez Lugné-Poe « une conscience littéraire et un goût qui promettent pour demain un très curieux artiste » ». Mais l’article le plus significatif est celui d’Henri de Régnier:« (Ibsen) a inventé une chose qui lui appartient, des personnages tout en profondeur. Il y a en eux des remous d’âme qui tout à coup se creusent en vortex et laissent voir en leur spirale tortueuse le fond des songes les plus intérieurs. Ce qu’il y a en eux de latent et d’inavoué se découvre et apparaît et au-delà de l’être normal et superficiel s’en révèle un autre, à nu, plus étrange et véridique. Les personnages sont comme leurs propres spectres »[34].
Ainsi, par la voix de Régnier, c’était bien à la jeune école qu’était annexé le théâtre d’Ibsen. Celui-ci ne se plaindra pas d’ailleurs immédiatement d’être ainsi enrôlé. À la fin de 1892, son œuvre ne s’est pas encore imposée en France. Il est prêt à beaucoup de concessions et redoute de froisser les susceptibilités littéraires. La préface qu’il donne au recueil annuel de Ginisty, L’Année littéraire[35], a de quoi décevoir les amateurs d’originalité. Remontant à quarante ans en arrière, il se contente d’y relater avec bonhomie quelques anecdotes touchant sa première pièce, Catilina. L’interview que publie le 4 janvier 1893 Maurice Bigeon dans Le Figaro témoigne, si elle est fidèle, de la même prudence et du même désir d’être aimable: les Français « ont la probité de l’intelligence ». C’est à Paris que « véritablement bat le cœur du monde ». Pour les représentations, Ibsen a été satisfait « au delà de (ses) désirs ». – « je suis surpris – ajoute-t-il – de l’extraordinaire intelligence de vos critiques dramatiques. » Le livre d’Ehrhard est excellent, la conférence de Jules Lemaitre « une merveille », Becque est admirable, Zola et ses disciples ne le sont pas moins. Et ces éloges n’empêchent pas Ibsen d’apprécier aussi les Symbolistes :
« Oh! ceux-là, plus encore que vos jeunes dramaturges réalistes, ce sont mes préférés. Je les connais peu, malheureusement : ils sont très jeunes et je suis très vieux, mais je les aime car ils ont le frisson de l’avenir, ils chanteront l’hymne à l’aurore, ils rempliront les jours qui vont se lever. Eux et moi, nous sommes en communion d’idée ».
Parole imprudente parmi tant de prudence et de bénédictions ! Parole que les jeunes écrivains ne devaient que trop retenir. Pour plusieurs années Ibsen allait devenir, et surtout par l’action personnelle de Lugné-Poe, le prisonnier mal résigné des Symbolistes français.
[1] Le Symbolisme au théâtre, L’Arche, 1957, 151-157
[2] Lugné-Poe a écrit à plusieurs reprises (Le Sot du tremplin p. 221 Ibsen, p. 30. etc.) qu’Ibsen voulait que sa première pièce représentée à Paris fût La Dame de la Mer. Nous n’avons rien trouvé dans la correspondance d’Ibsen ni dans celle de Prozor qui confirmât cette préférence. Une lettre d’Ibsen à Prozor du 3 mars 1891 (Archives Prozor) indique comme premiers drames à diffuser en France, Le Canard Sauvage, Hedda Gabler, Un Ennemi du peuple.
[3] La Dame de la Mer, nov. 1888. Hedda Gabler, déc. 1890
[4] Cf. H. Kohl. Herrik Ibsen. Eit diktarliv, t. Il, pp. 3CS-313
[5] Lugné-Poe, Ibsen, pp. 30, sqq
[6] Cf. Bernard Shaw, Quintessence of Ibsenism, p. 89
[7] W. Berteval, Le Théâtre d’Ibsen, p. 241
[8] Cf. Lugné-Poe, Ibsen, p. 30
[9] Lettre de G. Bourdon à Lugné-Poe du 4 mars 1892 (B. Auteurs). La traduction de Natanson n’étant pas achevée, ce fut sans doute la traduction de Chennevière et johansen qui servit à la lecture. Cette traduction, qui devait être celle de la représentation, avait paru chez Savine dans un volume contenant aussi Un Ennemi de peuple, à la fin de janvier ou au début de février 1892. (Lettre de Savine à Prozor du 9 fév. 1892. Archives Prozor.)
[10] Bulletin des Escholiers, juil. 1892, (B. Auteurs)
[11] Lettre de G. Bourdon à Lugné-Poe du 3 sept. 1892. (B. Auteurs). Georges Bourdon allait être réélu président des Escholiers le Il nov. 1892 (Livre dot des Escholiers, liste des présidents)
[12] Le Sot du Tremplin, p. 219
[13] Nous avons en effet trouvé (Archives Prozol) le billet suivant adressé à Prozor par Lugné-Poe, le 21 mai 1893 . « Monsieur, Où puis-je avoir l’honneur de vous rencontrer ? C’est pour affaire personnelle qui vous sera peut-être agréable. – Très vôtre. A.F. Lugné-Poe. Mon nom ne vous est peut-être pas complètement inconnu, ayant eu cet hiver la satisfaction de faire jouer La Dame de la Mer et Pelléas et Mélisande. L.P. »
[14] Lugné-Poe, Ibsen. p. 33. L’autorisation est cependant contestée par Henry Bauër, (L’Echo de Paris, 19 déc. 1892).
[15] Georges Bourdon avait primitivement songé à la Salle des Bouffes du Nord où L’CEuvre fera ses débuts. (Lettre à Lugné-Poe du 12 nov. 1892, B. Auteurs.)
[16] Les deux livres en langue française sur Ibsen dont pouvaient s’inspirer les critiques de 1892, étaient celui de Charles Sarolea (Henrik Ibsen, 1891) et celui, plus important, d’Auguste Ehrhard (Henrik Ibsen et le théâtre contemporain, 1892). Sarolea et Ehrhard étaient très éloignés de fournir aux ibséniens des commentaires aussi pénétrants que ceux d’Edmond Gosse (Northern Studies, 1890) ou de G. B. Shaw (Quintessence of Ibsenism, 1891). Le livre de Shaw en particulier est une brillante exégèse du théâtre d’Ibsen. Voici comment Ehrhard (op. cit., 342-343) analysait le symbolisme ibsénien : « Le symbolisme est la forme de l’art qui donne à la fois satisfaction à notre désir de voir représenter la réalité et à notre besoin de la dépasser. Il fond ensemble le concret et l’abstrait. La réalité a un dessous, les faits un sens caché : ils sont la représentation matérielle des idées ; l’idée paraît dans le fait. La réalité est l’image sensible, le symbole du monde invisible. Le symbolisme ainsi compris diffère beaucoup de ce genre raffiné qui est depuis quelques années inauguré en France, qui repose sur un principe excellent, sur la nécessité de suggérer tout l’homme, de faire deviner une immensité vague, derrière les choses précises, mais qui n’est guère resté jusqu’à présent qu’un pur travail de forme et qui est discrédité par quelques charlatans et beaucoup de maladroits. Le vrai symbolisme, c’est l’idéalisation de la matière, la transfiguration du réel ; c’est la suggestion de l’infini par le fini. » Ehrhard expliquait ensuite comment ce symbolisme était aussi bien celui d’Ibsen que celui de Zola et de Dumas. (Le rapprochement entre Ibsen et Dumas avait été fait par E.M. de Vogüé, « Les Cigognes ». La Revue des Deux Mondes, 15 fév. 1892). Ehrhard concluait : « Un fait positif au milieu, puis, pareilles à des rayons qui partiraient de ce point central, les idées ou la leçon morale que le fait provoque. Enfin, tout autour, à la circonférence, une zone brumeuse qui représente le mystère dont la destinée humaine est entourée, voilà la figure géométrique, le schéma du drame symbolique d’Ibsen.» (op. cit., pp. 348-349).
[17] Les critiques français, prompts à rapprocher l’oeuvre d’Ibsen de notre littérature du dix-neuvième siècle, ont négligé de citer, à propos du caractère d’Ellida, L’Homme et la Mer des Fleurs du Mal « Homme fibre toujours tu chériras la mer / La mer est ton miroir… » et aussi Le Spleen de Paris, XXXIV, Déjà
[18] Lugné-Poe, Ibsen, p. 35
[19] Lugné-Poe, Le Sot du tremplin, pp. 221-222
[20] Ottar Odland, op. cit., p. 94, sqq, insiste sur la simplicité du drame il offre dans l’ensemble un sens réaliste et même terre à terre qui est indéniable. »
[21] Hast, Henrik Ibsen, p. 219
[22] Cette lithographie est reproduite dans Lugné-Poc, Ibsen, (plan. che XXI).
[23] Le Temps, 19 déc. 1892
[24] Le Figaro, 17 déc. 1892
[25] Le Journal des Débats, 19 déc. 1892
[26] Lemaitre aurait pu évoquer Michelet dont une page rappelle d’assez près le thème de La Dame de la Mer (Le Prêtre. p. 304.) Le mari dit à la femme : « Tu es libre, le pouvoir sous lequel tu as grandi ne te retient plus. Hors de moi, et n’y tenant que par le cœur et le souvenir, tu peux agir, penser ailleurs… et contre moi si tu peux ! Voilà ce qu’il y a de sublime dans l’amour, et pourquoi Dieu lui pardonne tant de choses ! c’est que dans son désintéressement sans limites, voulant faire un être libre et en être aimé librement, il crée son propre péril… Le mot pouvoir agir ailleurs contient aussi aimer ailleurs, et la chance de l’arrachement.
[27] Paris, 19 déc. 1892. On sait 1’affectueuse estime de Lugné-Poe pour Jean Jullien. Il ne suivit point cependant le conseil
[28] Céard écrivait de son côté dans L’Evénement (20 déc. 1892) un article très favorable, contenant mainte allusion hostile à Antoine. En revanche, Henry Bauër fut très sévère pour les Escholiers. Dès que ceux-ci avaient annoncé leur projet, il l’avait combattu : « je ne me réjouis pas de cette tentative et je n’approuve pas les traducteurs trop pressés de s’y prêter. La pièce est de celles qui ne se montent pas à la diable, ne souffrent pas une interprétation improvisée, raccrochée çà et là et sont menacées de périr sous les difficultés matérielles, le ridicule de la mise en scène dans un théatricule. » (L’Echo de Paris, 23 avr. 1892). Après la représentation à laquelle il n’assista pas, il écrivit un compte-rendu qui déclarait : « Les différentes tentatives d’appropriation d’Ibsen à la scène française furent des tentatives d’assassinat » et où il reprochait violemment aux Escholiers leur inexpérience, la médiocrité de leurs décors, leur incompréhension du texte (L’Echo de Paris. 19 déc. 1892). Nous n’avons pu découvrir la raison pour laquelle le futur défenseur d’Ibsen à L’Œuvre adopta cette attitude.
[29] La copie de ce télégramme a été conservée par Lugné-Poe, ainsi que la réponse d’Ibsen : « Pour votre aimable dépêche qui me réjouit merci de tout mon coeur. » (B. Auteurs).
[30] janv. 1893
[31] Janv. 1893, (Jacques des Gachons)
[32] Janv. 1893, (Ludovic Hamilo).
[33] Fév. 1893. Saint-Georges de Bouhélier et Maurice Le Blond venaient de fonder cette revue
[34] Entretiens politiques et littérairee, 10 janv. 1893. C’est bien ce premier aspect du Symbolisme dramatique que nous avons analysé, cidessus, p. 153.
[35] L’Année littéraire, huitième année, 1892, Charpentier-Pasquelle, 1893
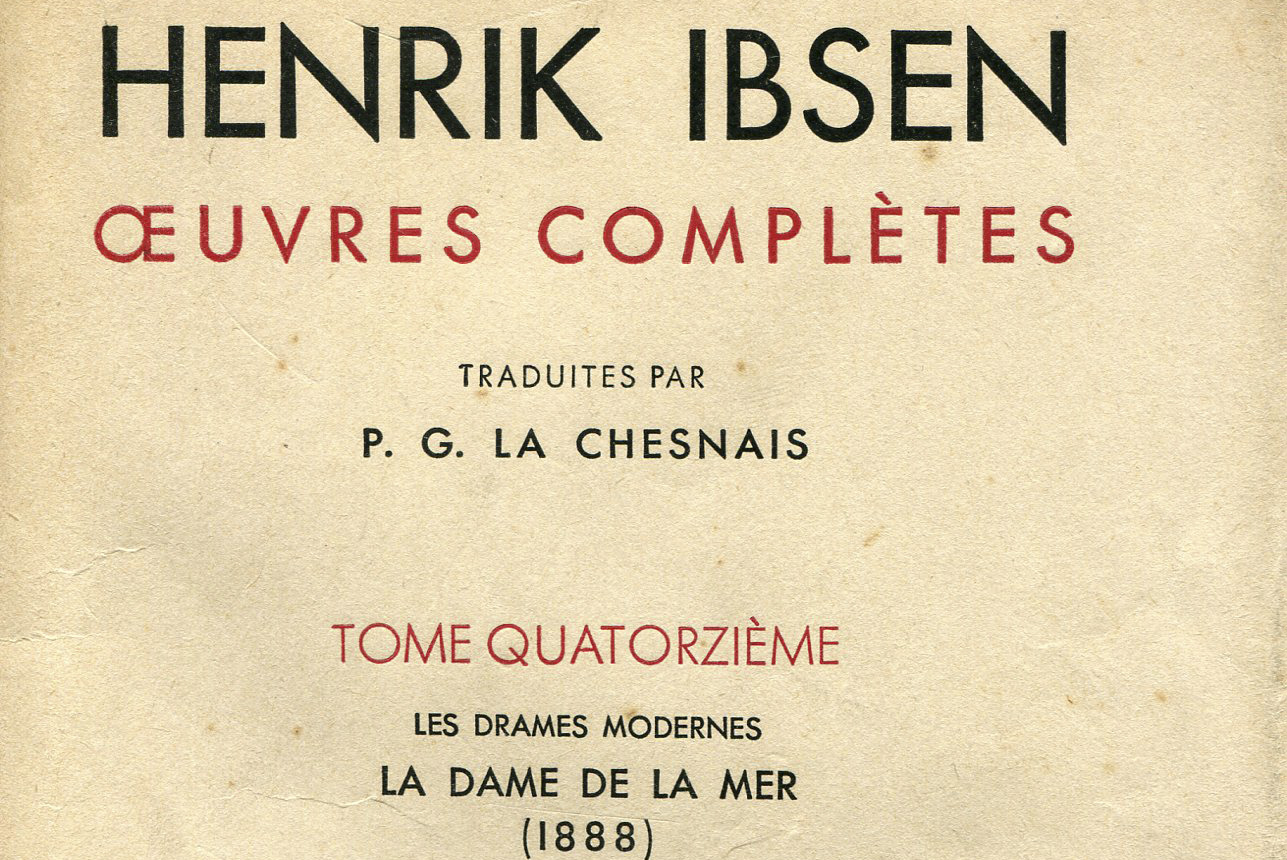
Pierre Georget La Chesnais
Œuvres complètes d’Henrik Ibsen, tome XIV
La Mer et les ondines / L'œuvre
Extraits des chapitres II et III [1]
La Mer et les ondines
Le 10 novembre 1886, Ibsen écrivit à Brandès : « Nous irons peut-être en Danemark l’été prochain. Nous avons tous deux grande envie de passer quelques mois à Skagen. J’espère donc que nous nous verrons à Copenhague[2]. » Skagen est une très petite station de bains de mer à l’extrême pointe du Jutland, où rien ne semblait pouvoir attirer particulièrement le ménage, et il est singulier qu’Ibsen ait pensé de si bonne heure à choisir l’endroit où il prendrait ses vacances. Il voulait évidemment retourner vers le Nord, et, après son expérience de l’année précédente, la Norvège était exclue. Il irait donc en Danemark, car, malgré ses théories sur le déclin du sentiment national, il demeurait, au fond, très scandinave. Mais pourquoi Skagen?
C’était la mer qui l’attirait, et peut-être aussi la curiosité de voir ce qu’était la vie dans une pareille station balnéaire pendant la saison, mais surtout la mer. Ibsen sortait d’une lignée de capitaines marchands, et, jusqu’à trente-six ans, avait toujours vécu dans des ports. À Grimstad, il s’était lié avec un pilote dont il a fait le portrait, et peut-être avec le mystérieux Terje Vigen dont il a conté l’histoire. Il avait la prétention de s’y connaître en matière de navigation, comme le montre l’article où il rectifie les opinions émises dans la presse au sujet d’un accident[3]. La mer avait sur lui un grand pouvoir d’attraction. Un jour, à Rome, visitant un atelier de peintre, il aperçoit la réduction d’un navire, et il se perd dans la contemplation de cet objet, plus rien n’existe pour lui[4]. A Rome et à Munich, la mer lui manquait. A Rome, Edmund Gosse raconte que, lorsqu’il avait cessé depuis longtemps de visiter ateliers et musées, il allait encore chez Nils Hansteen, peintre de marine, pour voir la mer[5]. Et de Munich, il écrivait le 16 juillet 188o : « De tout ce qui me manque ici, c’est l’absence de la mer dont j’ai le plus de peine à m’accommoder[6]. » Plus tard, ayant reçu d’Hélène Raff une marine qu’elle avait peinte, il accrocha le tableau dans son cabinet de travail, « afin de pouvoir, » écrivit-il, « gorger mon regard de la vue du large… J’aime la mer. Votre tableau met mes sentiments et ma pensée en rapport avec ce que j’aime[7]. »
Il croyait que ce sentiment était spécifiquement norvégien, et à un ami allemand il a dit : « Les gens, en Norvège, ont l’esprit dominé par la mer. Je ne crois pas que d’autres peuples puissent bien comprendre cela.» Cela est fort exagéré, mais il est vrai que cette fascination et domination de la mer, qui est assez rare ailleurs, même en Angleterre, est étonnamment fréquente en Norvège. Et Ibsen a rencontré bon nombre de personnes chez qui cette disposition prenait des formes curieuses, surtout des femmes. Ces ondines pouvaient lui servir de modèles pour sa prochaine « fantaisie », qu’il appela d’abord Havfruen. Ce mot, d’usage courant dans les légendes et chants populaires, est un mot composé qui signifie littéralement « la dame de la mer» et se traduit par « l’ondine ». Mais il l’a remplacé par Fruen fra havet, expression forgée par lui, et qui est exactement traduite par le titre habituel en français.
On ne sait quand lui est venue l’idée de cette pièce. Le plus ancien manuscrit est daté du 15 juin 1888, et Koht suppose que c’est le voyage en Jylland, qu’il fit en effet en été 1887, qui l’a décidé à prendre ce sujet[8]. Je croirais volontiers, au contraire, que ce voyage, auquel il a songé dès novembre 1886, a été résolu précisément parce que le sujet le tentait, et qu’un séjour au bord de la mer était indiqué pour en mûrir le plan. L’idée même était sûrement plus ou moins ancienne dans son esprit. On en trouve déjà une trace dans le manuscrit IV pour Le Canard sauvage, où il a écrit : « Les hommes sont des animaux marins[9]», et dans Rosmersholm, Brendel appelle Rebekka : « Ma séduisante ondine. » Il connaissait trop d’histoires, soit légendes, soit œuvres littéraires, soit histoires vécues, qui la lui suggéraient, et, habitué comme il l’était à imaginer une construction dramatique à propos de tout ce qu’il lisait ou entendait[10], il avait sans doute, d’avance, entrevu un plan.
Toutefois, en novembre 1886, il n’avait certainement pas encore l’idée arrêtée d’écrire précisément le drame de la mer, car il hésitait encore le 27 janvier 1887, où il se plaignait à Jonas Lie de sa grande correspondance, surtout en allemand :
Il ne peut être question, dans ces conditions, de trouver le temps et la tranquillité d’esprit nécessaires pour aborder sérieusement quelque nouvelle fantaisie (galskab) dramatique. Mais j’en sens plusieurs grouiller dans ma tête, et j’espère bien vers le printemps en mettre quelqu’une en œuvre.
Et celle-là devait « grouiller dans sa tête » depuis longtemps.
Même les arts plastiques contribuaient à aiguiller sa pensée vers la mer et les ondines. Arnold Boecklin, le peintre balois qu’Ibsen avait pu rencontrer à Munich, et dont l’art était un mélange de symbolisme romantique dans son inspiration, et de réalisme dans la facture, donc assez analogue à celui d’Ibsen, avait mis à la mode les motifs de ce genre, surtout par son tableau «Triton et Néréide », où l’on voit une sirène couchée sur la plage, et par son «jeu des vagues », de 1883, qui avaient été très discutés dans la presse, et dont Ibsen a certainement vu soit les originaux exposés à Munich, soit, du moins, les nombreuses reproducticns données dans les revues ou en montre dans les boutiques[11].
Grand amateur de chants populaires, il connaissait, naturellement, le chant danois «Agnete et l’Ondin», d’où Andersen avait tiré une pièce. Il a dû y penser, mais on ne voit pas ce qu’il aurait pu y prendre. Il n’avait pas besoin de cette légende pour attribuer à la mer un pouvoir d’attraction et de répulsion à la fois.
Mais l’ondine à laquelle sans doute Ibsen a pensé le plus était une personne réelle, et qui lui tenait de près. C’était Magdalene Thoresen, la belle-mère de sa femme[12]. Susannah Ibsen a déclaré elle-même que Magdalene était le modèle de la Dame de la mer[13], qu’Ibsen a d’abord appelée Thora, nom qui rappelle celui de son mari. On sait qu’elle était Danoise, mais se disait devenue entièrement Norvégienne, conquise par l’âpre nature du Sönnmöre, où elle avait passé les premières années de sa vie norvégienne, dans la petite île basse de Herb, où il n’y avait qu’une seule maison, le presbytère, tandis que les fidèles étaient dispersés dans les hautes îles rocheuses, plus grandes, à l’entour. Elle était d’ailleurs Norvégienne d’avance par sa passion de la mer. Fille d’un marin qui tenait un cabaret pour pêcheurs sur le petit Belt, elle était habituée à se baigner tous les jours, jusque tard dans l’automne, et nageait parfois très loin, et elle a continué à le faire jusque dans un âge très avancé. Elle croyait devoir à la mer sa santé d’esprit et de corps. Un écrivain danois a raconté une visite qu’il lui a faite lorsque, vieille, elle s’était retirée en Danemark, sur la côte : « A mon départ, la vieille dame tendit la main vers la mer, et dit : N’est-ce pas superbe, ici? Oh! j’appartiens à la mer. Elle attire, elle attire[14]. »
Et ce n’est pas seulement par son caractère d’ondine que Magdalene a été le modèle d’Ellida. Comme celle-ci, elle avait fait sans amour un mariage avantageux avec un homme beaucoup plus âgé qu’elle, et qu’elle avait fini par hautement estimer. Elle avait vécu chez lui très indépendante, s’occupant peu des enfants de son premier mariage, et pourtant admirée de l’un d’eux, qui était précisément Susannah, de même qu’Ellida est admirée par Hilde. Et surtout, elle avait eu avant son mariage une aventure sur laquelle les historiens de littérature norvégiens se montrent très discrets. Magdalene en a parlé elle-même dans ses lettres avec moins de discrétion, bien qu’à mots couverts. Le professeur Heegaard, de Copenhague, ayant passé ses vacances à Fredericia, où demeurait Magdalene chez ses parents, avait remarqué cette jeune fille, jolie de visage, et si bien douée, mais dont la vie très libre pouvait devenir dangereuse, et, avec une générosité parfaitement désintéressée, il l’avait fait venir à Copenhague pour lui faire faire des études tardives. Et pendant deux ans elle avait travaillé avec un zèle passionné. Elle raconte :
Pendant mes études à Copenhague, j’ai connu un jeune homme, une nature emportée, curieuse, une force de la nature. Il prenait des leçons avec moi, et j’ai dû me courber à terre sous sa formidable volonté démoniaque… Il aurait pu m’embarquer dans une puissante vie d’amour exclusif… je le crois encore… Toutefois je n’ai jamais regretté qu’il m’ait abandonnée, grâce à cela j’ai connu un homme meilleur, et j’ai mené une meilleure vie. Mais j’ai toujours bien su qu’il aurait pu faire épanouir et fructifier l’amour qui résidait en moi. Ensuite j’ai circulé avec le désir et le regret, je me suis accrochée tantôt haut, tantôt bas, n’ai constamment saisi qu’une ombre. Et la capacité d’amour n’a pas disparu avec les années, a grandi beaucoup plus[15].
On sait que le jeune homme dont elle parle est le poète islandais GriMur Thomsen, homme singulier, peu scrupuleux, qui est entré dans la carrière diplomatique, et a été attaché à la légation danoise à Paris. Vers 186o, on le voyait dans les salons de Copenhague, accompagné d’un élève de l’École navale d’origine inconnue, qui passait pour son fils, et que présentait Heegaard. Le jeune officier périt bientôt dans une croisière, et l’on dit que cette mort fut un suicide. Grimur Thomsen donna sa démission de bonne heure, et se retira en Islande, où il se maria et cultiva une ferme.
Magdalene, peu après la rupture avec Grimur Thomsen, vint tenir la maison du pasteur Thoresen, qui était veuf depuis peu, et l’épousa l’année suivante. Elle dit de cette union : «Thoresen était mon ami, mon père, mon frère [ … ] Il était un homme à qui je pouvais tout dire nettement et qui m’aurait compris. » Elle lui fit savoir avant le mariage qu’il y avait eu
«… un événement lamentable dans ma vie agitée (…). Mais le passé, où j’avais été une malheureuse ignorante mal protégée, ce qu’il m’était impossible d’expliquer à moi-même et aux autres,… je lui demandai de le considérer comme une lettre close et de s’en tenir simplcment à ma personne comme résultat de toute cette lutte, et – s’il m’en trouvait digne – de faire comme si tout le reste était effacé. Il l’a fait. »
On ignore dans quelle mesure Ibsen a été au courant de l’histoire de Magdalene Thoresen. Ce n’est pas à lui qu’elle .se serait confessée de la sorte. Si elle a pu écrire ainsi à Johanne Luise Heiberg, qui, elle aussi, avait épousé un homme beaucoup plus âgé qu’elle, et qu’elle a tenu en haute estime et affection, mais sans amour, c’est sans doute parce que les mutuelles confidences entre les deux femmes ont constitué un échange. Mais Ibsen n’a guère pu ignorer que sa belle-mère avait « un passé ». Curieux par nature, et adroit à s’informer, il est probable que son enquête n’a pas été sans résultat. Et c’est ainsi que Magdalene Thoresen ne lui a pas servi seulement comme bon spécimen d’ondine, mais a contribué à l’invention du scénario, et Grimur Thomsen est devenu le mystérieux « Étranger » fascinateur.
Et le scénario a été dans doute précisé dans l’esprit d’Ibsen par le souvenir d’un épisode du roman de Paul Heyse, Kinder der Welt. C’était l’œuvre principale de ce romancier ami de Brandès, et qui tenait une place importante dans la littérature allemande, au moment où Ibsen s’est installé à, Munich. Ibsen l’a beaucoup fréquenté dans les premières années de son séjour dans cette ville, et il est infiniment probable qu’il a lu ce livre[16]. La façon dont il en parle dans une lettre à Brandès semble même indiquer qu’il l’avait déjà lu avant de se fixer à Munich[17].
Le cinquième livre de Kinder der Welt est l’histoire de Toinette, qui a épousé un comte, bien qu’elle aimât Edwin; le ménage est malheureux, le comte est ardemment amoureux de Toinette, mais il lui cause une répugnance croissante. Ils ont eu un enfant qui est mort à sept mois, la mère a éprouvé une telle répulsion à voir combien l’enfant ressemblait à son père qu’elle refuse ensuite de mener vie commune avec le comte, et en arrive à un état d’extrême nervosité, qui confine à la folie. Alors le comte invite Edwin, qui dans l’intervalle est devenu professeur de lycée, à venir le voir. « Peut-être un autre confierait son malheur domestique à n’importe qui plutôt que précisément à vous, mais je vous sais homme d’honneur, et incapable de sentir une égoïste joie maligne venant chez moi et en voyant la femme que votre ancien rival n’a pas su rendre heureuse. D’ailleurs je ne me soucie guère de moi-même, et je ferais n’importe quoi pour détourner de ma femme le grand danger qui la menace. »
Edwin arrive le soir au château du comte; la comtesse ne se montre pas, mais quand Edwin va faire une promenade nocturne solitaire du côté de l’étang du parc, il l’aperçoit qui va, enveloppée d’un manteau, vers la cabine de bain. Un instant après, elle est debout, déshabillée, les cheveux défaits, sur la marche de la cabine, et se jette dans l’eau. «Avec de longs mouvements assurés, la nageuse fendit les vagues, levant seulement la tête et les épaules pour écarter de son front son épaisse chevelure [ … ] Puis l’étrange ondine nagea dix ou douze fois d’un bout à l’autre de l’étang. [ … ] Enfin, elle parut fatiguée. Elle semblait se laisser insensiblement entraîner vers le fond. Sa tête s’enfonçait de plus en plus bas dans l’eau silencieuse. Lorsque enfin des bulles bruirent autour du corps qui sombrait, elle se retourna brusquement, et, en trois brasses vigoureuses, regagna la cabine. » Le lendemain, Edwin peut causer avec elle, et l’entend raconter la crise qu’elle a subie à la naissance et à la mort de l’enfant. Il propose ensuite que le comte rende sa liberté à sa femme, mais son conseil est froidement repoussé. Quelque temps après il est informé que Toinette s’est suicidée.
Les ressemblances sont telles entre Ellida et Toinette, entre Edwin et Arnholm, et entre les attitudes du comte et du docteur Wangel, que le rapprochement s’imposerait, même si l’on n’avait pas une raison très probable de croire qu’Ibsen a lu Kinder der Welt. Les différences sont grandes, pourtant. Arnholm n’est pas, comme Edwin, l’amoureux dont la pensée hante l’esprit de l’ondine : à cet égard, il sera remplacé par «l’Étranger». Edwin sera ainsi décomposé en deux personnages distincts, dont l’un, le plus important, ne lui ressemble pas du tout. Et le docteur Wangel, n’a pas à refuser le conseil de rendre sa liberté à Ellida, qu’Arnholm ne lui donne pas. Au contraire, il rend sa liberté à sa femme, et cela spontanément: à la manière ibsénienne, le dévouement désintéressé du docteur Wangel sera poussé jusqu’au bout.
On voit qu’Ibsen connaissait la puissance d’attraction de la mer à la fois par lui-même et par un exemple typique familier, et il était naturellement porté vers le sujet de La Dame de la Mer par ses réflexions tant sur des faits réels que sur des œvres littéraires. Le scénario était contenu dans ces faits et ces œuvres. Et l’idée de la pièce le tentait, parce qu’il s’agissait du problème moral posé par l’invitation d’Edwin au comte à rendre sa liberté à sa femme, problème que Paul Heyse avait esquivé ou traité d’une façon banale. Ibsen n’avait donc pas besoin d’une saison au bord de la mer pour y trouver, par hasard, la suggestion d’une pièce nouvelle. Si, comme j’ai tendance à le croire, il pensait à l’écrire déjà en novembre 1886, lorsqu’il disait à Brandès son désir de passer l’été à Skagen, il voulait simplement, pour en méditer le plan, se placer dans l’ambiance la plus favorable. C’était un motif suffisant pour lui, car il attachait grande importance à l’influence du milieu et du paysage.
Dans les premiers jours de juillet, il alla directement non pas à Skagen, où il craignait de rencontrer certaines coteries d’artistes[18], mais à Frederikshavn, port plus important, et y resta une dizaine de jours, pour aller finalement s’installer le 15 juillet dans la petite station balnéaire de Sœby, éloignée des routes des touristes, où il resta un mois et demi, et fut enchanté de son séjour. Le 13 août, il écrivait à Hegel :
« Le Jylland est un pays charmant pour y passer l’été. Les gens sont accueillants et aimables; nous voyons tous les jours la mer libre à proximité immédiate, et le temps, cette année, est le plus beau que l’on puisse désirer. Ncus avons habité ici, à Sœby, depuis quatre semaines, et comptons y rester encore quelque temps[19]. »
La mer libre, « ouverte » : ce n’était pas la mer telle qu’il la connaissait en Norvège, où la vue est presque toujours limitée par les îles du Skœrgaard. C’est pourquoi il a pu dire que, cet été-là, il avait «découvert la mer », et dans sa pièce, dont l’action, bien entendu, est située en Norvège, à l’embouchure d’un fjord, son ondine se plaindra de n’avoir pas devant elle la vraie mer, la mer « ouverte ». Ibsen ne pouvait rassasier ses yeux de cette vue. Un correspondant écrivit à un journal : « On peut rencontrer parfois Ibsen dans les bois, mais surtout on est sûr, dans la matinée, de le rencontrer près du port, où il reste souvent debout, immobile, pendant des heures à regarder le Kattegat. Et pendant l’après-midi, il fait volontiers de nouveau une promenade vers le port[20]. » Des Danois qu’il ne connaissait pas venaient à Sœby tout exprès pour l’entrevoir, comme J. P. Kristensen Randers et Peder R. Môller, qui ont longuement causé avec lui et louent « son amabilité naturelle et sa simplicité[21]». Il causait aussi avec les gens, et faisait des études sur les baigneurs et sur ce que signifie la saison pour les habitants d’une petite localité comme Sœby. Une jeune Danoise qui aimait rester des heures assise sur la plage à rêver tout en travaillant à quelque ouvrage, a raconté plus tard qu’elle avait souvent remarqué «un petit homme aux larges épaules, à favoris gris et en lunettes. Debout, tenant la main au-dessus de ses yeux, il contemplait la mer. Il avait une canne sur laquelle il s’appuyait lorsqu’il sortait un calepin où il écrivait. A la distance d’où je l’observais, je croyais qu’il dessinait la mer ». Ibsen aussi l’avait vue, et avait remarqué son beau regard enthousiaste. On entra peu à peu en conversation, elle dit son désir de voyager et son goût du théâtre, où elle entra, en effet, par la suite, et il lui annonça qu’elle aurait place dans sa prochaine pièce; et lorsque, plus tard, ils se rencontrèrent par hasard dans la rue, à Kristiania, il paraît même qu’il l’appela « ma Hilde ». « Il est bien possible, dit Francis Bull, que certaines répliques de Hilde Wangel dans La Dame de la Mer proviennent des conversations d’Ibsen avec Engelke Wulff à Sœby[22]. »
William Archer, revenant de Norvège, fit un détour pour rendre visite à Ibsen à Saeby, où il le trouva installé à l’hôtel dans un appartement composé d’un très vaste salon et de deux chambres. Ibsen s’était beaucoup plu à Frederikshavn, où il causait avec les matelots et passait de pleines journées au bord de la mer, dont il trouvait le voisinage, disait-il, « favorable à la contemplation et à la pensée constructive». A Saeby, la mer était un peu moins accessible, mais Mme Ibsen ne trouvait pas de promenades agréables à Frederikshavn, et le séjour à Saeby était « une sorte de compromis entre elle et lui ». William Archer passa toute une journée à Sœby, et Ibsen lui dit qu’il espérait avoir une « fantaisie » achevée l’année suivante. Le critique anglais résume ainsi ce qui paraît l’avoir le plus intéressé dans la conversation :
« Il semble que l’idée d’une pièce se présente généralement avant les personnages et la fable, bien que, lorsque je le lui dis en propres termes, il le nia. Il semble pourtant résulter de ses dires qu’il y a un certain stade de l’incubation de ses pièces où elle pourrait aussi bien donner un essai qu’un drame. Il a, pour ainsi dire, à incarner les idées en personnage et fable, avant que l’on puisse dire vraiment commencé le travail de création proprement dit. Il reconnaît que plusieurs plans et idées s’entremêlent souvent, et que la pièce finalement écrite s’écarte parfois beaucoup de l’intention du début[23]. »
Ibsen avait également reçu, à Frederikshavn, la visite de Henrik jaeger, enfin venu pour recueillir des renseignements en vue de la biographie d’Ibsen qu’il préparait, et Ibsen lui dit que la mer jouerait un rôle dans son prochain ouvrage[24].
De tels propos, tenus au bout de quelques semaines passées en contemplation de la mer danoise « ouverte » et paisible, rendent difficile de croire que la pièce dont il parlait n’avait pas été conçue avant son arrivée, car il n’avait pas coutume de parler de ses projets avant qu’ils fussent mûris. Et l’idée d’introduire Mlle Wulff dans sa pièce paraît montrer un état déjà passablement avancé.
Il s’enquit aussi d’une jeune fille singulière, Adda Ravnkilde, qui avait vécu à Soeby et s’y était suicidée à vingt et un ans en 1883, après une vie de hautes aspirations déçues par l’étroitesse du milieu provincial, et à la suite d’une lutte vaine pour surmonter, semble-t-il, l’amour que lui avait inspiré un homme qu’elle jugeait indigne d’elle, et c’est pourquoi elle avait mis fin à ses jours d’une triple façon : en absorbant un poison, se coupant l’artère du poignet, et se tirant un coup de revolver dans la tempe. Elle laissait les manuscrits de trois romans qui ont été publiés peu après sa mort, le premier avec une préface de G.Brandès, et qui méritaient de l’être, car on y découvre une nature artiste des plus douées, mais dont la qualité essentielle était l’intelligence, si bien que ces ouvrages d’une si jeune fille témoignent d’une invraisemblable maturité d’esprit. Ibsen a lu ses livres et s’est vivement intéressé à son histoire, au point de visiter sa maison et d’aller sur sa tombe[25]. Il fut sans doute frappé de voir qu’elle traitait, en somme, les mêmes problèmes que lui, et un peu dans le même esprit, opposant, par exemple, dans « Une victoire à la Pyrrhus », l’idée traditionnelle d’un mari qui veut que tout se rapporte à lui dans le ménage, au désir qu’a sa jeune femme d’avoir, comme écrivain, une vie personnelle. Et il n’est pas impossible que cela ait suggéré à Ibsen l’ingénu égoïsme masculin de Lyngstrand. Mais c’est surtout la vie d’Adda Ravnkilde qui a sans doute inspiré à Ibsen ce qu’il dit dans ses notes de l’étroitesse de l’existence dans une petite ville comme Sœby (P. 244).
Au total, on ne peut pas dire que le séjour d’Ibsen dans le Jylland ait compté beaucoup pour La Dame de la Mer, à part la forte impression du contraste entre la mer danoise « ouverte » et la mer norvégienne, où la vue est presque partout bornée. Tous les éléments importants de la pièce étaient acquis avant le voyage, et Sœby n’a même fourni que peu de détails.
« L’Œuvre»
(…) Cependant, la publication du livre une fois résolue, Ibsen s’y intéresse, il veut éviter que Jaeger puise à de mauvaises sources, comme Ludwig Passarge[26], il veut surtout que Jaeger vienne le voir, et se plaint à Hegel, pendant le séjour à Sœby, de n’avoir pas encore de nouvelles de son biographe [27]. Enfin Joeger, averti, vient le voir à Frederikshavn à la fin d’août, et Ibsen ne put qu’être satisfait d’un ouvrage auquel il avait lui-même apporté une forte contribution, car la plupart des renseignements nouveaux proviennent de lui. Il remercia l’auteur «très cordialement »[28].
Interrogé par Jaeger, il avait rendu compte amplement de sa méthode de travail, qu’il a peut-être appliquée plus strictement encore que d’habitude à La Dame de la Mer, après l’avoir exposée. Elle consistait, comme on sait, en longues méditations qui précédaient tout travail d’écriture. Le plus ancien manuscrit relatif à sa nouvelle pièce est daté du 5 juin 1888. Il y avait environ dix mois qu’il avait dit à Henrik -ger que la’ mer y tiendrait une grande place, et depuis huit mois, revenu à Munich, il n’avait été dérangé dans son travail que par la célébration de son soixantième anniversaire. Même, si, ce qui me paraît fort vraisemblable, l’idée de la pièce est plus ancienne, suggérée par son attraction personnelle vers la mer et 1a connaissance d’une ondine telle que Magdalene Thoresen, puis ravivée non par la contemplation du Kattegat en 1887, mais par le séjour à Molde en 1885, il faut compter que la période des méditations a commencé peu après qu’il fut quitte de Rosmersholm, et par conséquent a duré environ un an et demi.
De toute façon, la lacune est grande dans l’histoire de la gestation de la pièce. Il est probable qu’Ibsen a supprimé une partie de ses notes, et pas seulement des notes courtes comme celles que lui a vu prendre Engelke Wulff à Soeby. Les manuscrits que nous avons sont un aboutissement. Et ils se succèdent rapidement, car le troisième, qui est le brouillon de la pièce entière, est daté du io juin, cinq -ours après le premier. Cela rend le secbnd assez singulier, car il comprend, de même que le premier, une indication de la suite des scènes du premier acte. Mais c’est le premier qui est ensuite suivi dans le grand brouillon, non le second. Et bien que celui-ci ne soit pas daté, on ne peut guère douter que sa place chrono logique est bien en second, notamment parce que les noms des personnages y apparaissent, alors qu’ils sont désignés dans le premier manuscrit par leur profession. Il semble qu’Ibsen, si près de l’écriture du brouillon, se demandait s’il ne pourrait pas introduire dans le premier acte la scène importante où Wangel apprendrait de sa femme qu’elle a été autrefois fiancée, et qui ne figurait pas dans le plan minutieux de ce premier acte donné par le manuscrit 1. C’est pourquoi il a repris, sous une forme très sommaire, le plan de ce premier acte, à partir du moment où cette scène serait introduite, et a continué l’esquisse du plan jusqu’à la fin de la pièce, ainsi réduite à quatre actes. Sur les autres différences qui pouvaient exister dans l’esprit d’Ibsen, entre ce plan ébauché et la suite du plan incomplet du manuscrit 1 on ne pourrait rien dire, si le manuscrit 1 ne débutait pas par une série de notes assez décousues, mais dont l’analyse est pleine d’indications fort intéressantes.
En ce qui concerne le scénario et le mouvement de la pièce, on y voit qu’Ibsen pensait à multiplier les personnages, et à donner un tableau de la vie estivale pendant la saison des bains, dans une petite station où la saison est la seule période vivante, ce qui fournit une image de la vie : « Un clair jour d’été avec les grandes,ténèbres ensuite,… c’est tout. » Ceci, avec la plupart des personnages épisodiques, a disparu par la suite, même, semble-t-il, dès l’écriture de la seconde partie du manuscrit 1. Des observations recueillies à Sœby sur la saison balnéaire, il ne restera que certaines répliques de Ballested. Et l’ancien « fiancé » de l’ondine est, dans le manuscrit, un « passager étranger » venu pour prendre des bains à cause du surmenage d’une vie manquée. On s’étonne de retrouver ainsi désigné un personnage aussi différend de celui qui surgit àcôté de Peer Gynt au commencement du cinquième acte de ce poème dramatique déjà si ancien. Ce nouveau « passager étranger » devient, dans le manuscrit II, Johnson, « l’Américain », qui a tué autrefois le second du navire où il était employé, dès le manuscrit II. Il ne fait plus que passer deux fois, comme « l’étranger » de l’œuvre définitive. Il est vraisemblable que ce changement a été résolu au cours de l’écriture, à la fin de la première partie du manuscrit I, de l’histoire contée par « le sculpteur ». Changement sans doute envisagé antérieurement parmi les alternatives possibles, mais décidé peu dejours avant d’aborder le brouillon.
L’histoire contée par « le sculpteur » était suggérée à Ibsen par des récits qu’il avait entendus à Molde. Une dame du Nordland lui avait parlé d’un kvène qui, par la puissance magique de son regard, avait amené la femme d’un pasteur à quitter son mari et ses enfants pour le suivre. Un kvène, c’est-à-dire un émigré de Finlande dans le Finmark norvégien, fait toujours penser à de la sorcellerie[29]. Et Ibsen combina cette aventure avec celle d’un marin qui, après de,longues années d’absence, était cru mort, et qui finit par revenir, et trouva sa femme mariée avec un autre[30].
Et dans le manuscrit 1 on voit aussi que le décor est norvégien. L’action se passe au bord d’un fjord, d’où la vue s’étend sur une chaîne de hautes montagnes. Ce n’est pas la douce mer danoise « ouverte » qui baigne la petite ville, c’est la mer norvégienne où « toutes les passes sont fermées », comme le dit Ballested, citant un vers d’Oehlenschlâger dans Haakon jarl. Plus précisément, sans qu’il l’ait dit nulle part, c’est à Molde qu’Ibsen a pensé. L’étang à carpes, qui figure au troisième et au cinquième actes, existait même dans le parc de Moldegaard, qu’Ibsen avait plusieurs fois visité. Ballested, qui est Danois et a un trait de caractère spécifiquement danois 1 demeure comme un souvenir isolé de Sœby, bien qu’il ait en peut-être un modèle à Bergen[31]. Et la mer « ouverte » existe au moins comme un regret de l’ondine.
Le décor norvégien avait été sans doute choisi par Ibsen dès le début. A part cela, les manuscrits I et II montrent qu’il n’est parvenu à établir le plan de sa pièce qu’au commencement de juin, et qu’alors il s’est mis tout de suite à écrire son brouillon, qui a comporté des modifications nombreuses, mais aucune vraiment importante, du moins en ce qui concerne le plan. Et le changement de la dernière heure a consisté à remplacer le « passager étranger », personnage réaliste, semble-t-il, ancien marin qui vit sur terre et soigne ses nerfs, par le mystérieux Johnson, qui apparaît soudain, venant de la mer. Seulement, faute de manuscrits antérieurs, écrits au cours de la longue période de méditations, on ne peut savoir si ce changement du manuscrit 1 au manuscrit II a été un choix ultime ou une invention nouvelle.
Outre les indications sur le plan de la pièce, le manuscrit 1 comprend des réflexions sur la mer et la fascination qu’elle exerce, plus une esquisse du caractère de l’ondine, et le rapprochement de ces deux parties montre que la conception d’Ibsen n’était pas encore parvenue à maturité. A propos de la mer, en effet, il se met à rêver. Elle est mystérieuse. Il en parle à la fois en termes vagues et en termes précis. A Hâckel il emprunte l’hypothèse que l’homme a été primitivement un être marin, et il parle du pouvoir hypnotique de la mer, à un moment où l’hypnotisme, grâce aux études de Charcot, était une nouveauté scientifique. Il satisfait ainsi sa double tendance à un strict réalisme et à la rêverie sur les phénomènes qui semblent le plus inexplicables. C’est là ce qui donne leur caractère particulier à ses symboles. La mer le fait songer « à la dépendance de la volonté, de l’homme à l’égard de ce qui est sans volonté ». Et tout cela mène logiquement la pièce à sa forme définitive, où se multiplieront les effets d’hypnotisme, de communication de pensée à distance, etc. Par contre, l’ondine ne répond pas encore à l’orientation d’esprit ainsi manifestée. Elle a refusé les fiançailles avec le jeune marin, poussée par son père, il est vrai, mais « aussi de bon gré », parce qu’elle ne s’est pas débarrassée des préjugés qu’elle a nécessairement acquis dans sa famille, son père étant pasteur. Et pourtant, si le jeune marin « léger » avait été congédié, du moins n’avait-il pas commis de crime. Le problème moral, dans la pièce telle qu’Ibsen la concevait encore le 5 juin 1888, était donc bien différent de ce qu’il est devenu dans tout le brouillon commencé cinq jours plus tard, où il n’est pas un instant question de préjugés sociaux ou moraux, mais seulement de forces inconscientes qui troublent l’âme de l’ondine, et dont Wangel parvient à l’affranchir en lui rendant la liberté. Il n’y a, sur ce point, aucune différence essentielle entre le brouillon et le texte définitif. On peut seulement noter que dans celui-ci est introduite la formule : « Maintenant tu peux choisir. Et sous ta propre responsabilité, Ellida. » C’est une précision, non une idée nouvelle, ni un changement.
Ibsen, cette année-là, ne bougea pas de Munich, afin d’achever sa pièce. Selon son habitude, Ibsen a noté sur le brouillon la date du commencement et de la fin de chaque acte :
Acte I……… 10.6.88 / 16.6.88
II ……… 21.6.88 / 28.6.88
III…………… 2.7.88 / 7.7.88
IV……………12.7.88 / 22.7.88
V…………… 24.7.88 / 31.8.88
Il a ensuite procédé à la révision de ce brouillon, et récrit sur des feuilles à part de nombreux passages, qu’on trouvera sous les numéros IV (P. 300) ‘et VI (P. 302). Et sur le brouillon, il a encore noté que la révision de l’acte II était terminée le 18 août, celle de l’acte III commencée le 2o août, et celle de l’acte IV commencée le 31 août. D’où il’suit que la révision de chaque acte lui prenait à peu près autant de temps que l’écriture.
Puis est venue la mise au net, qui a été achevée vers la fin d’octobre, et il put écrire à G. Brandès le 30 : « Après de nombreux mois de travail incessant sur une nouvelle pièce en cinq actes, qui est maintenant achevée,… » De la pièce elle-même, d’ailleurs, il ne dit rien. Le volume parut le 28 novembre, tiré à 10 000 exemplaires.
On a vu que l’ondine a eu plusieurs modèles, dont Magdalene Thoresen était le principal. C’est sans doute pourquoi Ibsen l’a d’abord appelée Thora (ou Tora, un peu plus tard). Mais il ne copiait pas d’après nature, et le personnage a sensiblement varié. Finalement, à partir du cinquième acte du brouillon, elle est devenue Ellida, bien que ce mot, en vieux nordique, soit masculin. Il signifie « celui qui va dans la tempête », et c’est, dans la Saga de Frithio de Tegner, le nom du vaisseau de Frithiof, vaisseau magique, offert par Egir, dieu des vents, à Viking, qui l’avait sauvé. Le navire promis par Egir était venu le lendemain, de lui-même, sans équipage, se présenter à Viking, et Frithiof, petit-fils de Viking, en avait hérité. Aucun nom ne pouvait mieux convenir à l’ondine fascinée.
Une grande amie d’Ibsen, Camilla Collett, a cru se reconnaître dans Ellida, précisément parce qu’elle avait elle-même subi une fascination qui lui parut analogue à celle qu’exerce « l’étranger » dans la pièce, en sorte que, pour elle, le modèle de l’étranger fut le poète Welhaven,. Elle affirmait tranquillement, comme un fait incontestable, qu’elle était le modèle d’Ellida, et lorsqu’on lui objectait qu’elle n’avait jamais montré une particulière attraction vers la mer, elle répondait que la mer, dans la pièce, représente Ejdsvold, où elle avait passé sa jeunesse à courir dans les bois qui bordent la Vorma.
Elle écrivit à Ibsen le 24 février 1889, de Copenhague :
Cher Ibsen
J’ai été mardi au théâtre et j’ai vu La Dame de la Mer. Oui, qu’en dire! C’était la pièce d’Ibsen et ce n’était tout de même pas la pièce d’Ibsen. je crois que ce drame est, de tous les vôtres, celui qui peut le moins être joué par des acteurs danois. Les Danois ont peine à s’imaginer et à comprendre l’effet que peut produire une nature comme la nôtre.
Et pourtant la pièce a produit sur moi, ce soir-là, une puissante impression, peut-être la plus puissante de tout ce que j’ai vu de vous à la scène, Ibsen.
Je suis moi-même une sorte de « Dame de la Mer », ou bien appelezmoi: « La Dame du fond du fleuve » – des profondes vallées ombreuses d’Ejdsvold. Pendant une longue série d’années de jeunesse, j’y ai circulé dans une rêverie solitaire, si bien que j’ai fini par me familiariser avec les nymphes mêmes de la vallée, et j’ai été poussée à en jouer le rôle devant les autres … oh! j’aurais dû jouer La Dame de la Mer, et précisément ce rôle-là! …
Et ne croyez pas que « l’étranger » manquait dans cette vie sauvage de nature. J’entendais sa voix dans le murmure du Peuve, son image surgissait derrière tous les buissons, m’attirait et m’effrayait, jusqu’au moment où ce dernier effet est devenu le plus fort. Moi aussi j’ai eu la force de rejeter une influence démoniaque et de « choisir en liberté ».
Je comprends maintenant votre dernière œuvre superbe et magnifique, Ibsen, oh! Peu de gens la comprennent comme moi. Dans « l’étranger », vous avez symbolisé cet amour aveugle, sans racine… et sans critique, de l’aspiration de la jeunesse.
Produit de l’imagination, ce démon qui a écrasé d’innombrables cœurs, détruit d’innombrables existences, soit que la déception réside dans le renoncement avant une union, soit – et c’est le pis – qu’elle se produise dans l’union même, lorsque celle-ci, cas très rare, a lieu. Nos ménages nordiques ne se prêtent pas à donner gîte à ces sortes de tendres plantes, il y faut un autre climat.
Je comprends mieux aussi maintenant votre Comédie de l’Amour,. je ne l’avais pas comprise auparavant. Svanhild et Falk s’aiment, mais seulement avec un sentiment d’imagination, sous l’influence hypnotique-démoniaque de ce sentiment; dans un mariage, ce genre de sentiment ne suffirait Das.
C’est cet « amour aveugle» – fondé, en ce qui concerne l’homme, sur un simple plaisir sensuel, en ce qui la concerne, sur quelque forte contrainte démoniaque – parfois signe de la force brutale, de l’égoïsme sans scrupules – mais où, hélas! – la vraie capacité d’amour profond, chez elle, souvent s’abîme et se perd – c’est ce monstre, ce dragon, qu’il s’agit de combattre, ceuvre d’avenir.
Nous avons en vous un saint George.
Il faudra des relations plus libres, une plus vraie compréhension l’un de l’autre, une plus profonde connaissance mutuelle – une plus grande indépendance du côté de la femme – afin d’éviter les dangers de cette indépendance – et laisser les deux parties librement choisir, après mûre réflexion – et sous leur propre responsabilité.
Si vous aviez écrit La Dame de la Mer il y a quarante ans, je crois que j’aurais été au théâtre – hélas! non – je ne comprenais pas le rôle dans ce temps-là.
Adieu! Et cordial salut à madame Ibsen.
Camilla COLLETT[32].
A cette lettre où Camilla Collett considérait La Dame de la Mer comme une exacte interprétation de sa propre histoire, Ibsen répondit par une approbation de forme assez évasive :
Permettez-moi donc aujourd’hui de vous adresser en quelques mots mon plus cordial remerciement pour la compréhension que La Dame de la Mer a trouvée chez vous.
Que je pouvais compter précisément de votre part avant tout sur une telle compréliension, je m’en sentais d’avance assez certain. Mais j’ai été indiciblement ravi de voir cet espoir confirmé comme il l’a été par votre lettre.
Oui, il y a des points de contact. Beaucoup, même. Et vous les avez vus et sentis. Je veux dire, ce qui pour moi ne pouvait être que vague ment connu.
Mais il y a longtemps que, par le cours de votre vie intellectuelle, vous avez commencé, sous une forme ou une autre, à intervenir dans mon œuvre[33].
Ibsen savait, bien entendu, que Camilla Wergeland avait été passionnément éprise de Welhaven. Le fait était notoire. Et il avait sans doute beaucoup réfléchi à cette histoire. Mais il ne pouvait guère la connaître qu’assez vaguement, comme il le dit dans sa lettre. Et lorsque John Paulsen publia que Camilla lui avait raconté sa conviction d’être le modèle d’Ellida, Mme Ibsen eut raison de lui dire que Magdalene « devait être considérée comme le véritable modèle de la Dame de la mer[34] ».
D’autres personnages ont aussi des modèles ou sont des figures auxquelles Ibsen avait déjà pensé pour des œuvres antérieures. Ainsi le sculpteur poitrinaire paraît bien être le peintre allemand Deininger, qui, dans la première note pour Le Canard sauvage, devait fournir un épisode non précisé.
Les deux filles du docteur Wangel ont précisément les caractères opposés qu’Ibsen avait attribués aux deux filles que Rosmer, dans la première note pour Chevaux blancs, avait eues de son premier mariage[35]. Et la plus jeune de ces deux filles, Hilde, a au moins un trait emprunté à Susannah Ibsen, qui admirait Magdalene Thoresen. En sa jeunesse, « elle avait une passion pour sa jolie belle-mère si remarquablement douée, qui absorbée par ses fantaisies, faisait peu attention à elle[36] ». On a vu que la jeune Danoise Engelke Wulff était aussi, plus ou moins, un modèle de Hilde.
Mais on ne voit pas qu’Ibsen, comme il l’a fait si souvent, se soit pris lui-même comme modèle, au moins partiel, d’aucun des personnages de La Dame de la Mer. C’est peut-être, en ce sens, la pièce la plus objective qu’il ait écrite. L’attraction vers la mer, qui la lui a suggérée, il est vrai, avait toujours été chez lui un sentiment personnel, et il y a introduit un détail autobiographique dans les fiançailles d’Ellida, lorsque « l’étranger » réunit la bague de la jeune fille et la sienne dans un anneau qu’il jette à la mer. Lui-même s’était fiancé de la sorte avec Rikke Holst[37]. Mais à part cela, il ne figure pas dans la pièce.
L’objectivité, d’ailleurs, devait nécessairement dominer dans une pièce où le personnage absolument principal était une femme. Et la femme, à cette époque de sa vie, l’occupait tout spécialement. Déjà, dans Rosmersholm, le rôle de Rebekka, au détriment de Rosmer, avait peu à peu grandi en importance, et le drame qui suivra La Dame de la Mer sera Hedda Gabler.
C’est en observateur réaliste qu’Ibsen a étudié les types de femmes qu’il a mis en scène. Dans ses drames de la période polémique, elles étaient des révoltées, comme Lona Hessel, Nora et Mme Alving, parce qu’elles étaient plus instinctivesque les hommes, en sorte que la révolte leur était plus naturelle. Maintenant qu’Ibsen, curieux de phénomènes mystérieux et inexpliqués, du « sixième sens et de son influence », comme il le dit dans sa première note pour Le Canard sauvage[38], recherchait surtout des psychologies singulières, il était naturel que l’instinct de la femme, moins altéré par la contrainte sociale, la fît passer au premier rang parmi les personnages de ses pièces’[39].
Son analyse de certains caractères féminins était si pénétrante que des femmes auxquelles il avait sans doute peu pensé en écrivant La Dame de la Mer, comme Camilla Collett, croyaient se reconnaître en Ellida,, et telle autre à qui certainement il n’avait pas pensé du tout écrivait dans son journal mainte réflexion qu’Ibsen aurait pu mettre dans la bouche d’Ellida. C’était le cas de la romancière suédoise Ernst Ahlgren, qui s’est suicidée quelques mois avant la publication de La Dame de la Mer[40]. Et Anne Charlotte Leffler pouvait écrire : « Que penses-tu de La Dame de la Mer? Dans son caractère, ses aspirations, et même dans ses rapports avec son mari, j’ai reconnu beaucoup de moi-même, du moins telle que j’ai été pendant les nombreuses années où j’étais enfermée dans le fjord. Aujourd’hui je suis arrivée à la « mer libre» Il semble qu’Ibsen avait découvert des particularités de la psychologie féminine qui se trouvaient accentuées en Scandinavie à cette époque, et il se trouvait d’accord avec les travaux scientifiques du même moment, surtout ceux de Pierre Janet. C’est pourquoi plus tard, il a été considéré comme un précurseur de Sigmund Freud. La façon dont Ellida est finalement libérée de son obsession est en effet un bel exemple de cure psychanalytique. Mais, bien entendu, c’était sous son aspect moral qu’il avait envisagé le cas, et c’était, une fois de plus, les problèmes de la volonté et de la liberté qu’il avait traités.
[1] Œuvres complètes Tome XIV (Plon, 1947)
[2] Breve, Il, p. 165.
[3] Tome V, p. 548.
[4] John Paulsen, Samliv med Ibsen, 1906, pp. 152-153.
[5] Edmund Gosse, Henrik Ibsen, p. 179.
[6] Breve, II, p. 84.
[7] Lettre du 30 mars 1892, Samtiden, igo8, p. io6.
[8] Halvdan Koht, Henrik Ibsen, eit diktar-liv, II, p. 278.
[9] Tome XIII, P. 274. Ibid., p. 630.
[10] C’est ainsi que, Jonas Lie lui ayant exposé la fable du roman qu’il écrivait, Ibsen lui dit aussitôt, acte par acte, comment elle pourrait être transformée en drame.
[11] E. Zucker, Ibsen, the masterbuilder, P. 228.
[12] Sur Magdalene Thoresen, voir tome 111, PP. 72-78.
[13] Clara Bergsbe, illagdalene Thoresen, p. 8o.
[14] Cité d’après Francis Bull, dans Hundreaarstutgare, XI, p. 26.
[15] Lettre du 28 avril 1867 à Johanne Luise Heiberg, dans Breve fra Magdaleme Thoresen.
[16] J’avoue n’avoir pas lu Kinder der Welt. La difficulté actuelle des communications m’a empêché de m’en procurer un exemplaire. C’est pourquoi l’exposé qui suit est emprunté à Francis Bull (Hundrearsutgaven, XI, PP. 33-35). Les ressemblances entre le cinquième livre de Kinder der Welt et La Dame de la Mer avaient été signalées par Just Bing (Tilskueren, 1906, p. go6).
[17] Lettre du 30 janvier 1875, Breve, Il, P. 25.
[18] Francis Bull dans Hundreaarsutgave, XI, p. 18.
[19] L. C. Nielsen, op. cit., II, P. 382.
[20] Dagbladet, 1887, n, 290.
[21] Tilskueren, 19,7, PP. 504-511
[22] Hundi~eaarsu,gaz,e, XI, P. 24.
[23] William Archer, « Ibsen as 1 knew him » dans The monthly Review, juin 1906, PP. 12-13.
[24] Francis Bull, Hundrearsulgave, XI, PP. 23-24.
[27] Lettre du 13 août 1887, ibid., P. 382.
[28] Lettre d’avril 1888, Breve, II, Pp. 71-172.
[29] Voir le Voyage en Laponie de Regnard.
[30] Halvdan Koht, Henrik Ibsen, eit diktar-liv, II, P. 283-
[31] John Paulsen, Reisen til Monaco, p. 92. Francis Bull, dans Hundreaarsutgave, XI, P. 23. Lugné Poë, Ibsen, P. 31.
[32] Lettre citée par Francis Bull, Hundreaarsutgave, XI, PP. 29-31.
[33] Lettre du 3 mai 1889, Breve, II, p.180
[34] John Paulsen, Reisen til 11onaco, P. 92.
[36] John Paulsen, Samliv med Ibsen, 1906, p. 104
[37] H. Koht. Hcnrik Ibsen, eit diktar-liv, 11, P. 283.
[38] Tome XIII, p. 268.
[39] Halvdan Koht, Henrik Ibsen, eit diktar-liv, II, p. 28o.
[40] Sten Linder, Ernst Ahlgren i haines romaner, p. 62, en note.

Jules De Gaultier
La Revue blanche / Avril 1898
De la transsubstantiation dramatique
Article de Jules de Gaultier paru dans La Revue blanche d’avril 1898
(…) Voici une pièce qui renferme, outre les éléments primordiaux constitutifs de tout drame d’Ibsen, un exemple de cette sorte : La Dame de la Mer.
Evoluant au premier plan du drame, c’est l’intrigue que l’on connaît : les fiançailles d’Ellida avec un marin, personnage dont on sait à peine tout d’abord s’il est réel, mais qui exerce sur la jeune fille un étrange pouvoir. Puis, le mariage d’Ellida avec le Dr Wangel, ses vains efforts pour se soustraire à la tyrannie du souvenir, sa maladie de langueur, les lettres de Johnston qui, bien qu’averti du mariage de sa fiancée, semble l’ignorer et promet toujours de venir la prendre, l’attente anxieuse de la jeune femme, dominée par une fascination irrésistible; enfin l’apparition de l’homme derrière la haie du jardin et le débat final qui se formule pour le spectateur de curiosité rudimentaire en cette alternative : Ellida va-t-elle suivre Johnston, son premier fiancé, ou va-t-elle demeurer auprès du Docteur Wangel, son mari ? Mais en ce dernier acte, Johnston déjà n’est plus Johnston : par l’apparence à moitié réelle et à moitié fantastique qu’il lui a prêtée, Ibsen a posé sa valeur de symbole, il l’a signalé comme le facteur idéologique de son drame. En effet, de la signification qui sera attribuée à son personnage, va suivre l’interprétation de la pièce toute entière. Or, cette signification est ici, d’une part, merveilleusement large et indéterminée, – en sorte qu’elle ménage à l’esprit du spectateur toute libre initiative, – et, en même temps, elle est précisée presque grossièrement en vue du développement idéologique dont l’exemple particulier est joint. Le fiancé d’Ellida, qui a nom Johnston au premier acte, lorsqu’il matérialise le rêve sentimental de la jeune fille, devient ensuite l’Américain, puis l’Etranger; il est tantôt celui-ci et tantôt celui-là, comme s’il pouvait prendre l’infinité de toutes les formes de la vie. Mais il se nomme aussi Frimann, et cette dénomination évoque d’une façon transparente la thèse de liberté qu’Ibsen développe dans sa pièce, thèse exprimée au dernier acte lorsqu’Ellida, hésitante, entre les deux hommes, choisit spontanément Wangel dès qu’elle est libre de choisir.
Ainsi, dans cette dernière scène qui dénoue l’intrigue sentimentale, la pièce philosophique apparaît. – « Oui, oui, je vous assure, madame Wangel, que nous nous acclimatons. – Oui, monsieur Ballested, pourvu que nous soyions libres – Et responsables, ma chère Ellida », ajoute Wangel. – « Et responsables, tu as raison », acquiesce Ellida. La responsabilité morale a donc pour condition la liberté absolue dont elle est le corrélatif. Tout individu porte en lui une tendance intérieure qui constitue sa personnalité, qui est, à vrai dire, sa réalité essentielle. Tant que cette tendance ne peut s’exercer librement, la réalité individuelle est abolie, elle est inexistante, en sorte que l’individu, n’étant pas, ne saurait être responsable d’actes dont il n’est pas, à vrai dire, l’auteur.
Au moyen de cet énoncé philosophique, voici le rôle de Frimann précisé. Il est matérialisé pour les besoins de la représentation théâtrale, l’élément personnel irréductible qui est en chaque être, et qui, contrarié par quelque circonstance, par quelque décision prise à son encontre, élève la réclamation de son droit contre le dommage qu’il a subi. Ainsi d’un ressort comprimé par une force étrangère et dont toute l’énergie est tendue à se redresser. À quel point Ibsen est parvenu à différencier l’objet de sa représentation de l’élément dont il se sert pour le figurer, on le voit d’après cet exemple. L’étranger devient ici le signe concret d’une entité abstraite. Une valeur autre que celle qu’il figure extérieurement lui a été attachée : désormais à chacun de ses mouvements extérieurs va correspondre un déplacement de l’idée qu’il signifie. De plus, tous les autres personnages du drame, pour se mettre d’accord avec la valeur symbolique de ce personnage clairement exprimée par l’auteur, vont être tenus de signifier eux-mêmes quelque aspect particulier de l’idée en scène, en sorte qu’au moyen de cette clef qui nous ouvre la signification algébrique de tous les figurants, pris comme des signes concrets, une pièce nouvelle et purement idéologique va se jouer devant nous.
Voici trois femmes pourvues de personnalités plus ou moins fortes. L’Etranger tient lieu de commune mesure entre elles. Il représente pour chacune, en opposition avec le réel, tout le possible et il extériorise aussi l’énergie, avec son degré précis, de la tendance intérieure qui constitue leur individualité distincte. Son pouvoir va donc grandir en raison de la violence de chaque personnage. – Wangel représente, pour Ellida, la contrainte d’une réalité trop étroite, qui, limitant l’horizon de la jeune fille, excluant tout le possible, semble supprimer le choix. Car Ellida a vécu dans l’isolement du phare, loin du contact multiple des réalités. Elle est de plus une individualité puissante, une force qui refuse de s’exercer si elle n’est pas assurée de suivre sa loi. Ces deux conditions réunies autour d’elle et en elle-même, et qui fondent le pouvoir de l’Etranger sur un être, justifient la violence dramatique de sa longue hésitation.
Bolette avec Arnholm reproduit avec une intensité amoindrie le même conflit. La maison où elle vit retirée, près de l’étang des carassins, a pour elle la même signification symbolique que pour Ellida le phare solitaire. Pourtant la vie, avec ses figurants, longe la haie qui borde le jardin et Bolette est d’ailleurs d’individualité moins puissante que la Dame de la mer. On sent en elle une malléabilité de nature capable de se prêter à plusieurs adaptations et, de fait, sans crise douloureuse, après un bref sursis, elle accepte de limiter à Arnholm son désir d’inconnu.
Il en est bien autrement de la petite Hilde vis-à-vis de Lyngstrand. Hilde représente un degré d’énergie tout à fait supérieur. Incapable de sacrifier quelque part de sa personnalité ni par faiblesse ni par bonté, elle est indemne de nos vertus comme de nos vices. Son charme procède de cette indépendance et de ce qu’une nouveauté irréductible est en elle. Lyngstrand a demandé à Bolette de lui consacrer une pensée chaque jour quand il sera parti, afin que son art en profite, et déjà il suppute qu’Hilde, devenue plus grande, pourra remplir vis-à-vis de lui le même office. Mais la petite Hilde n’accepte pas de subordonner son existence à une autre existence. Et c’est elle qui railleusement assigne à Lyngstrand un rôle sacrifié dans le décor de sa vie. « Croyez-vous, lui demande-t-elle, que cela m’ira bien d’être tout en noir? » Et comme l’artiste imagine d’elle un délicieux portrait, « une jeune veuve en grand deuil », elle rectifie: « une jeune fiancée en deuil».
En contraste avec Ellida et bien au-dessous de Bolette, l’étonnant Ballested bouffonne sur les tréteaux comme un clown entre deux exercices. L’Etranger n’a qu’un bien faible empire sur Ballested. Ballested est sourd à ses revendications. Mais il supplée la liberté de choisir sa vie par une souplesse infinie à s’accommoder de toutes les circonstances. D’individualité amorphe, il est prêt toujours à s’accli, à s’acclimater sur quelque sol que le hasard le transporte. Pour noter en lui cette absence de personnalité, Ibsen lui attribue toutes les professions. Épave d’une troupe de comédiens dispersée après faillite, c’est lui qui, au premier acte, en qualité de factotum, hisse le pavillon chez les Wangel en l’honneur de l’arrivée d’Arnholm. En même temps, il brosse une toile disposée sur un chevalet et se sauve précipitamment en voyant arriver le bateau sur le fjord, car il va offrir ses services aux passagers : il est coiffeur, maître de danse, et le voici, au deuxième acte, guidant les touristes vers le point de vue. Ballested « ne marche pas par paire» comme Ellida avec Wangel, Bolette avec Arnholm, Hilde avec Lyngstrand. Il est seul, et non sans intention de l’auteur, qui sollicite ainsi l’esprit du spectateur à chercher, en dehors de la thèse matrimoniale qu’il développe, une application plus ample de l’idée de liberté et des symboles qu’il a construits.
En dehors de l’intrigue fantastique, en dehors de la pièce à thèse qui paraît prendre parti pour une émancipation de la jeune fille et s’adresse aux sociologues, il y a en effet dans la Dame de la mer une troisième pièce faite pour passionner une nouvelle catégorie d’esprits, et cette troisième pièce est, à vrai dire, la seule et véritable, dont les deux autres ne sont, en quelque sorte, que le moyen; pièce multiple d’ailleurs qui s’élève avec l’intelligence plus haute de chaque spectateur et selon l’idée maîtresse qui, plus ou moins suggérée par l’auteur, devient le thème et le coefficient du nouveau drame idéologique.
Ce qu’il nous faut donc considérer comme essentiel dans le drame d’Ibsen, c’est cela seulement qui rend possible cette troisième et multiple pièce.
Et cette pièce est possible dès qu’un système précis de relations est établi entre les différents personnages, tel qu’on vient de le voir fixé entre les personnages de la Dame de la mer, Ellida, Bolette, Hilde, Ballested qui s’ordonnnent tous vis-à-vis de l’Etranger selon une hiérarchie rigoureuse et en quelque sorte numérique: car dans son rapport avec lui, chacun d’eux pourrait être représenté par un chiffre. L’ensemble de ces chiffres séparés les uns des autres par des intervalles inviolables, qui paradoxalement les joignent en un organisme, cet ensemble forme le premier terme d’une proportion : plus ou moins touffu, plus ou moins chargé d’incidences, il a une physionomie personnelle et distincte. Or on sait que cette république de nombres ne sera pas désagrégée quant aux rapports entre eux de chacun de ses éléments, si l’on applique à chacun d’eux un même numérateur. Ce numérateur est ici le facteur idéologique, c’est-à-dire l’idée qui transforme la signification soit d’un fait, soit d’un personnage, – comme c’est le cas pour l’Étranger dans la Dame de la mer – et par là transpose l’aventure toute entière. Ce facteur idéologique est un élément essentiel de la représentation. Il en est le levier. L’auteur n’est pas tenu de préciser sa signification, comme il l’a fait sur un point dans la Dame de la mer; mais il doit nous faire sentir que ce facteur existe et qu’il veut être appliqué, le spectateur demeurant libre de l’imaginer, de tirer de la substance de son cerveau le motif an moyen duquel féconder le drame. Constatons d’ailleurs qu’au lieu d’un facteur idéologique, Ibsen a coutume d’en désigner plusieurs, que des allusions plus ou moins transparentes signalent. Il indique à l’investigation des chercheurs plusieurs pistes où l’herbe plus ou moins foulée laisse entrevoir ou dissimule la ligne brune du sentier. Les esprits avertis et rompus déjà à la gymnastique des idées préféreront sans doute, parmi les pièces de son théâtre, celles où une semblable désignation est plus obscure, celles en même temps, dont Solness le Constructeur réalise le type, qui, allégées de toute explication, sont réduites aux éléments essentiels de la suggestion dramatique : une aventure si bien liée dans toutes ses parties qu’elle est une forme merveilleuse où couler toute idée, une aventure d’intérêt si puéril, que l’allusion la plus légère ou la plus lointaine suffit à la transposer. A d’autres esprits un apprentissage est nécessaire : c’est pour ceux-ci qu’Ibsen ajoute parfois à l’exposé de l’aventure un développement idéologique. C’est à eux qu’est dédié le thème matrimonial de la Dame de la Mer exprimé de façon transparente par le jeu des trois couples et fait pour accoutumer les néophytes à déchiffrer sous les faits les attitudes de l’idée. Ce thème ne constitue pas au même titre que le facteur idéologique un élément essentiel du drame.- il peut être retranché et, de fait, il n’apparaît pas dans certaines pièces. Dans la Dame de la Mer, Ibsen l’a utilisé à préciser la relation numérique des personnages entre eux, mais cette relation eût pu être établie, comme dans Solness, par les contingences du scénario et, exhaussée par le symbole, elle eût suscité le drame idéologique dont elle est la figuration concrète.
Le théâtre d’Ibsen, comme toute œuvre d’art véridique, dote l’esprit, dans le même temps, d’une liberté sans limite et d’une méthode rigoureuse. Ainsi le spectateur est libre de varier à l’infini le développement idéologique contenu dans cette Dame de la Mer qui vient d’être analysée : mais sitôt qu’il a attaché à l’Etranger un sens nouveau, la relation instituée par Ibsen entre tous ses personnages va nécessiter la signification de chacun d’eux, en rapport avec l’idée nouvellement élue. Car des intervalles comme musicaux séparent tous ces personnages, les situant les uns vis-à-vis des autres, et il en est de même des circonstances de la pièce qui, si puériles qu’elles apparaissent parfois, n’en sont pas moins coordonnées entre elles selon un ordre strict. Tout cet arrangement forme un appareil précis et conditionne rigoureusement le développement du thème nouveau. Des intelligences diverses sauront faire tenir dans cet appareil des éléments dissemblables; mais ces éléments une fois donnés s’amalgameront entre eux selon des lois fixes, s’opposeront et se concilieront au même endroit du drame que les personnages eux-mêmes qui les signifient, avec des degrés égaux dans la violence, et selon des correspondances inflexibles. Ainsi le même air, posé tour à tour sur des paroles profanes ou sacrées, évoque dans l’esprit une succession d’images différentes, selon une progression passionnelle identique. A entendre le drame ainsi transposé par le motif personnel qu’il y a fait tenir, le spectateur goûte la joie de considérer son idée se mouvoir et vivre selon chacune des péripéties de l’aventure, évoluer et progresser avec les gestes de la petite Hilde, et avec le débat de la Dame de la Mer, sa distinguer et se préciser par le contraste des propos, de Ballested, par les conversations de Bolette avec Arnholm. Tous ces personnages, avec leurs mouvements et leurs paroles visibles, vont évoquer pour lui un drame abstrait, composé d’attitudes cérébrales invisibles et fait à la ressemblance de l’intrigue concrète qui se joue sur les tréteaux. Entre les deux pièces, l’identité d’apparences résultera de ce qu’un même système de grandeurs proportionnelles imposera sa forme à l’une et à l’autre.
Ainsi ce qu’il convient d’admirer d’abord chez Ibsen c’est, en dehors de toute valeur immédiatement intelligible et avant toute application, la beauté architectonique de l’œuvre, le balancement harmonieux (les lignes qui la composent, la symétrie des proportions, la pure mathématique des grandeurs. Car c’est tout cet ensemble qui compose le merveilleux appareil de transposition qui est la création propre de l’artiste: une forme aux contours précis, mais vide, en sorte que tous les intellects y peuvent librement apporter des substances nouvelles. A cette beauté purement formelle, l’œuvre d’art emprunte son pouvoir de s’affranchir du temps : ses proportions sont telles qu’elle peut abriter des intelligences futures, riches de notions inconnues à l’époque de sa formation. D’où parfois son caractère d’apparence prophétique. Une phrase bien faite, par la seule vertu de sa construction, voit sa signification s’approfondir et se multiplier à travers la durée avec le progrès de la connaissance. C’est pourquoi, si vaste que l’on suppose l’intelligence d’un artiste, son œuvre s’élève, au point de vue de ce qu’elle embrasse, bien au-dessus de cette intelligence même. Elle tire sa valeur absolue non pas des concepts eux-mêmes que l’artiste y a inclus, mais de toute la hauteur dont elle domine ces concepts, de toute l’ouverture par où elle offre accès à de nouvelles idées. Son titre authentique est d’être une forme inaltérable. Par là l’œuvre d’art essentielle reproduit le phénomène de la vie qui, à travers l’écoulement indéfini de la substance, maintient, dans une rigidité, des formes pareilles. L’artiste qui crée, en vertu d’un don, une forme intellectuelle, – par la méthode insérée dans son œuvre et qui s’impose à tous les intellects se penchant sur elle, – s’associe tout effort, revendique tout apport idéologique du temps actuel et futur.
Parmi ces appareils de rêve et de mentalité que sont les œuvres d’art, le théâtre d’Ibsen est, entre tous, d’une extraordinaire perfection. On va en faire usage ici pour dégager, en toute indépendance, de la Dame de la Mer d’abord, puis de l’œuvre dramatique tout entier, l’un des aspects de cette troisième pièce invisible et multiple dont l’intrigue apparente, avec toute sa délicate ingéniosité et son charme souvent incomparable, est le signe et le moyen. On profitera de la liberté d’interprétation plénière, que laisse à chaque esprit l’œuvre d’art, pour insérer dans le magique appareil une idée de choix personnel, confiant dans la perfection du subtil mécanisme pour conférer à cette idée sa forme et la revêtir de prestige. Ainsi d’un mangeur d’opium qui se contente d’assurer à son demi-sommeil 1’audition de quelque phrase mélodique préférée et se fie à la bonté du poison pour développer en symphonie ce thème chétif. En cette troisième pièce, le fait essentiel d’une transsubstantiation va donc se manifester avec évidence, car chaque geste, chaque parole, chaque acte et chaque circonstance apparaîtront dépouillés de leur intérêt immédiat, pour n’être plus que les signes concrets qui, à la ressemblance d’une apparence naturelle, représenteront des apparences abstraites évoquées selon le gré d’une volonté particulière..
 CHOIX D’UN FACTEUR IDÉOLOGIQUE (L’Evolution)
CHOIX D’UN FACTEUR IDÉOLOGIQUE (L’Evolution)
Le levier dont on fera usage ici pour transposer le théâtre d’Ibsen est l’idée d’évolution. Sous ce mot, il faut comprendre l’ensemble des attitudes adoptées par la Vie pour se manifester et pour durer. Ecartée l’idée inaccessible d’une création et d’une fin, quelle est la loi dit devenir ? Cette interrogation se décompose en deux autres –
Comment le présent maintient-il les acquisitions du passé c’est-à-dire : Quel est le mode conservateur de la vie ?
Comment l’avenir parvient-il à se différencier du présent C’est-à-dire : Quelle est la loi du changement ?
Une telle question est d’une extrême généralité, car elle embrasse le monde moral aussi bien que le monde physique. Et comme celui-ci, si obscur qu’il soit, se manifeste pourtant à nos yeux avec plus de sincérité que le monde moral, c’est aux sciences physiologiques qu’il convient de demander l’hypothèse dont la formule vaudra ensuite pour régir les phénomènes du inonde moral.
L’art d’une époque. comme l’eau reflète les vols d’oiseaux qui la dominent, reflète les idées qui durant cette même époque ont traversé les cervelles humaines. Aussi, n’y a-t-il pas matière à s’étonner si l’œuvre dramatique d’Ibsen reproduit un ordre de préoccupations qui a tenu tout le siècle attentif.
D’ailleurs, parmi toutes les pièces de son théâtre, la Dame de la mer est la seule qui trahisse par des allusions directes ce souci scientifique. Ballested, peintre symboliste à l’occasion, explique à Lyngstrand le sujet de son tableau : au fond d’un fjord, sur un récif, une sirène mourante; elle agonise dans cette eau saumâtre « parce qu’elle s’est égarée et ne sait plus retrouver le chemin de la mer». La nostalgie d’Ellida, exilée aussi des rivages marins, commente ce symbole par un nouveau symbole. Mais dans une conversation avec Arnholm, Mme Wangel précise l’hypothèse. « Nous n’appartenons pas à la terre ferme? » demande Arnholm. « Non. Je crois que si nous nous étions accoutumés, dès notre naissance à vivre sur mer, dans la mer même, nous serions peut-être beaucoup, beaucoup plus parfaits que nous ne le sommes. » Et elle pense que les hommes ont fait fausse route en devenant des animaux terrestres au lieu de devenir des animaux marins ». Le personnage d’Ellida hésitante entre Friman et Wangel, entre deux états différents de la vie, symbolise, à travers le vertige des siècles, vers quelque date géologique imprécise, l’épisode le plus poignant de la légende scientifique, la métamorphose de l’animalité marine en une animalité terrestre. La vie, enclose jusque là comme un embryon dans l’œuf marin, voit son enveloppe brisée; elle apparaît sur le limon terrestre, dans un milieu hostile, nue parmi l’atmosphère qui la touche et la baigne. Va-t-elle s’adapter à ces conditions nouvelles ? Va-t-elle mourir? La Dame de la Mer parviendra-t-elle à s’acclami, à s’acclimater ? Oui pourvu qu’elle soit libre, c’est-à-dire, dans la langue des lois physiques, pourvu que spontanément un changement s’accomplisse en elle qui la dote d’un organisme en harmonie avec les conditions du nouveau milieu. Or le changement s’accomplit. Wangel résilie le marché, le contrat qui les liait l’un à l’autre. « Maintenant, choisis ta route. Tu es libre, complètement libre », et aussitôt à l’Etranger qui l’appelle: « Entends-tu Ellida ! On sonne maintenant pour la dernière fois. Viens donc! » Ellida répond
d’une voix forte : « Jamais je ne vous suivrai après ce qui vient de se passer. » Après la longue crise douloureuse la métamorphose vient de se réaliser soudain. Ellida avec des poumons dilatés va pouvoir respirer maintenant parmi l’atmosphère qui l’environne.
Cet exode de l’animalité marine vers l’existence terrestre apparaît la grande crise de puberté de la vie organique, et, aux approches de la métamorphose, c’est l’effroi d’une agonie que traduit l’angoisse d’Ellida. Avant cet exode, c’est, dans le milieu marin, l’enfance de la vie : des formes s’ébauchent, s’essaient en des avatars sans fin et jamais ne s’achèvent. C’est une souplesse sans limite à revêtir toutes les apparences, a se diversifier à l’infini. C’est aussi une indépendance, un besoin nomade, un instinct de liberté qui ne se complaisent qu’en ce perpétuel changement, qui ne sauraient s’astreindre à se figer en quelque aspect particulier.
Mais avec l’avènement de la Vie sur la surface terrestre, une loi de fixité succède à cette loi de changement. Des formes déterminées apparaissent et persistent. Une différenciation de milieu aussi complète, qui commandait un remaniement profond du plan organique, a épuisé la virtualité des êtres et leur a imposé sans doute des caractères spécifiques désormais peu modifiables, – en déterminant leurs formes, a aboli leur pouvoir d’en prendre par la suite de nouvelles.
L’Etranger représente vis-à-vis d’Ellida la virtualité première de la Vie, cette faculté protéique à laquelle elle va renoncer pour l’avenir en l’exerçant une fois pour toutes et, lui remémorant tout le poème des possibles, il la fait hésiter longtemps sur le seuil de sa décision. « La décision ! La décision irrévocable à jamais » s’écrie-t-elle avec désespoir, alors qu’il la somme de choisir librement entre Wangel et lui.
Aussi, tandis que dans la pièce concrète l’Etranger demeure pour Ellida le fiancé, l’irréalisé, le rêve , Wangel est le mari, – c’est-à-dire la réalisation et en même temps la borne du rêve. Ellida, qui appartient désormais à Wangel s’interdit toutes autres aspirations. Sa vie, dans le présent et dans l’avenir, est définie; il n’est plus que de maintenir les termes du contrat, de perpétuer à travers les années l’ensemble de sentiments et de devoirs dont la formule idéale vient d’être posée.
Au point de vue symbolisé de l’évolution, l’Etranger représente, en un lieu inconnu de l’Espace et du Temps, la variabilité de la Vie organique, la jeunesse de la vie, sa virtualité, son pouvoir d’évoluer et de se transformer. Wangel représente au contraire la Vie adulte munie d’une forme invariable qu’elle va maintenir aussi longtemps que les circonstances le lui permettront, et qu’elle n’abandonnera que pour mourir.
Sous le jour de cette idée, l’Etranger et Wangel reflètent et concilient les deux hypothèses biologiques qui ont partagé le siècle et dont Cuvier et Lamarck ont fixé les lignes essentielles : celle de l’invariabilité des espèces et celle de la mutabilité des formes organiques sous l’influence du milieu. Ces deux hypothèses ne font elles-mêmes que traduire le double procédé de la Vie pour vivre. Et c’est, d’une part, un procédé de nouveauté, une tendance à varier et à recevoir les modifications de l’extérieur ; c’est, d’autre part, un procédé conservateur qui maintient et fixe en les répétant les propriétés acquises par la tendance à varier. L’existence simultanée de ces deux forces crée entre elles un antagonisme : mais cet antagonisme est la condition même et le support du phénomène de la Vie. Supprimée la modalité conservatrice, aucune forme ne parviendrait à se manifester, les conditions extérieures en perpétuel changement détruisant à peine ébauchés les avatars d’une substance trop malléable. Mais sitôt que le principe conservateur triompherait en une forme et lui interdirait définitivement de varier, celle-ci serait condamnée à mourir et elle s’éteindrait en effet dès que les conditions extérieures auxquelles elle aurait perdu le pouvoir de s’adapter ne seraient plus compatibles avec son organisation spéciale.
On ne saurait prétendre, est-il besoin de l’exprimer, que le passage de la vie marine à la vie terrestre marque en réalité pour les organismes la fin du pouvoir d’évoluer. Mais on ne saurait douter non plus qu’à une certaine date de la vie organique, ce pouvoir prenne fin; or, c’est cette déchéance que dénonce pour nous l’exode zoologique symbolisé dans la Dame de la Mer. Le triomphe de Wangel sur l’Etranger dans le cœur d’Ellida, voici donc pour nous l’épisode suprême qui soustrait la Vie à l’empire de la tendance à varier et la soumet définitivement à l’action de l’hérédité. Désormais, l’espèce est créée; en elle toute virtualité est éteinte. Elle ne pourra plus recevoir de l’extérieur que des modifications restreintes, celles qui ne lui feront pas perdre son caractère spécifique. Une action trop violente du dehors pourra l’abolir, mais non plus la changer. De ce point de vue, l’espèce pourrait être définie, un organisme parvenu au point de détermination où l’extérieur est impuissant à le modifier. Les espèces que l’on serait tenté de dire nouvelles ne sortiraient donc pas des espèces plus anciennes. Elles prendraient leur origine à une date antérieure à la décision d’Ellida, dans la même matrice où les espèces anciennes ont pris la leur, dans cette matière première de la Vie, docile encore à l’action de l’extérieur. – Telles sont les conclusions qu’il était nécessaire d’enregistrer : car, appliquées au monde moral, elles vont entraîner des conséquences inattendues dont les pièces d’Ibsen seront le commentaire.
Tel est aussi ce drame de la Dame de la Mer dont les décors devraient être brossés en un paysage préhistorique sur les indications d’un paléontologue. Dans nul autre, on l’a remarqué déjà, Ibsen n’a fait d’allusions aussi directes aux lois qui régissent la formation et l’évolution des espèces, Mais cette indication, une fois donnée, va suffire pour évoquer désormais en notre esprit, à l’occasion des autres pièces qui semblent traiter seulement des attitudes morales de la Vie, cette correspondance physiologique.
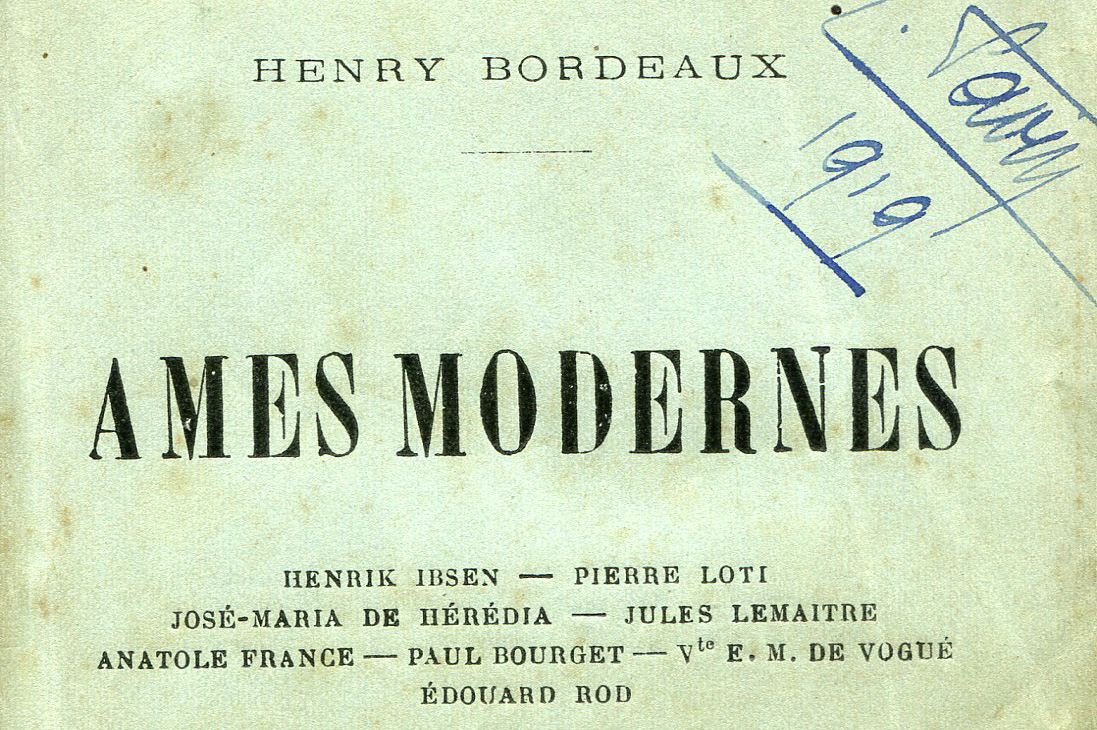
Henri Bordeaux
Âmes modernes
Henrik Ibsen
 Ibsen
Ibsen
Deux extraits du chapitre sur Ibsen des « Âmes modernes », de Henri Bordeaux, Perrin, 1894, p37-39, p43-45
Premier extrait:
(…) « Je ne suis pas celle que tu croyais épouser, » murmure douloureusement Ellida à son mari Wangel dans la Dame de la mer. Là non plus leur vie conjugale n’est point faite de franchise et de sincérité. Entre eux se dresse le souvenir étrange que garde en son cœur Ellida d’un fiancé de jadis, venu de Finlande et reparti sur la mer lointaine, d’un étranger qui incarne son rêve d’inconnu, de vie libre et volontaire et d’amour infini, comme cette grande mer troublante sur laquelle il vogue à pleines voiles. Et rien ne peut briser cette tentation d’inconnu qui envahit sa pauvre âme de désir, car elle est intérieure et symbolise l’éternel rêve des hommes. Et, lorsque le mystérieux étranger s’en vient en toute certitude réclamer Ellida pour l’emmener sur les larges Océans, elle demande à son mari de la dégager, afin qu’en toute liberté elle puisse choisir son destin et suivre l’Etranger, cette nuit même si telle est sa volonté: son union avec Wangel ne fut point librement consentie, et de là vient toute leur misère, en vain Wangel la supplie de renoncer à son rêve: « Tu ne peux pas m’empêcher de choisir, – lui réplique-t-elle affolée, – ni toi ni personne. Tu peux me défendre de partir avec lui, de le suivre, malgré moi. Tu peux me retenir ici de force. Mais tu ne peux pas m’empêcher de choisir, dans le fond de mon âme, de te le préférer si tel est mon désir, si tel est mon devoir, » On n’enchaîne point la pensée et le désir qui demeurent éternellement libres de poursuivre le mystère, l’inconnu lointain et attirant. Et Wangel murmure avec une douleur résignée : – « Je le vois bien, Ellida ! Tu m’échappes de plus en plus. Le désir de l’Infini, de l’idéal irréalisable, finira par jeter ton âme dans les profondeur sombres de la nuit… – Oui, oui, – ajoute Ellida suppliante, je sens au-dessus de moi planer de grandes ailes noires et silencieuses. » Alors Wangel, dont la supérieure intelligence comprend le secret des âmes souffrantes, rend à la Dame de la mer sa liberté, afin qu’elle choisisse volontairement entre le rêve qui l’effare et la réalité dont elle comprend soudainement la douceur, et Ellida, ayant la possibilité de contempler face à face le mystérieux inconnu et d’y pénétrer pour jamais, y renonce librement. Car le rêve meurt en nous sitôt qu’il est réalisable, et, s’appuyant à son époux retrouvé, Ellida dit enfin cette phrase qui résume la pensée d’Ibsen: « – Maintenant je serai à toi. Maintenant je le peux, parce que maintenant je viens à toi en toute liberté, volontairement, comme un être responsable de ses actes. »
Ainsi toutes les unions qui ne sont point basées sur la libre volonté et la reconnaissance ont-elles un principe mauvais qui les dissout tôt ou tard. Le mariage d’Hedda Gabler et de Georges Tesman, issus de deux milieux différents et n’étant point d’une même race d’âmes, en est encore une preuve. Aux yeux d’Ibsen, l’individu ne doit point supporter ce perpétuel mensonge des unions mal assorties : qu’il en sorte plutôt en brisant ces liens hypocrites, mais qu’il n’étouffe jamais en lui la voix de la vérité.
Second extrait:
(…) La vie est bonne en soi : il faut que l’être humain jouisse pleinement des choses, et pour cela qu’il multiplie ses sensations de vie. Ainsi les jeunes femmes d’Ibsen vont parfois jusqu’aux extrêmes du désir de vivre, jusqu’à la séduction de l’épouvante et de l’inconnu. De simples mots, murmurés comme en rêve au cours de ses drames, la grande mer, la mer lointaine prennent des inflexions mystérieuses et troublantes. Marthe, dans la beauté de son sacrifice, pousse Dina vers cette vie plus vivante dont elle-même, Waura jamais que le désir: « Va où ton bonheur t’appelle, chère enfant, sur la mer immense! Que de fois dans mon école, là-bas, j’ai rêvé de cette mer! Puis, on doit être si bien là-bas, le ciel est plus vaste, les nuages flottent plus haut qu’ici; l’homme respire un air plus libre[1]… » Et, dans la Dame de la mer, tout le magnétique pouvoir de l’Etranger est fait du charme de la mer, du charme des rêves qui font la vie plus vaste.
C’est surtout par la pensée que les femmes d’Ibsen manifestent leur fièvre de vivre. Elles souffrent des existences monotones et des sorts médiocres, et, ne pouvant briser les liens sociaux qui les retiennent, par la pensée elles s’en échappent, et vaguent au loin dans la vie rêvée, dans les fantaisies cérébrales, plus profondes et plus hautes que celles des sens. Il y a même dans leur cas un peu de perversion intellectuelle . des sensations rares et artificielles les attirent, elles aiment à marcher au fond des abîmes qu’elles contemplent avec un frisson d’étrange volupté, elles subissent l’attraction du danger et trouvent un bonheur indicible à la sensation du vertige, parce que du moins elles sentent la vie passer en elles à ces instants inouïs. Ce sont des âmes compliquées de femmes du Nord, qui dans les soirs de neige ont scruté les métaphysiques et heurté leur front aux explications de vivre. Leur vie intérieure fut intense, et se reflète sur la pâleur de leurs traits délicats et la profondeur de leurs Yeux énigmatiques. L’inconnu, ce qui effraye et attire à la fois, les tourmente. Elles faussent les sentiments par une recherche cérébrale trop raffinée. Ainsi, dans la Dame de la mer, Hilda, l’exquise jeune fille dont le cœur est prêt à s’abandonner tout entier à qui est bon pour elle et la caresse, qui aime peut-être, silencieuse, Lyngstrand, le sculpteur poitrinaire, et se plait à l’idée d’être une fiancée en deuil, trouve une saveur étrange à cette pensée que Lyngstrand lui parle sans cesse de partir pour l’étranger et de devenir un grand artiste, et que rien de tout cela ne sera jamais réalisé, car la mort l’a déjà touché. Et dans Solness, lorsque Hilda Wangel voit le hardi constructeur que menace le vertige, debout au sommet de la tour qu’il a construite, elle s’écrie avec extase : « Oh! que c’est émotionnant! »
[1] Les Soutiens de la société.
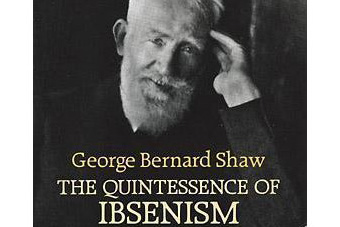
George Bernard Shaw
The Quintessence of ibsenism
The Lady from the sea - 1888
 The Lady from the sea – 1888
The Lady from the sea – 1888
Tiré de The Quintessence of ibsénism, de George Bernard Shaw, 1891
(…) Ibsen’s next play, though It deals with the old theme, does not insist on the power of Ideals to kill, as the two previous plays do. It rather deals with the origin of ideals In unhappiness, in dissatisfaction with the real. The subject of The Lady from the Sea Is the most poetic fancy imaginable. A young woman, brought up on the sea-coast, marries a respectable doctor, a widower, who idolizes her and places her in his household with nothing to do but dream and be made much of by everybody. Even the house- keeping is done by her stepdaughter : she has no responsibility, no care, and no trouble. In other words, she is an idle, helpless, utterly dependent article of luxury. A man turns red at the thought of being such a thing; but he thoughtlessly accepts a pretty and fragile-looking woman in the same position as a charming natural picture. The lady from the sea feels an indefinite want in her life. She reads her want into all other lives, and comes to the conclusion that man once had to choose whether he would be a land animal or a creature of the sea; and that having chosen the land, he has carried about with him ever since a secret sorrow for the element he has forsaken. The dissatisfaction that gnaws her is, as she interprets it, this desperate longing for the sea. When her only child dies and leaves her without the work of a mother to give her a valid place in the world, she yields wholly to her longing, and no longer cares for her husband, who, like Rosmer, begins to fear that she is going mad. 99At last a seaman appears and claims her as his wife on the ground that they went years before through a rite which consisted of their marrying the sea by throwing their rings into it. This man, who had to fly from her in the old time because he killed his captain, and who fills her with a sense of dread and mystery, seems to her to embody the mystic attraction the sea has for her. She tells her husband that she must go away with the seaman. Naturally the doctor expostulates declares that he cannot for her own sake let her do so mad a thing. She replies that he can only prevent her by locking her up, and asks him what satisfaction it will be to him to have her body under lock and key whilst her heart is with the other man. In vain he urges that he will only keep her under restraint until the seaman goes that he must not, dare not, allow her to ruin herself. Her argument remains unanswer- able. The seaman openly declares that she will come; so that the distracted husband asks him does he suppose he can force her from her home. ‘To this the seaman replies that, on the contrary, unless she comes of her own free will there is no satisfaction to him in her coming at all: the un- answerable argument again. She echoes it by demanding her freedom to choose. Her husband must cry off his law-made and Church-made bar- gain; renounce his claim to the fulfilment of her vows; and leave her free to go back to the sea with her old lover. Then the doctor, with a heavy heart, drops his prate about his heavy responsibility for her actions, and throws the responsibility on her by crying off as she demands. The moment she feels herself a free and responsible woman, all her childish fancies vanish: the seaman becomes simply an old acquaintance whom she no longer cares for; and the doctor’s affection produces its natural effect. In short, she says No to the seaman, and takes over the house- keeping keys from her stepdaughter without any further maunderings over that secret sorrow for the abandoned sea. It should be noted here that Ellida [call her Eleeda], the Lady from the Sea, seems more fantastic to English readers than to Norwegian ones. The same thing is true of many other characters drawn by Ibsen, notably Peer Gynt, who, if born in England, would certainly not have been a poet and metaphysician as well as a blackguard and a speculator. The extreme type of Norwegian, as depicted by Ibsen, imagines himself doing won- derful things, but does nothing. He dreams as no Englishman dreams, and drinks to make him- self dream the more, until his effective will is destroyed, and he becomes a broken-down, dis- reputable sot, carrying about the tradition that he is a hero, and discussing himself on that as- sumption. Although the number of persons who dawdle their life away over fiction in England must be frightful, and is probably increasing, yet their talk is not the talk of Ulric Brendel, Rosmer, Ellida, or Peer Gynt; and it is for this reason that Rosmersholm and The Lady from the Sea strike English audiences as more fantastic and less literal than A Doll’s House and the plays in which the leading figures are men and women of action, though to a Norwegian there is probably no difference in this respect.
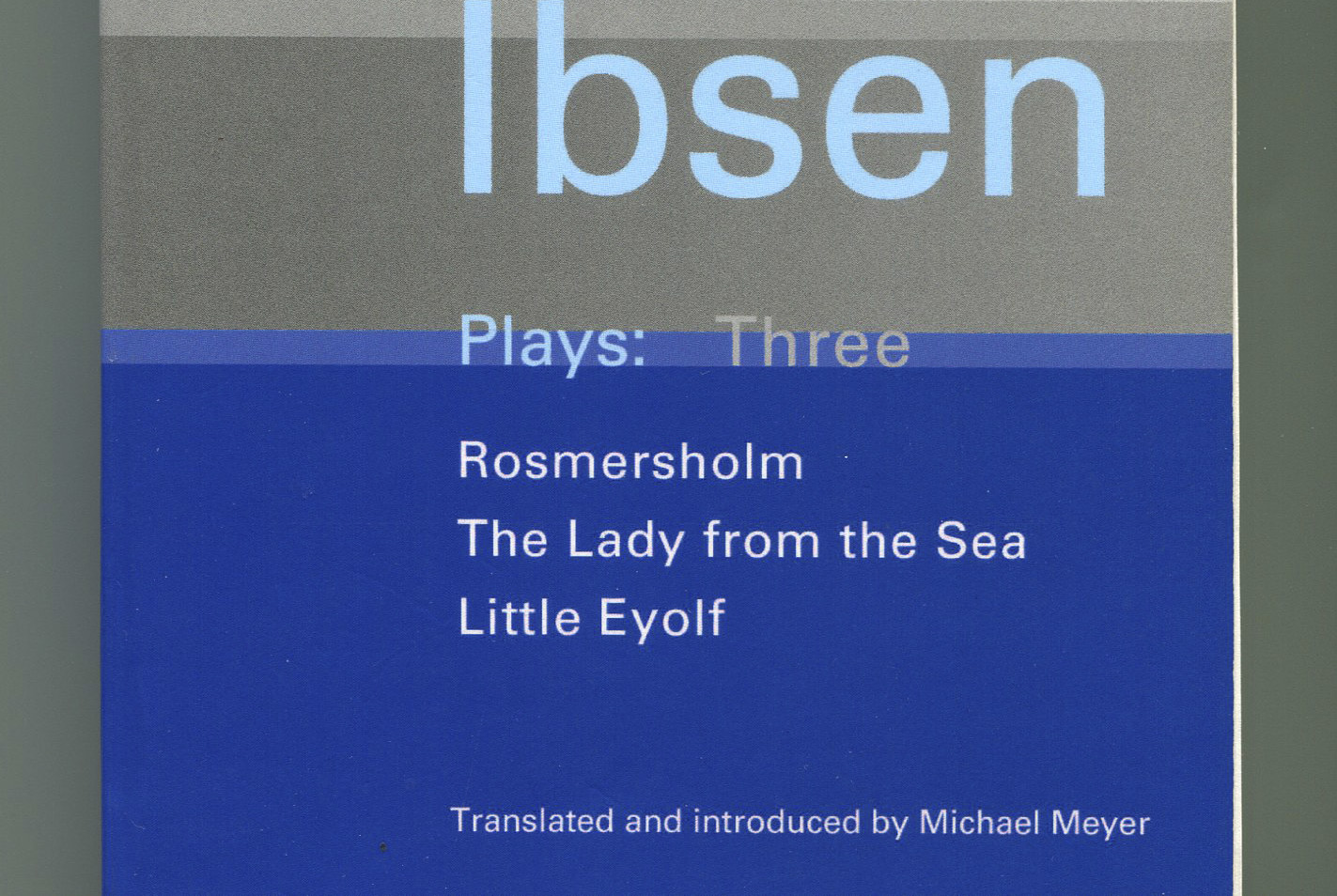
Michael Meyer
Ibsen / Plays : Three
The Lady from the sea / Introduction
Introduction à la traduction de la pièce, par Michael Meyer, dans Ibsen Plays: Three, Methuen Drama, 1961
The Lady from the Sea represents an important turning-point in Ibsens work. He wrote it in 1888, at the age of sixty ; it was the twenty-first of his twenty-six completed plays.
Twenty years before, having explored the possibilities of poetic drama in Brand (1865) and Peer Gynt (1867), and of historical drama in a string of early plays culminating in Emperor and Gafilean (begun in 1864 and finished in 1873), he had turned to the business of exposing the vanities and weaknesses of contemporary society. The League of Youth (1869) attacked the hollowness of radical politicians; The Pillars of Society (1877) attacked with equal vehemence the hollwness of conservatism. Then, turning his attention from the hypocrisy of politicians to the hypocrisy of social conventions, he wrote A Doll’s House (1879), Ghosts (1881) and An Ennemy of the People (1882). The three plays that followed, The wild Duck (1884), Rosmersholm (1886) and The Lady from the sea (1888) were less studies of social problems than of the sickness of the individual; and this is also true of the five mighty dramas of his old age, Hedda Gabler (1890), The Master Builder (1892), Little Eyolf (1894), John Gabriel Borkman (1896) and When We Dead Awaken (1899).
The Lady from the Sea, more than any other of his plays, impressed lbsen’s contemporaries as signifying a change of heart. Within a few days of its publication Ibsen’s earliest champion in England, Edmund Gosse, wrote: « There is thrown over the whole play a glamour of romance, of mystery, of landscape beauty, which has not appeared in Ibsens work to anything like the same extent since Peer Gynt. And moreover, after so many tragedies, this is a comedy…. The Lady the Sea is connected with the previous plays by its emphatic defence of individuality. and its statement of the imperative necessity of developing it; but the tone is quite unusually sunny, and without a tinge of pessimism. It is in some respects the reverse of Rosmersholm; the bitterness of restrained and baulked individuality, which ends in death, being contrasted with the sweetness of emancipated and gratified individuality, which leads to health and peace ».
Later, in a speech delivered in Norway in 1906, the year of Ibsen’s death, the Danish critic, Georg Brandes, recalled a conversation he had had with Ibsen shortly before he began to, write The Lady from the Sea. « I remember that, after Ibsen had written Rosmersholm, he said to me one day: ‘Now I shan’t write any more polemical plays’. Good God, I thought, what will become of the man ? But, as we know, he kept his word. His last plays are not polemical, but are plays about families and the individual. The différence between these two groups of (prose) plays is shown by the fact that of the first six (The Pillars of Society, A Doll’s Ilouse, Chosts, An Enemy of the People, The Wild Duck and Rosmersholm), only one, An Enemy of the People, is named after its chief character, while all the plays in the group beginning with The Lady from the Sea, except the last (When We Dead Awaken), have as their title the name or nickname of a person. »
To understand the reasons for this change of heart, we must go back three years from, the time Ibsen wrote The Lady from the Sea, to 1885.
In the summer of that year he had returned to Norway from his self-imposed exile in Italy and Germany for only the second time in twenty-one years. His previous visit (to Christiania in 1874) had not been altogether happy; but on this occasion he travelled beyond the capital to the little seaside town of Molde, high up on the north-west coast. Although he had been born by the sea, in the port of Skien, and had spent all his vouth and early manhood withim sight of it, he had since 1864 been living in Rome, Dresden and Munich and, apart from that one brief visit to Christiania, had not seen the ocean; for he did not count the quiet waters of the Mediterranean as such. Molde brought back to hom memories of Grimstad and Bergen, and it is related that he stood for « hour after hour gazing down into the fjord, or out at the rough waters of the Atlantic.
People in Molde told him strange stories about the sea, ans the power it had over those who lived near it. Two tales in particular remained in his mind. Onte, told him by a lady, was a Finn who, by means of the troll-powers in his eyes, has induced a clergyman’s wife to leave husband, children and home and stayed away for many years, so that his family believed him dead ; suddenly he returned, and found his wife married with another man.
The first story must have reminded Ibsen of his own mother-in-law, Magdalene Thoresen, who had fled from her native Denmark to escape from a love affair with an Icelandic poet, and had married a widowed cergyman seventeen years her senior. In one of her letters she has left a vivid account of what happened. « While I was studying in Copenhagen I met a youg man, a wild, strange, elemental creature. We studied together, and I had to yield before his mounstrous and demonic will. With him I could have found passion and fulfilment ; I still believe that… Now I have never regretted that he let me go, for as a result I met a better person, and have lived a better life. But I have always been conscious that he could have nurtered into flower that love of which my spirit was capable. So I have lived my life oppressed by a feeling of want and longing. » Of her husband she said : « Thoresen was my friend, my father and my brother, and I was his friend, his child… He was a man to whom I could openly and unhesitatingly say anything to be understood. » She had already told him of « a tragic incident in my restless life. But I bade him regard the past, those year when I had been ignorant, helpless and unprotected, years which I found it impossible to explain either to myself or to anyone else, as a closed book. I begged him to accept me as I was as the result of that struggle and, ir he thought me worthy of it, to let the rest be blotted out. He accepted me.
Magdalene Thoresen was powerfully affected by the sea and could hardly live away from it. Even in old age she had to go down every day to bathe in the surf. « People in Norway, Ibsen said to a German friend while he was writing The Lady from the Sea, are spiritually under the domination of the sea. I do not believe other People can fully understand it. »
During the winter of 1885, after his return from Molde, Ibsen was occupied with planning Rosmersholm. As usual, he did not put pen to paper until the summer, and completed the play in September 1886. Certain traits in the character of Rebecca West in Rosmersholm am plainlly influenced by Ibsen’s stay in Molde. She is obsessed by the sea; Ulrik Brendel calls her « a mermaid » and she compares herself to the sea-trolls which, according to legend, clung to ships and hindered their sailing.
Ibsen had determined to revisit the northern su again the following summer, but in the meantime there occurred a chain of events which, though unconnected with the sea, were also to leave their mark on his next play.
In December 1886, shortly after he had completed Rosmersholm, Ibsen was invited by Duke George II of Saxe Meiningen to visit Liebenstein for a theatrical festival, in the course of which, among other plays, Ghosts was to be performed. Duke George was the patron and inspirer of the famous Meiningen troupe which, under its director Chronegk, so influenced theatrical managers all over Europe during the eighteen-cighties (including Antoine, Otto Brahm, Stanislavsky and Henry Irving, who was much impressed by their lighting and grouping when he saw them in London in 1881). It was not the first time Ibsen had been a guest of the Duke, for as long ago as 1876 he had visited Meiningen to see a performance of The Pretenders – a performance which may possibly have influenced his subsequent writing. This time, however, the Duke showed Ibsen signs of especial favour which evidendy left a deep impression on him. In his letter of thanks Ibsen speaks of « a long and deeply cherished dream » having been fulfilled, and says that the memories of his stay at Liebenstein will remain with him to enrich his remaining days. During the next few months his plays were performed with success in town after town throughout Germany; he was repeatedly feted, three books were published about him, and eminent German authors praised him, and wrote poems in his honour. In France, too, and even England, people were beginning to take serious notice of him at last. He had attracted attention in these countries through A Doll’s House and Ghosts, but hitherto his reputation outside Scandinavia had still largely been that of a revolutionary. Now lie was beginning to be looked upon as an altogether larger and more permanent figure; and Ibsen, like most revélutionary writers, was much gratified at being at last accepted by what is nowadays known as « the Establishment ».
Next summer (1887) Ibsen retumed apin to the north; but this time lie chose, not Norway, but Denmark. At first he went to Frederikshavn, but « I was frightened away froin that town, which has become a colony for artistic coteries, » and lie moved after ten days to the little town of Sæby, on the east coast of north Jutland. He found this much more to his liking and, as at Molde two years before, spent hours each day gazing out to, sea. A nineteen-year-old Danish girl nanied Engelke Wulff, who was also staying at Sœby, noted on the beach « a little, broad-shouldered man, with grey side whiskers and eyebrows. He stood staring out across the water, with his hand shading his eyes. He had a stick with him with which lie supported himself while lie took a book out and wrote something in it. From where I sat and watched him, I supposed him to be drawing the sea. » Ibsen saw her, too, as she sat doing her handwork, and after a time got into conversation with her. She told him of her longing to see the world, and of her love of the theatre, and he promised that he would put her into his next play. One thinks immediately of Bolette; but in fact, when they met by chance in a street in Christiania some years later, lie called her « my Hilde », and one must assume that some of Hilde’s lines in The Lady from the Sea, if not her character, stemmed from his conversations with Engelke Wulff on the beach at Sæby.
Another young lady from Sæby imprinted herself on Ibsen’s memory, though he never met her, for the good reason that since 1883 she had been lying in Sœby churchyard. Her name was Adda Ravnkilde; she was a talented young writer who had killed herself at the age of twenty-one, leaving behind her several stories and a novel, which was later published with a foreword by Georg Brandes. One theme recurs throughout her writings; the unsuccessful efforts of a young girl to free herself of her obsession for a man who she knows is not worthy of her. Ibsen read her writings, and visited her home and her grave. Her story, like the one he had heard in Molde, must have made him think of Magdalene Thoresen; Magdalene had succeeded in escaping front her obsession, but if she had not she might have suffered the same fate as this young girl.
On 12 September 1887 Ibsen made a speech at Gothenburg, in the course of which he said that his polemical interests were waning and, with them, his eagerness for battle. Twelve days later, in a speech in Stockholm, he startled his audience by describing himself as an « optimist, » declaring that he believed the world was entering a new epoch in which old differences would be reconciled and humanity would find happiness. On 5 October he attended a dinner in the Copenhagen home of his publisher, Hegel. In bis address of thanks Ibsen said that this summer, in Denmark, he had discovered the sea; that the smooth and pleasant Danish sea, which one could come close to, without feeling that mountains cut off the approach, had given his soul rest and peace, and that he was carrying away memories of the sea which would hold significance for his life and his writing.
In addition to, bis rediscovery of the sea, and the international recognition that was now being accorded him, a third mollifying influence should be mentioned. During the eighteen months that clapsed between the completion of Rosmersholm and the beginning of The Lady from the Sea, Ibsen held a number of conversations with Henrik Jæger, who was preparing the first authorised biography for publication in 1888, in honour of Ibsens sixtieth birthday. In the course of these conversations Ibsen recalled many old memories, to help Jæger with the early chapters. These memories included some which Ibsen had tried to forget; but now, when he dragged thent out into the daylight, he found that they no longer had the power to frighten him. Consequently, as Professor Francis Bull has observed, Ibsen must have felt impelled to ask himself whether it did not lie within a man’s power to drive away « ghosts » and « white horses, » of whatever kind, provided he had the courage to look his past in the face and make his choice between the past and the present, a choice taken « in freedom and full responsibility. » In Rosmersholm a potentially happy relationship between two people is destroyed by the power of the past; in The Lady from the Sea Wangel and Ellida overcome that power, and il may be that Ibsens conversations with Jæger gave him a new confidence, if only a temporary one, in man’s ability to escape from the terror of his own history.
A fourth influence, though scarcely a mollifying one, was the increasing interest of scientists during the eighteeneighties in the phenomena of hypnosis and suggestion. Throughout Europe during this decade writers were being infected with this interest; Ibsen’s preliminary jottings for The Wild Duck in 1884 contain references to « the sixth sense » and « magnetic influence, » and Strindberg’s Creditors, written in the same year as The Lady from the Sea, is closely concerned with « magnetism » and hypnosis.
It was Ibsen’s practice to allow eighteen months to elapse after the completion of a play before beginning to write another; he would meditate long on a theme before putting pen to paper. Consequently it was not until 5 june 1888 that he made the first rough notes for Rosmersholm‘s successor, which he provisionally entitled The Mermaid. Five days later he began the actual writing. It look him nine weeks to complete his first draft, and since in his manuscript he dated each act we can tell exactly how long the various stages of the play took him. Act I is dated zo-16 june; Act Il, 21-28 june; Act 111, 2-7 july; Act IV, 12-22 july; and Act V, 24-31 july. Early in August he began to revise the play, and by 18 August he had corrected the first two acts to his satisfaction. Two days later he began to revise the third act, and on 31 August he started on the fourth. We do not know when he finished his revision, but on 25 September he posted his final manuscript to Hegel, and on 28 November 1888 the play was published by Gyldendal in Copenhagen under the new title of The Lady front the Sea, in a first printing of 10,000 copies. It was first performed on 12 February 1889, simultaneously at the Christiania Theatre, Christiania, and at the Hoftheater, Weimar.
When The Lady front the Sea first appeared, most of the critics were puzzled, especially in Norway, and apart from a production at the Schauspielhaus in Berlin in 1889 the play seems never fully to have succeeded in Ibsen’s lifetime. Its psychology struck his contemporaries as fanciful and unconvincing, although Kierkegaard had long ago asserted, as Freud was shortly to assert, the importance of aflowing someone who is psychologically sick to be faced with some kind of choice and to make his own decision. When, however, The Lady from the Sea was revived in Oslo in 1928, on the centenary of Ibsen’s birth, Halvdan Koht wrote: « It was a surprise to find how fresh the play seemed…. What especially impressed everyone was how closely the whole conception of the play was related to the very latest scientific psychology, both that which Pierre Janet had originated in the nineties, and the ‘psycho-analysis’ which Sigmund Freud had founded at the same time, and which became universally known shortly after the beginning of the twentieth century. The Lady from the Sea instantly acquired a new meaning and new life. Science had in the meantime seized on all morbid activities of the soul, had penetrated into all its borderlands, and had tried to follow all the suppressed impulses in their subconscious effect, the strife between original, suppressed will or desire, and acquired, thought-directed will. With poetic insight Ibsen had seemed to foresee all this. He envisaged a woman who felt hampere and bound in her marriage because she had married, not for love, but for material support, and in whom there consequently arose a series of distorted imaginings which gripped her nünd like witchcraft. She needed a doctor, so Ibsen made her husband one–he had at first intended to make him a lawyer. Morcover, Ibsen discovered the remedy for Ellida; he gave her back her full sense of frecdom…. As early as Love’s Comedy (1862) he had declared war on all marriage which was not built upon full freedom, and now he wished to picture a marriage which, from being a business arrangement, became a fre and generous exchange. Ellida was to experience what Nora (in A Dolls House) missed « the miracle ».
Ibsen’s rough notes and draft of The Lady from the Sea provide some interesting revelations of the dramatist’s mind at work. At first, as already explained, he intended to make Wangel a lawyer, « refined, well-born, bitter. His past stained by a rash affair. In consequence, his future career is blocked. » But he abandoned this conception, and Wangel became instead a kindly and understanding doctor. His wife first appears as Thora (perhaps after Magdalene Thoresen), but Ibsen changed this to Ellida. In the Saga of Frithiof the Bold there is a ship named Ellide, « which, » Halvdan Koht points out in his biography of Ibsen, « there means something like ‘the storm-goer.’ Such a name gave a stronger suggestion of storm and mysterious troll-powers; the ship Ellide in the saga was almost like a living person fighting its way against evil spirits that tried to drag it down ». Ibsen originally intended that Ellida should have broken her engagement with the seaman because of social and moral prejudices derived from his upbringing; but, significantly, he discarded this motive, and the conflict between Wangel and the Stranger became instead a struggle to gain control over the subconscious powers of her soul. Ibsen also planned at first to have an extra group of characters who would represent the outside world and be contrasted with the inhabitants of the little town, but he scrapped this idea, presumably to achieve stronger dramatic concentration.
Lyngstrand, the consumptive sculptor, had made a phantom appearance four years earlier in Ibsen’s first notes for The Wild Duck. Bolette and Hilde seem to have been present in Ibsen’s mind while he was planning Rosmersholm, since his early notes for that play contain mention of Rosmers two daughters by his dead wife, the elder of whom « is in danger of succumbing to inactivity and loneliness. She has rich talents, which are lying unused, » while the younger daughter is « sharply observant; passions beginning to dawn. » Among the characters Ibsen considered putting into The Lady from the Sea, but subsequently discarded, was «an old married clerk. In his youth wrote a play, which was performed once. Is continually touching it up, and lives in the illusion of getting it published and becoming famous. » This character, who appears to have been based on a friend of Ibsen’s youth named Vilhelm Foss, turned up four plays later as Vilhelm Foldal in John Gabriel Borkman. Hilde Wangel was to reappear formidably in The Master Bailder.
The early notes for The Lady from the Sea also contain mention of a « strange passenger », visiting with the steamer, who « once felt a deep attachment to her [Ellida] when she was engaged to the young sailor ». This character was clarified into Hesler, a civil servant; then Ibsen altered his name to Arenholdt, Askeholm and, finally, Amholm, and turned him from a civil servant into a schoolmaster.
The « young sailor » does not figure in Ibsen’s first castlist, and Ibsen seems to have intended that he should not appear; then he hit on the notion of making him, and not Arnholm, « the strange passenger » or, as he finally called him, « the Stranger ». The Stranger is (unless one reckons Ulrik Brendel in Rosmersholm as such) the predecessor of those intruders from the Outside World who enter so importantly into Ibsen’s later plays: Hilde in The Master Builder, The Rat Wife in Little Eyolf, Mrs Wilton in John Gabriel Borkman, the Nun in When We Dead Awaken.
After several productions had failed to portray the Stranger satisfactorily, Ibsen issued a directive that this character « shall always stand in the background, half concealed by the bushes; only the upper half of his body visible, against the moonlight. » In a letter to Julius Hoffory he stressed that the Stranger « has come as a passenger on a tourist steamer. He does not belong to the crew. He wears tourist dress, not travelling clothes. No-one knows what he is, or who he is, or what his real name is. » At Weimar, where he thought the production « quite admirable », though Wangel and Lyngstrand were disappointing, he allowed himself an unusual luxury in the way of praise. « I cannot wish for, and can hardly imagine, a better representation of the Stranger than the one I saw here. A long, lean figure, with a hawk face, black, piercing eyes and a splendid deep, quiet voice. »
The incident of the rings which Ellida and the Stranger throw into the sea as a token of betrothal was borrowed from Ibsen’s own experience. Thirty-five years before, in his early days as an apprentice at the theatre in Bergen, he had fallen in love with a fifteen-year-old girl named Rikke Holst, and they had betrothed themselves to cach other in just this way. Rikke’s father had broken off the match and, three years before he wrote The Lady from the Sea, Ibsen had reencountered his former fiancée, now married to a rich business man and surrounded by numerous children. That meeting, too, left its mark on the play.
The objection most commonly raised against The Lady from the Sea is the difficulty of making the climactical moment of Ellida’s choice seem convincing. In this connection Dr Gunnar Ollèn has written: « No one who saw theproduction in Vienna in the spring of 1950, with Attila Hörbiger as Wangel and Paula Wessely as Ellida, will share the opinion that Ellida’s choice is implausible. The way Hörbiger played the scene in which he gives Ellida her freedom, her choice seemed utterly natural. He became red in the face, and had difficulty in enunciating his words, standing absolutely motionless and upright, with tears streaming down his cheeks. Quite simply, a stronger emotional power emanated from her husband than from the sailor. She … stared at Wangel as though seeing him for the first time, and then walked slowly across to him as though magneticaIly drawn. It was as if two hypnotists were fighting to gain control of a medium »
Pirandello particularly admired The Lady from the Sea, and Ellida was Eleonora Duse’s favourite role among the many of Ibsens in which she excelled. She chose it both for her « farwell performance » in 1909, and for her come-back twelve years later. In 1923 she played it in London, at the New Oxford Theatre, and James Agate bas left a memorable description of her performance:
« This play is a godsend to a great artist whose forte is not so much doing as suffering that which Fate has donc to her. With Duse, speech is silver and silence golden…. The long second act was a symphony for the voice, but to me the scene of greatest marvel was the third act. In this Duse scalled incredible heights. There was one moment when, drawn by every fibre of her being to the unknown irresistible of the Stranger and the sea, she blotted herself behind her husband and took comfort and courage from his hand. Here terror and ecstasy sweep over her face with that curions effect which this actress alone knows, – as though this were not present stress but havoc remembered of past time. Her features have the placidity of long grief; so many storms have broken over them that nothing can disturb again this sea of calm distress. If there be in acting such a thing as pure passion divorced from the body yet expressed in terms of the body, it is here. Now and again in this strange play Duse would seem to pass beyond our ken, and where she has been there is only a fragrance and a sound in our ears like water flowing under the stars. »
Duse’s interpretation remained unchallenged for over half a century. Then, in 1976, Vanessa Redgrave played Ellida in a production of The Lady from the Sea by Tony Richardson at the Circle in the Square, New York. Her performance was unanimously admired. Two years later, she acted the part again in a new and even better production by Michael Elliott at the Royal Exchange Theatre, Manchester, transferring (16 May 1979) to the Round House in London, amid further acclaim. « She combines» wrote Michael Coveney in the Financial Times, « animal passion and suffocating doubt in a marvellous expression of Ellida’s inner struggle »; and Francis King prophesied in the Sunday Telegraph: « I suspect that one day we shall be reminiscing about Miss Redgraves Ellida as fondly as gaffers now reminisce about Duse ». It was indeed one of the great Ibsen performances and productions.
MICHAEL MEYER