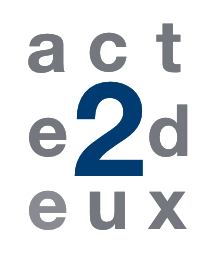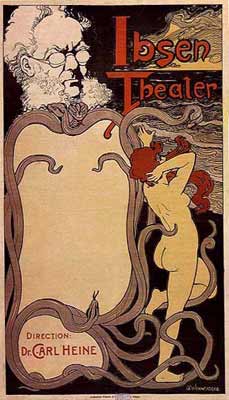Intervention de Françoise Decant
Débat 10 mars 2012
Intervention de Françoise Decant
Alors Ibsen… je suis « tombée » dedans, c’est bien le mot, au sortir d’une représentation théâtrale en 1999 de Hedda Gabler, mise en scène par Gloria Paris.
A l’issue de la représentation, une certitude s’est imposée à moi, il fallait que j’écrive quelque chose sur cette pièce. La magie avait opéré. Un article a vu le jour, puis d’autres et enfin un livre. Entre temps, j’avais dévoré presque toute l’œuvre d’Ibsen.
Comment Ibsen avait-il pu mettre à jour la complexité du fonctionnement du psychisme humain alors que la psychanalyse en était à ses balbutiements, montrant bien par là que l’artiste précède le psychanalyste, comme nous l’a enseigné Freud et sur ses pas, Jacques Lacan.
On a souvent dit du théâtre d’Ibsen qu’il livrait l’inconscient à ciel ouvert et Jean louis Barrault avait qualifié le dramaturge norvégien de « Freud du théâtre ».
Sans vouloir développer- je fais une petite parenthèse- je tiens à préciser que c’est la présence du psychanalyste qui permet au savoir refoulé d’être élevé au statut de savoir inconscient grâce au transfert.
Pour revenir au rapprochement entre le théâtre et la psychanalyse, celui-ci nous invite à nous pencher sur ce qui est donné à voir et à entendre sur la scène théâtrale. La question se pose alors de savoir si le théâtre serait le lieu où la psychanalyse pourrait approcher ce qui dans la clinique ne cesse de nous échapper. Cette question est celle que Jean-Michel Vives avait hardiment lancée un jour à l’adresse des psychanalystes.
L’œuvre d’Ibsen me semble un terrain favorable pour tenter d’approcher, je dis bien approcher cette question.
Ceux qui ont eu l’occasion de lire les textes d’Ibsen, je précise « lire » ont dû remarquer que de nombreux points de suspension, de nombreux blancs, émaillaient le texte et on peut penser qu’un désir caché, voilé, refoulé se dissimule derrière ces blancs.
Mais Ibsen nous enseigne également avec talent et c’est là tout l’intérêt de « La Dame de la mer » que tout ne peut se dire, ni s’écrire, d’où la tentative de représenter sur scène cette chose opaque et obsédante qui nous habite, que Jean Cocteau appelle l’inconnu dans l’hommage qu’il rend à Ibsen en 1960.
Cet hommage s’intitule :
A cheval sur le réel et le rêve
« Ibsen. Il est difficile de tenir entre nos mains cette neige sombre et comme éclairée par le soleil noir de la mélancolie de Durer.
Un schizophrène habite tous les artistes. Beaucoup en éprouvent de la honte et le cachent. D’autres ne sont que sa main-d’œuvre. D’autres collaborent avec lui. Sans ce fou mêlé à nos ténèbres intimes, une œuvre de poète ne serait rien.
Chez Ibsen, la permanence d’un tel fantôme ressemble à cette fausse nuit nordique où baignent les pièces de Strinberg.
L’admirable d’Ibsen, c’est la force avec laquelle il brave l’hôte inconnu. »
Braver l’inconnu qui est en nous, voila la tache à laquelle s’est attaqué Ibsen par la bouche d’Ellida. Ce n’est certes pas une tâche facile car nous touchons là au domaine de ce qui ne peut se dire. Or, c’est tout à fait passionnant de suivre l’énorme effort que fait Wangel pour soutenir sa femme dans son besoin de dire.
Cette invitation à parler, à dire, va permettre à Ellida de faire ce que j’appellerai un cheminement psychique pour tenter de cerner « la chose » qui l’habite. Si cette pièce, « La Dame de la mer » est si compliquée, c’est parce que cette chose va apparaître tour à tour sous différents éclairages, tous plus énigmatiques les uns que les autres.
Ca commence, vous l’avez compris, par la fascination de la mer, d’où le nom donné à Ellida.
La fascination de la mer
Pragmatique, le Dr wangel propose à sa femme de déménager, pour la guérir de ce que Sandor Ferenczi, psychanalyste hongrois disciple de Freud qui s’est beaucoupp intéressé à l’œuvre d’Ibsen avait appelé une « monomanie ».
Mais la dame de la mer refuse de déménager, d’aller vivre au bord de la mer. Son mari va alors l’inviter à nouveau à dire, lui permettant d’évoquer l’histoire de ce marin, histoire dont les contours sont dessinés par le souffreteux Lyngstrand interprété de façon géniale par Nicolas Maury. J’ai dit « dessiné », mais comme l’a fait remarquer Claude à Laure Adler sur France Inter, c’est une sculpture que Lyngstrand projette de faire. En disant ceci, je ne peux m’empêcher de faire un rapprochement avec le travail de sculpteur de Rubeck, le poète que grave ses mots dans la pierre dans la dernière pièce d’Ibsen « Quand nous nous réveillerons d’entre les morts », pièce majeure d’Ibsen que Jean-Pierre Sarazac connaît également très bien.
C’est tout à fait intéressant de voir comment de petits détails sont en fait des indices de germination de la création d’une œuvre future chez Ibsen, qui, je le rappelle insistait pour que son œuvre soit considérée comme un tout.
Serez-vous surpris d’apprendre que le titre de la pièce que Claude Baqué a montée avait été annoncé par Ibsen quelques trente ans plus tôt sous forme d’une hallucination dans le grand poème lyrique Peer Gynt, lorsque le héros, Peer, croit voir figurée une dame de la mer sur le fronton de la cabane où se trouve Solveig, l’objet incestueux, au moment précisément où l’angoisse l’envahit.
Mais revenons à Wangel, ce mari à l’écoute de sa femme qui est toutes ouïes dehors, pour rester dans la terminologie maritime…
L’innommable
Wangel aimerait bien balayer d’un revers de manche l’histoire à dormir debout de ce marin, car il voit bien qu’il y a « autre chose » et comprend que la cure de parole ne marche pas plus que la proposition de cure maritime. Mais que peut -il faire autrement si ce n’est l’inviter à dire, encore et encore, lui permettre d’aller encore un peu plus loin ? Pourquoi n’a-t-elle pu se confier avant ? Qu’est ce qui l’en empêchait ? La réponse d’Ellida est alors la suivante: « «Si je m’étais confiée à toi, alors il aurait fallu que je te confie aussi le —». Ellida marque une pause traduite dans le texte par ce tiret: l’indicible.
Claude Baqué, qui traduit toutes les pièces qu’il monte, a traduit « l’indicible » par « l’innommable », qui serait effectivement au plus prêt de l’impossibilité de nommer la chose. La chose que Freud a appelé « Das Ding ».
Permettez moi de vous lire la traduction de Claude Baqué : « Si j’avais du te confier cette chose là,- j’aurai dû te confier aussi— tiret, l’innommable. »
Je précise que ce n’est pas l’aveu de son amour pour le marin qui est en jeu ici, mais l’énigme des yeux de l’enfant décédé, ces yeux qui changeaient de couleur selon les flots, mais que seule Ellida voyait, pas le mari… Non pas que les maris soient aveugles, non, mais parce que, me semble -t-il, ce mystère, révélé à Ellida et à elle seule fait plutôt penser à quelque chose du coté de l’hallucination, qu’on va retrouver plus loin avec les yeux du marin qui la terrorisent,et l’épingle de cravate qui ressemble à un œil mort qui la regarde.
Pour revenir à « la Chose », Marie Vanderbusch, qui a organisé ce débat, m’a posé deux questions à l’issue de la première, que j’ai trouvées intéressantes. Elle m’a demandé si Ibsen, dans la version originale avait bien parlé, lui, de la Chose. « La chose », dette figure bien dans le texte original, mais elle est passée à la trappe dans la traduction de Terje Sinding dans la collection « Le spectateur français ». Je suppose que bien d’autres choses sont passées à la trappe mais Claude Baqué nous en dira peut -être quelque chose après. Ce n’est certes pas un hasard s’il fait tout ce travail de traduction avant de monter ses pièces.
Pour revenir aux questions de Marie, elle m’a aussi questionnée sur l’articulation entre la chose, le Réel et le marin…
Le Réel
Bref, elle est tombée en plein dans le mille… Je vais essayer de donner des éléments de réponse, sachant que le Réel, tel que je l’entends, est un concept qui a été introduit par Lacan, et qui ne peut se définir que par rapport aux deux autres instances psychiques, l’imaginaire et le symbolique. Pour faire vite, le Réel est déjà là avant l’avènement du sujet de l’inconscient. Ordinairement, c’est à la mère qu’il convient de l’incarner, car ça concerne à la fois l’énigme du désir de la mère, le « Que me veut-elle ?, le Che Vuoi ? » et la réponse de l’enfant, en lien avec la castration maternelle, inscrite du coté de la jouissance, de la pulsion, jouissance en excès qui va être rejetée, refoulée lors du refoulement originaire. Le père, lui, est du côté de l’intervention symbolique, son rôle n’est pas d’interdire, comme on le pense souvent, en réduisant les pères au rôle de pères fouettards, mais plutôt d’unir le désir à la loi
Après ces quelques précisions, revenons à Wangel et à sa propre conception du réel.
Pour Wangel, le réel, c’est l’arrivée, je dirai physique, concrète, en chair et en os du marin. Wangel pense que cette intrusion de la réalité (je crois que ce sont ces termes) va permettre à Ellida de balayer ses pensées morbides. Un peu comme s’il lui disait : « Maintenant que tu l’as revu, tu vas t’arrêter de fantasmer sur lui… »
Mais on voit bien qu’il se trompe et que les choses sont plus compliquées car d’une part, on touche là à la complexité de la question du désir,-je pense que Sylviane Agazinski va nous en dire quelque chose-et que d’autre part, Wangel se méprend sur la place que ce personnage peut occuper dans l’économie psychique de sa femme.
Le nouage du sexuel au réel de la mort.
Dans ce très beau texte d’une saisissante sensualité, Ibsen va nouer le sexuel au réel de la mort, et ce nœud, c’est un marin qui va s’en faire le représentant.
La mer, l’une des figures de la mère empruntée au symbolisme, est cet étrange objet de fascination mortifère.
Ellida ne comprend pas plus que son mari, le Dr Wangel, pourquoi elle est attirée par la mer, mais, grâce à lui, qui l’invite à dire, elle va tenter de mettre des mots sur ce qui ne cesse de l’envahir: «Nuit et jour, hiver comme été, elle me submerge, cette vertigineuse nostalgie de la mer». Lorsqu’elle écarte l’idée d’aller vivre au bord de la mer, car, dit-elle, «y’e le sens, même là-bas, je ne pourrai m’en débarrasser», son mari lui demande, étonné: «De quoi parles-tu?» Ellida lui fait cette réponse: «De l’effroyable, de ce pouvoir incompréhensible sur mon esprit».
Wangel est dérouté. Que veut-t-elle dire? Les paroles de sa femme résonnent de façon tellement énigmatique! Mais comment pourrait-il en être autrement au moment même où Ellida tisse quelque chose entre l’effroyable, son attirance pour la mer, et la peur de cet homme qu’elle a aimé…Elle précise: «Une peur si effroyable comme seule la mer peut en inspirer… ». Wangel réalise pourquoi sa femme se refusait à lui et ne voulait pas vivre avec lui «comme sa femme». Est-ce parce qu’il a repéré le caractère sexuel de cette attirance pour la mer?
Mais en même temps, lorsqu’il veut à tout prix la protéger, Ellida s’offusque.
«Me protéger? Contre quoi? Je ne suis menacée par aucune violence, par aucune puissance extérieure. L’effroyable, c’est plus profond, Wangel! L’effroyable — c’est l’attirance qui est au fond de mon âme. Que peux-tu faire contre elle?»
Et lorsque le marin, qu’Ibsen nomme dans son texte « l’Etranger » avec un M majuscule, revient pour la deuxième fois chercher Ellida, et que son mari tente de la retenir, elle lui dit: «Tu peux me retenir, mais mon âme, mes pensées, — mes envies et mes désirs —eux, tu ne pourras pas les enfermer. Ils continueront à s’envoler vers l’inconnu.»
Et là où les critiques ont vu un discours en faveur de l’émancipation féminine, Ibsen, dans une formule concise, épingle le réel du côté de l’impossible.
Wangel — «Ce désir du sans fin, du sans bornes, ce désir de l’impossible, il précipitera ton âme dans les ténèbres de la nuit.»
L’histoire se déroule en Norvège, dans «le pays où le monde entier passe pour aller contempler le soleil de minuit». Nous sommes en 1888. Si Freud a déjà
rencontré Charcot et Breuer, il a à peine commencé à écrire. La psychanalyse en est à ses balbutiements. D’ailleurs, c’est du théâtre, rien que du théâtre… Où pourtant chaque mot compte.
L’Etranger
Ce marin, l’Etranger, comme le nomme si bien Ibsen, n’incarne-t-il pas parfaitement l’une de ces «doublures errantes qui réclament leur dû» pour reprendre l’expression de Gérard Pommier dans son livre sur le Réel?1
Lorsqu’il vient chercher Ellida, faisant fi du temps qui s’est écoulé et du mari, montrant que rien ne peut l’arrêter dans sa détermination, il lui dit tout simplement: «Me voilà, suis-moi!» Son apparition brutale, aussi violente que les flots tumultueux qui étaient censés l’avoir englouti, signe le retour du déchaînement de la jouissance pulsionnelle.
En le voyant, Ellida est prise d’effroi: «Les yeux, les yeux… Ne me regardez pas ainsi!»
Mais l’apparition du marin n’est pas seulement liée au retour du pulsionnel. En effet, par le biais de la couleur des yeux de l’enfant attendu par Ellida, cet enfant décédé, la Dame de la mer aménage ainsi à ce marin une place de père, puisque l’enfant avait les yeux du marin.
C’est un bien savant ouvrage que nous propose Ibsen. Il s’y connaissait en nœuds… marins ou pas! C’est pourquoi j’ai intitulé mon livre « L’écriture chez Henrik Ibsen : un savant nouage ».
Le marin est à la fois le Réel, c’est-à-dire «l’Etranger, l’Hôte qui est en nous», pour reprendre la citation de Cocteau, et un père fabriqué de toutes pièces par Ellida, tissé dans les mailles du fantasme. Que ce père se présente sous les traits d’un père aussi attirant sexuellement que violent n’a rien d’étonnant, puisque sa présence est en rapport avec l’angoisse de la castration maternelle.
Ubiquité de ce personnage envoûtant, qui, parce qu’il est le rappel de l’amour maternel et de son énigmatique désir, traîne au-dessus de lui, non seulement «/les puissances de la mer» mais aussi la présence «des ailes noires et silencieuses» de la mort. Et ce, jusqu’au moment où Ellida peut lui dire, parce que le père primitif a cédé la place au père mort: «Pour moi, vous êtes mort. Un mort sorti de lo mer et qui retourne.»
Pour revenir aux « doublures errantes », n’est-il pas dans l’errance cet Etranger qui surgit d’on ne sait où et va repartir on ne sait vers quelle destination ?
Je voudrais saluer ici la superbe trouvaille de Claude Baqué concernant l’arrivée de L’Etranger, interprété par Nicolas Martel. Je vais vous dire ce qui m’est venu à l’esprit, dans l’après coup, bien sûr… l’Etranger traverse ce rideau d’eau comme on pourrait imaginer traverser l’écran du fantasme. Je dis bien « imaginer » car le fantasme, s’il se construit en analyse, ne se traverse pas.
Le fantasme est bien là pour protéger du Réel. Etoffe du désir, le fantasme est cet écran qui dissimule quelque chose de tout à fait premier. Et lorsque l’Etranger va retraverser le rideau de pluie pour retourner de l’autre coté, là d’où il vient, c’est-à-dire du coté du Réel- et la mise en scène le montre bien-nous savons qu’Ellida a pu se libérer de ce qui l’envahissait car son mari a fait coupure en acceptant de la perdre, introduisant du symbolique dans cet univers de violence pulsionnelle que ce rideau d’eau illustre si bien.
Puisque nous sommes dans les inventions, je voudrais saluer une autre invention de Claude- invention par rapport au texte d’Ibsen-, c’est l’introduction de la voix off lorsque Lyngstrand évoque la colère du marin en découvrant l’annonce du mariage d’Ellida dans le journal.
La voix off
Cette voix off, qu’entend Ellida et elle seule, car elle est dans une langue étrangère- norvégien ou pas, tout le monde s’interroge, Claude nous dira peut-être ou pas…- donc, cette voix off n’est-elle pas une belle trouvaille pour illustrer le retour dans le réel de ce qui a été forclos du symbolique ?
La créativité musicale : dompter le Réel
Puisque je viens d’évoquer la langue étrangère, autre, qui fait rupture dans le texte théâtral, il serait temps de saluer le travail de composition musicale de Camille et de ses musiciens, toute cette belle créativité.
Lorsqu’Elidda, par la voix de Camille chante dans cette langue venue d’ailleurs, il me semble que nous ne sommes pas dans le même registre qu’avec la voix off. Nous sommes dans le registre de la sublimation, de la créativité, qui renverrait là plutôt à une tentative de dompter le réel, de l’amadouer, de le pacifier. Si Ellida est envahie, cernée de toutes parts, comme elle le dit si bien, et l’eau partout présente dans la mise en scène de Claude Baqué le montre bien, lorsque la Dame de la mer chante, elle nous fait partager des moments de grâce émanant de sa mer intérieure. La voix sublime de Camille nous fait basculer dans un autre champ, et nous invite à naviguer sur les flots ce cette mer intérieure.
Alors petite question : Ce qui ne peut se dire pourrait-il être chanté dans une langue autre?
La tension entre Eros et Thanatos
L’eau est partout présente sur le plateau du théâtre des Bouffes du Nord, comme vous avez pu le remarquer. L’eau dans tous ses états et sous toutes ses formes. Une eau dans laquelle se reflète la lumière qui se diffracte et s’élance sur les cotés, faisant chatoyer les piliers de ce vieux et beau théâtre.
Jeux d’eau et jeux de lumière qui accompagnent, en plus du drame d’Ellida, l’humour, la malice et voire même la perversité.
Je fais bien sûr référence aux échanges des deux filles de Wangel avec leurs soupirants, vous l’aurez compris.
Comme le faisait si bien remarquer Claude hier soir, c’est le théâtre, c’est-à-dire la scène, qui met réellement en valeur des dialogues qui ne laissent pas filtrer toute leur importance à la lecture du texte de la même façon.
L’amour et le flirt sont au rendez vous. Mais pas seulement. La scène théâtrale n’est-elle pas le lieu d’accueil privilégié de la tension entre Eros et Thanatos ?
Cette tension est on ne peut mieux illustrée par le personnage de Lyngstrand interprété avec humour par Nicolas Maury qui a choisi de se jouer de la neurasthénie de l’artiste, un humour qui côtoie avec bonheur celui de la coquine Hilde, interprétée avec légèreté par Ophélie Clavie.
Quant à Bolette, interprétée par Marion Bottollier, après avoir prêté son écoute à Lyngstrand qui l’entretient sur le rôle que la femme (version maman) se doit de jouer dans la vie de l’artiste, elle sait y faire avec une exquise malice avec l’obsessionnel professeur-si dévoué- interprété par Nicolas Struve, qui court tout autour de la pièce d’eau par peur de se mouiller avant d’accepter de se jeter à l’eau… Il était temps, à son âge !
Un coup de chapeau à toute l’équipe, sans oublier Matthieu Ferry qui « sait y faire » avec les lumières…
Je vous remercie.